

Je tiens d’emblée à préciser que je n’ai pas de formation scientifique. Ce travail est le fruit de recherches et de réflexions personnelles. Mon but était en premier lieu de faire le point sur une observation déjà ancienne, celle de Cussac ; puis j’en suis venu à parler du travail des ufologues et finalement du phénomène en général. J’utilise parfois le mot « exotique » afin d’indiquer que je vais m’aventurer hors des « sentiers battus ». Vous pouvez donc me suivre ou sauter directement au chapitre suivant. Le sujet nous y amènera de toute façon quoi qu’il en soit…
J-M. GILLOT
« Si on dit telle affaire c’est un hélicoptère qui s’est posé, bien, ok, il faut avoir l’hélicoptère, le nom du pilote et le numéro du vol et là on sera convaincu sinon c’est extrêmement difficile. On peut dire ce que l’on veut sur les Ovnis. On peut dire ce que l’on veut pour et contre. C’est là le vrai problème. Il faut créer les conditions d’un vrai débat »
Pierre Lagrange, sociologue des Sciences (émission « C dans l’air » - mars 2007)
Exotique (Phys.) Dont les caractéristiques diffèrent notablement des caractéristiques habituelles.
Le Petit Larousse
I. Présentation succincte de l’observation
Date : 29 Août 1967
Région : Auvergne
Département : Cantal
Commune : Cussac (Latitude : 44°59’05’’ Nord Longitude : 02°56’00’’ Est)
Densité : approx.17 habitants/Km2 en 1967
Ressources et productions : céréales, bovins ; coopérative laitière
Altitude : 880m (mini) – 1 079m (maxi)
Superficie : 1 368 ha = 13.68 Km2
Heure approximative: 10h30
Vent : très faible, éventuellement ouest ou nord-ouest
Températures : entre 12 et 16°
Emplacement des témoins : lieu-dit Les Tuiles, dans un pré
Emplacement du phénomène : lieu-dit Les Reverjats
Nombre (objet): 1
Nombre (êtres) : 4
Témoins principaux : 2
=> Frère et sœur d’une famille comptant au moins 4 enfants
1) Nom : DH* Prénom : François Age : 13 ans et demi
2) Nom : DH Prénom : Anne-Marie Age : 9 ans
(* nom de famille visible dans la presse de l’époque)
Personnes présentes sur place ou proches du lieu de l’observation : 3 (connues)
1) Nom : DR Prénom : inconnu Age : inconnu Profession : garde champêtre
=> Il aurait perçu un « sifflement »
2) Nom : inconnu Prénom : inconnu Age : inconnu Profession : agriculteur - (décédé < avril 1978)
=> Il aurait vu l’agitation des bêtes
3) Nom : VX Prénom : inconnu Age : inconnu Profession : agriculteur
=> Il aurait croisé les enfants sur la route juste après l’observation
Description succincte de l’observation :
En 1967, deux enfants qui gardent des vaches avec leur chien pendant les vacances scolaires observent une « machine » et quatre êtres insolites.
En 1977, la direction générale du C.N.E.S. crée le G.E.P.A.N., service chargé des témoignages relatifs aux phénomènes prétendument anormaux observés dans le ciel, ce que l’on appelle couramment des « ovnis ». Le cas de Cussac est sélectionné par le G.E.P.A.N. comme représentatif d’une rencontre rapprochée du 3ème type (RR3). En 1978, le G.E.P.A.N. décide de réaliser une enquête sur ce cas qui reste pour lui l’un des plus étonnants observés en France. Le 22 mars 2007, lors de la publication sur internet d’une partie des archives du G.E.P.A.N. (devenu entre-temps le G.E.I.P.A.N., le « I » pour Information), l’observation de Cussac est qualifiée d’exceptionnelle. Cette rencontre a eu lieu « entre des enfants et des êtres insolites dont il est impossible de nier le comportement intelligent et semblant disposer d’une technologie qui nous est inconnue… Aucune explication rationnelle n’a été donnée à ce jour ». Déclaration de Didier Gomez (UFOmania magazine) en avril 2008: « Jacques Patenet (responsable du G.E.I.P.A.N.) me disait le 8 mars dernier qu’il était matériellement impossible qu'un hélico de type alouette II ait pu se poser à cet endroit »
II. Chronologie des événements et petit aperçu de l’actualité mondiale de 1967 à 1983 : (liste non exhaustive d’événements dont les témoins n’avaient pas forcément connaissance.)
1967
=> Janvier
Observations dans le village de Roumagnac (Aveyron)
Le 10, diffusion du premier épisode de la série « Les envahisseurs » aux USA
Le 19, à 20h, JT de l’ORTF : voyage de Georges Pompidou en Charente Maritime. Survol des usines SIMCA. Arrivée de G. Pompidou en hélicoptère. Inauguration de l’usine (durée : 5mn 28s)
Le 25, enlèvement de Betty Andreasson (Massachusetts - USA)
Fin du mois, observation d’un petit humanoïde avec barbe à Valensole
=> Février
Le 1er, parution d’un article sur « l’avion hélicoptère » dans Sciences et Mécaniques n°249
Le 3, ORTF, « 5 colonnes à la une » : reportage sur la section Anderson au Vietnam (images d’hélico)
=> Avril
Le 7, 1er vol du prototype de l’hélicoptère Gazelle qui sera mis en service en 1971 (particularité : le rotor arrière est intégré dans un fenestron).
Le 27, 12h, radio Clermont-Ferrand signale l’observation d’un ovni au nord de la ville (tir de fusée ?)
Le 29, article dans Air & Cosmos n°197 sur la société Heli-Union.
=> Mai
Découverte d’un très étrange « trou » à Marliens (nombreux articles dans la presse par la suite…)
Le 22, Jean Tyrode observe un disque sombre en rentrant à Evillers
=> Juin
Le 3, à 20h, JT de l’ORTF : M. Pompidou au salon du Bourget. Image d’un hélicoptère russe
Les 10 et 11, le député G. Pompidou inaugure le téléphérique du Lioran sur le Plomb du Cantal (1)
=> Juillet
Le 17, observation d’Arc-sous-Cicon dans le Doubs (Article dans Centre Presse le 21/7, etc…)
Le 19, des « objets mystérieux hantent le ciel » (désintégration satellite russe …) dans La Montagne et « des soucoupes volantes » dans Paris Presse l’intransigeant
Le 20 dans La Montagne et le 21 dans Centre Presse, articles évoquant un pic d’activité du Soleil, des rentrées satellites et des méprises possibles avec les « soucoupes volantes »
Le 23, petit article intitulé « Soucoupes volantes » à la page 4 de La Montagne. Le même jour, fête locale à St Etienne-Cantalès (Cantal) avec démonstration en hélicoptère par la protection civile…
Le 27, un article intitulé « Les français ont-ils vu des soucoupes ? » dans Noir et Blanc n°1169
=> Août
Le ? , une prime au « Martien » est promise par une radio régionale, depuis Clermont-Ferrand …
Le ?, détection du premier pulsar (PSR B 1919 + 21, surnommé par la suite LGM1)
Le 4, article intitulé « Soucoupes volantes » en page 1 de La Dépêche d’Auvergne. En page 2, on signale que l’adjudant Ernest R, Cdt de la brigade de St Flour est promu adjudant chef…
Le 20, dessin humoristique d’une « soucoupe volante » dans La Montagne
Dans la nuit du 22 au 23, veillée de L.D.L.N. rapportée dans La Montagne du 25/8.
Le 21, « Echelle de Jacob » (hélicoptère US) page 7 de La Montagne et couverture de L’Express montrant un homme grenouille et la soucoupe plongeante du Commandant Cousteau
Le 24, un article intitulé « Les soucoupes volantes et les U.S.A. » dans Le Hérisson n°1115
Le 30, interview radiophonique sur Radio Luxembourg
Le 31, un hélicoptère en photo (à Choulex) page 16 de La Montagne
=> Septembre
Le 1er, article sur l’observation de Cussac dans La Montagne (Clermont-Ferrand)
Le 2/3, article sur le même sujet dans Paris jour
Le 6, un hélicoptère « banane » se pose en bordure de la Nationale 653 dans le Cantal…
Le 7, un article intitulé « Les soucoupes volantes chez les Chinois » dans Le Hérisson n°1130
Le 9, découverte du cadavre d’une jument dans le comté d’Alamosa (sud du Colorado - USA)
* Sept – Octobre, article sur Cussac dans la revue L.D.L.N. n°90 (page 6)
=> Octobre
Le 11, décès de Ignaço da Souza des suites d’une rencontre avec 3 inconnus (chauves) qui aurait eu lieu le 13 août à Santa Maria (Brésil)…
Le 20, deux chasseurs tournent un film qui montre une créature simiesque (Californie – USA)
=> Novembre
Le 16, un article intitulé « Les soucoupes volantes existent » dans Noir et Blanc n°1185
=> Décembre
Le 3, observation du policier Herbert Shirmer près d’Ashland (Nebraska)
Le 15, le Silver Bridge s’effondre dans l’Ohio (Point Pleasant – USA)
1968
=> Printemps
Lumières dans la nuit redevient mensuel avec la sortie de la série des numéros sous-titrés « contact-lecteurs » ; F. Lagarde (2) a voulu se charger de la rédaction.
=> Avril
Enquête de Joël Mesnard et Claude Pavy du G.E.P.A. à Cussac (3)
=> Août
Le 4, M. DH, père des enfants, autorise la revue L.D.L.N. à publier dans un prochain numéro un texte parlant de l’observation de ses enfants. F. Lagarde précise dans son livre (4) que ce texte a été signé après que M. DH a eu lu « la relation qu’en a fait M. de Saint-Etienne ».
=> Octobre
Le 12, publication de l’enquête de Claude de St Etienne dans Hebdo de Toulouse
1977
Un accident de la route (mortel) a lieu près du lieu de l’observation de Cussac.
Luc Bourdin (L.D.L.N.) rencontre François, alors étudiant à la faculté de Clermont
1978
Les 18 et 19 avril, quatre enquêteurs du G.E.P.A.N. se rendent à Cussac.
1979
Ch. Caudy et son épouse rencontrent les parents de François et Anne-Marie DH
1983
=> Juillet
T. Pinvidic, J-P Grangeon et B. Méheust débutent une contre-enquête (5) qui se terminera en 1985.
III. Analyse du témoignage et de son éventuelle déformation dans les média et les revues ufologiques
Afin de voir si l’existence et l’influence de « faux souvenirs » (rapportés, lus ou entendus, déformés puis appropriés par les enfants) sont avérées, nous allons comparer un enregistrement et cinq articles (3 parus dans la presse et 2 dans des revues spécialisées) qui ont relaté les événements. Seuls les articles les moins connus seront repris intégralement :
A) L’interview de Radio Luxembourg le 30 Août 1967 (date de diffusion ?)
C. Pavy, enquêteur du G.E.P.A., a obtenu l’information par sa sœur qui travaillait à Radio Luxembourg (aujourd’hui RTL = Radio Télévision Luxembourg). Elle lui mettait de côté tout ce qui pouvait l’intéresser. A l’écoute de l’enregistrement, il constate que la conversation téléphonique semble avoir subi plusieurs coupures. Elles sont signalées ci-dessous par des points de suspension. L’identité de la première personne que l’on entend n’est pas donnée. Je la nommerai Mme X. Seuls quelques privilégiés avaient le téléphone autrefois. On téléphonait le plus souvent au bureau de poste (La Dépêche d’Auvergne du 12/9/67 signalait d’ailleurs que les Cantaliens sont de faibles consommateurs de téléphone). On peut penser que c’est la dame de la poste qui répond en premier puis qu’elle envoie chercher le maire qui poursuit l’entretien. Il est aussi possible que Mme X soit tout simplement la mère des enfants.
Mme X : « Il aurait vu un engin de 2m de haut sur 2m de large à peu près, alors il aurait vu 4 petits êtres autour de l’appareil. Il a cru voir qu’ils étaient en noir ou c’était leur peau (…) Il a pas su, parce qu’il (…) D’après le gosse ? il était à une distance de 60 – 70 m, alors quand il a voulu s’approcher un petit peu pour pouvoir mieux voir, ils sont montés dans l’appareil et puis c’est monté en spirale, c’est monté en spirale et puis c’est parti tout à coup en ligne droite, ça a dégagé une odeur de gaz, de soufre (…)
RL : Et qu’est ce qu’on en pense au village ?
Mme X : D’après certaines gens, ils disent : « Oh ! Il faudrait le voir pour le croire » (…) Oui mais quand même le gosse, il a 13 ans et demi quand même, il va pas dire des choses qu’il a pas vues.
RL : Et vous, vous le croyez ou vous voulez le voir ?
=> Note : je pense qu’il faut comprendre «… le croire ? »)
Mme X : Pas moi (…)Il aurait pas dit, s’il avait rien vu… Mais je sais pas moi (…) D’après les journaux, ils disent bien, mais je l’ai pas vu, alors je suis comme les autres, un peu incrédule.
Le père des enfants : Oui, oui c’est bien moi le maire de Cussac à l’appareil. C’est mes enfants qui ont vu, un enfant 13 ans et demi, garçon, François, et une fille de 9 ans. Mes enfants étaient à la garde des troupeaux (…) Mes bêtes se sont presque affolées au départ de l’appareil. Il y a eu l’apparition vers 10h du matin, 10h et demi et les gendarmes ne sont venus qu’à 4h et il y avait encore cette odeur de soufre.
RL : Est-ce que vous y croyez, vous-même ?
Le père des enfants : Oui, oui, oui monsieur, oui j’y crois parce que j’ai confiance, et moi je ne mens pas et réellement mes enfants ont vu cet appareil.
Si l’interview a eu lieu le lendemain de l’observation, il est étrange que Mme X dise : « d’après les journaux ». Un article a peu de chance d’être paru (et parvenu) le lendemain dans cette petite localité. Il est possible que l’interview ait été diffusée quelques jours plus tard, le temps de faire un montage et de rajouter les commentaires d’une autre personne (journaliste, correspondante, donc pas la mère des enfants) de la région. Elle commence par présenter les faits les plus marquants puis on termine par l’interview qui donne peu de détails mais a le mérite de faire parler le père des témoins, maire de surcroît.
B) La Montagne du 1er septembre 1967
L’article paru en page 5 se veut accrocheur. Il utilise d’entrée des termes «parlants » pour le lecteur comme « martiens » ou « soucoupe volante » (alors que les témoins ne les ont mêmes pas mentionnés) et précise en caractères gras le prénom et l’âge des témoins. On a l’impression que l’on va nous raconter un conte, celui des enfants et des «petits hommes noirs(6)». Le récit en aurait été fait à un correspondant du journal, ce qu’ont confirmé les enfants. On peut néanmoins s’en étonner car le jour précis de l’observation n’est même pas mentionné (alors que l’on nous indique l’heure) et le nom de famille des témoins semble mal orthographié (****euch devient ****uech).. Toujours est-il que les quatre « petits hommes noirs » (du titre) deviennent très vite quatre « petits nains » (comme dans un conte) et le garçon croyant avoir affaire à des enfants aurait crié : « Vous voulez bien venir jouer avec nous ? » Les quatre « nains » s’enfuient comme le lapin d’Alice au pays des Merveilles. En dehors de cela, la forme de l’engin n’est pas décrite et le « muret » devient « un mur ». On retiendra le passage suivant : « Les quatre nains semblaient vêtus de combinaisons noires et portaient des poils sur la face. Ils plongèrent tête première dans cet appareil, de quatre mètres de large sur deux mètres de hauteur. Anne-Marie en vit ressortir un qui semblait avoir oublié quelque chose. Puis l’engin s’éleva et disparut dans le ciel ». La direction dans laquelle il va disparaître n’est pas non plus indiquée. C’est là aussi étonnant car le journal aurait pu lancer un appel aux lecteurs. D’après l’auteur, l’observation a été diversement accueillie dans le village de Cussac. Il précise que de nombreux voisins travaillaient dans les champs, sans plus de commentaire. Pourquoi ce journaliste ne mentionne-t-il pas les témoins indirects de l’observation, surtout qu’à l’époque on ne se gênait guère pour mettre le nom des témoins à la Une? Il précise juste qu’ « ils n’ont rien entendu (remarque: il n’a donc pas rencontré l’agriculteur qui, on le saura plus tard, a croisé les enfants, ou le garde champêtre) et nulle part on n’a trouvé de traces… mais répondent les enfants, l’endroit a été piétiné, entre-temps, par les vaches ». A la fin, l’auteur part du principe que des enfants ignorent tout de la science fiction et se demande s’ils ne se sont pas raconté un joli « conte de fée » à la mode du XXe siècle, dans lequel les martiens remplacent les lutins d’autrefois. Tout ceci est assez étrange. L’article nous donne des détails très précis contestés bien plus tard par les témoins eux-mêmes comme les poils sur la face, en oublie d’autres plus importants (la date de l’observation) et parfois même se trompe (sur l’orthographe du nom des témoins). Aucun effet secondaire (éblouissement, fatigue les jours suivants, etc.) sur les enfants n’est mentionné alors que le journaliste s’étant rendu sur place après l’observation aurait dû en avoir connaissance? Ce correspondant a-t-il rencontré l’adjudant AS (commandant par intérim de la compagnie de gendarmerie de St Flour dont le nom est aussi mentionné, rien sur l’autre Cie ?) ou interrogé (par téléphone ?) un de ses hommes qui ne pouvait donner que des informations partielles puisqu’il n’y a pas eu de rapport écrit ? S’est-il aussi servi d’un enregistrement de la conversation téléphonique entre le reporter de « Radio-Luxembourg » et le père des enfants ? Cet article semble un peu bâclé. Se pourrait-il qu’il ait été écrit et publié avant le déplacement d’un journaliste de La Montagne ? Ce dernier aurait rencontré les témoins mais ne trouvant rien de plus à ajouter n’aurait finalement pas repris son article? Rappelons que le journaliste a eu au mieux 48 heures pour être informé de l’événement, se déplacer et écrire cet article avant la mise sous presse…

C) Paris Jour n° 2479 du samedi 2 et dimanche 3 Septembre 1967
C’est pourtant vrai : Martiens Auvergnats
François *****uech, treize ans, en est encore tout bouleversé, et c’est en sanglotant qu’il a raconté aux villageois de Cussac (Cantal) ce qui leur est arrivé à sa sœur et lui alors qu’ils gardaient les vaches. A l’entrée du champ, ils ont aperçu des nains vêtus de combinaisons noires. Les prenant pour d’autres enfants, ils ont voulu s’approcher et faire connaissance avec eux, mais ils se sont enfuis. François ajoute : « Je suis monté sur le talus et je les ai vus plonger dans une machine qui m’éblouissait. Elle n’est pas partie tout de suite car un nain en est ressorti, a fait quelques pas avant de plonger de nouveau. Alors tout a disparu. Ce qu’il y a de sûr, c’est que toutes les vaches se sont mises à beugler. » Le papa de François, qui est maire de la commune, a fait venir les gendarmes. Ceux-ci n’ont recueilli aucun autre témoignage. Mais ils ont appris qu’on a raconté dans le pays, il y a quelque temps, qu’une forte prime serait remise à celui qui, le premier, rencontrerait les martiens.
(Extrait de Paris Jour n° 2479, page 15, du samedi 2 et dimanche 3 Septembre 1967)
On retrouve encore la même erreur dans l’écriture du nom de famille. On note néanmoins de nouveaux éléments comme les enfants qui auraient pleuré, les nains vêtus de combinaisons noires qu’ils « aperçurent à l’entrée du champ ». On ne signale toujours pas que l’observation a lieu de l’autre côté d’une départementale mais cela nous donne déjà une vision différente des lieux. Il est marqué par la suite que « les prenant d’abord pour d’autres enfants ils s’approchèrent d’eux ce qui provoqua aussitôt la fuite ». Aucune mention de «l’appel » noté dans l’article de La Montagne. Le reste du récit semble identique mais la grosse différence c’est que l’on cite cette fois-ci le garçon. « Puis tout a disparu » peut donner une impression de rapidité. On a l’idée (fausse) que l’objet a disparu sur place. On peut aussi penser que la « machine » étant éblouissante, au bout d’un certain moment, il n’arrive plus à l’observer. Il y a peut-être un peu des deux. L’enfant utilise par la suite l’expression « ce qu’il y a de sûr », ce qui sous-entend que quelqu’un a déjà dû mettre en doute sa déclaration, ou qu’il a peur qu’on ne le croie pas. Peut-être, mais même si tout cela peut ressembler à un rêve (ou un cauchemar), il sait que les vaches ont aussi réagi à l’observation. Il s’est donc bien passé quelque chose. Il ne pense pas à ajouter : « Ma sœur était là, elle a vu aussi… ». Quant au terme « nain », il semble finalement avoir bien été employé par l’un des témoins. L’article termine en précisant qu’aucun autre témoin (ni agriculteur, ni garde champêtre ?) n’a été trouvé. Il s’achève en signalant qu’une forte prime récompenserait celui qui le premier rencontrerait un martien.
D) L.D.L.N. n°90 (septembre-octobre 1967)
Si le titre est plus précis (Cussac 29 août 1967), l’introduction (Saint-Flour…), le même «****uech » et les « nains » font penser que l’auteur a eu entre les mains l’article de La Montagne. Le reste de l’article est quasiment identique à celui de Paris Jour. Les enquêteurs semblent donc ne s’être
toujours pas déplacés à Cussac avant parution de l’article.
E) Hebdo, édition Toulouse, du 12 octobre 1968
Début : « EXCLUSIF : Voici un récit étrange. Il résulte d’une enquête effectuée dans le Cantal par M. de St Etienne, enquêteur n°25, travaillant en collaboration avec la revue Lumières Dans La Nuit. Nous nous garderons de l’assortir de commentaires, nous bornant à le reproduire fidèlement, en remerciant M. Lagarde de nous avoir confié ce document absolument inédit. Mais il en a bien d’autres. »
Claude de St Etienne est présenté comme « l’enquêteur n°25 » dans l’Hebdo de Toulouse. Il est donc possible qu’il soit la 25ème personne ayant été déclarée enquêteur par la revue L.D.L.N.. Dans son livre Mystérieuses soucoupes volantes (1974) et dans l’article paru dans L.D.L.N. N°233-234 (1983), F. Lagarde précise entre parenthèses: « Publication dans Hebdo de Toulouse du 12-10-68 par nos soins ». On a donc bien confirmation que c’est lui (au nom de L.D.L.N.) qui a remis au journal l’article que lui aurait transmis Claude de St Etienne(7).
On découvre un an après que François a été l’objet de moqueries suite à cette observation. Aucune allusion par contre à d’éventuelles critiques envers sa sœur ( ?). A noter que le peu de crédit accordé par les habitants du village au récit des deux jeunes témoins pourrait être dû au fait que les villageois n’aiment pas trop être dérangés par les gens de la ville. Le prêtre du village a peut-être aussi suggéré à ses paroissiens que tout cela les éloignait des croyances religieuses(8). On peut le penser puisque François laissa entendre en 1983 à T. Pinvidic que certaines instances religieuses avaient rejeté cette histoire de façon véhémente. Le phénomène ovni n’a jamais fait l’unanimité, pourquoi les habitants de Cussac dérogeraient-ils à ce constat? L’article quant à lui reparle de la prime et précise que cette annonce a été faite par une radio régionale, depuis Clermont-Ferrand.
Le reste de l’article est, cette fois-ci, très détaillé
« Le jeune F, 13 ans, gardait les vaches avec sa sœur A.M, 9 ans, aux Tuiles, pré situé à environ 800 m de l’entrée du village, en bordure de la route D 57 reliant les Ternes à Pont-Farin. Vers 10h30, les dix vaches voulurent subitement passer dans un pré voisin où paissaient une trentaine de bêtes. F. se retourna pour appeler son chien de façon à empêcher les bêtes de partir. En se retournant, il aperçut, entre les buissons, de l’autre côté de la route, à environ 70 mètres, dit-il « quatre petits hommes noirs » qui lui tournaient le dos. F. les prit pour des enfants car ils ne dépassaient pas 1,10m de hauteur. Trois d’entre eux étaient debout, dont deux face à face comme s’ils se parlaient, et le troisième tenait un objet brillant à hauteur de tête, F. dit : « J’avais l’impression qu’il me regardait dans un miroir ». Le quatrième petit homme noir était à genoux, à côté de celui qui tenait le miroir. F. alerta sa sœur qui était à une trentaine de mètres en retrait pour lui montrer la scène ; puis il se retourna vers les petits êtres qui n’avaient pas bougé et leur cria : « Venez jouer avec nous ». Pour toute réponse, les petits êtres s’enfuirent. F. monta instinctivement sur le petit muret de cinquante centimètres qui limite le pré et à côté duquel il se trouvait et regarda les petits nains. Il remarqua leur tête légèrement allongée, avec un menton pointu et leurs bras légèrement plus longs que la normale ; de plus, ils étaient minces et avaient un renflement à peu près au niveau des oreilles, ce qui leur faisait comme une barbe bouffante. A.M confirme cette description. Les petits êtres n’avaient fait que quelques pas lorsque F. découvrit soudain, à moitié caché par un buisson, un engin situé dans le même pré et devant lequel les petits hommes se détachaient maintenant : « C’était un rond en métal brillant mais pas lumineux », déclare F. Sa sœur ajoute : « Il avait trois béquilles ». F. précise : « Moi, je ne peux pas dire, je ne les ai pas vues, mais A.M dit qu’elles étaient là ». F. évalue le diamètre de l’engin à environ trois mètres. « Les petits hommes sont entrés chacun leur tour dans la machine, par le dessus, après s’être soulevés en l’air et en plongeant la tête dedans, la tête la première ». F. ajoute : « Lorsque le troisième a plongé, on a bien vu ses pieds palmés, comme les canards. Je l’ai fait remarquer à A.M ». Sa sœur acquiesce. F. poursuit : « Le quatrième a plongé. L’appareil s’est mis en marche : on entendait un faible sifflement, un peu aigu, et la machine a commencé à s’élever lentement, en spirale. A ce moment, elle était environ à trois mètres, un petit homme est ressorti de la machine toute ronde ; il est redescendu par terre ; s’est baissé pour ramasser quelque chose et est remonté tout seul en l’air ; la machine avait continué de monter en spirale ; elle était environ à 20 mètres. Il a plongé. La machine est devenue éblouissante, aveuglante, et est partie tout droit dans le ciel, au dessus du Plomb. Après son départ, on sentait comme une odeur de soufre. Je n’ai pas pu la regarder plus longtemps, j’avais mal aux yeux, je pleurais. Alors je me suis occupé des vaches parce qu’elles s’étaient toutes mises à beugler. Le chien aboyait. Et puis les trente vaches du voisin sont venues rejoindre les nôtres. On est rentrés tout de suite ce jour là. » (…)
L’enquêteur précise que le temps de l’observation a été évalué à une minute au maximum. Le père des enfants précise que F. n’a pas dormi pendant deux nuits. Il a été choqué quand même. L’enquêteur pense à des entités portant des casques et remarque la ressemblance avec les êtres noirauds ayant une marche quasi aérienne du cas d’Arc-sous-Cicon »
Comme je l’ai signalé un peu plus haut, F. Lagarde précise dans son livre que M. DH signe un texte après avoir lu « la relation qu’en a fait M. de Saint-Etienne ». Nous avons ici l’explication de ladite relation. Claude de St Etienne a dû faire remarquer à M. DH qu’une autre observation avait eu lieu avant celle de ses enfants, celle de Arc-sous-Cicon. Il pense qu’il pourrait y avoir un rapport entre les deux observations. Les enfants n’étaient donc pas en situation d’attente d’un événement insolite ou d’un débarquement d’êtres étranges.
Les enfants n’utilisent pas le mot « saut » qui leur est pourtant plus familier (saute-mouton, sauter, etc.) mais « se soulever en l’air ». Cela semble prouver l’étrangeté de cette action, car si un être humain peut se soulever en l’air en sautant, très vite il retombe. Je reviendrai en détail sur cet article
dans le chapitre suivant.
F) L.D.L.N. n°253/254 (juillet/Août 1985)
Dans ce numéro, il n’est pas noté que François se retourne, mais qu’ « il aperçoit alors ce qu’il croit être quatre enfants du village ». Comme dans l’article précédent, il leur crie de venir jouer avec lui et sa sœur, mais dans cette version, il ne provoque aucune réaction. Les quatre inconnus semblent prendre conscience de lui lorsqu’il monte sur le muret. La « machine » est remplacée (dans le texte) par une « sphère » de couleur argentée qui a environ 2m50 de diamètre et aucune ouverture visible. Les petits hommes noirs (comme dans l’article de La Montagne de 1967) ont des bras longs et fins, les jambes courtes, ils portent une combinaison moulante, brillante et noire et ils ont le crâne pointu. Au lieu de « se soulever en l’air », « ils se propulsent à la verticale ». Le quatrième des êtres rejoint la sphère alors qu’elle est déjà à une dizaine de mètres d’altitude. « Les » gendarmes noteront l’odeur de soufre et le soir François aura les yeux larmoyants.
Premières constatations :
Les trois derniers articles (L.D.L.N. N°90, Hebdo, édition Toulouse et L.D.L.N. N°253/254) ont été écrits par des enquêteurs de la même revue et pourtant on distingue des différences. L’une d’entre elles tient à la description de la machine. Elle devient une sphère, entre le numéro de L.D.L.N. de 1968 et celui de 1985. Ce changement de terme est probablement dû à l’arrivée de Joël Mesnard aux commandes de la revue Lumières dans la nuit (L.D.L.N) en 1985. Rappelons que J. Mesnard a enquêté sur le cas de Cussac en 1968. Le compte-rendu de l’enquête est paru dans Phénomènes spatiaux n°16 de juin 1968 (pages 27 à 32). Le terme « sphère » y était déjà employé. On sait que Joël Mesnard a été professeur de mathématique et il est assez logique qu’il aime employer ce terme qui, d’ailleurs, a été donné par l’un des témoins (mais nous en parlerons dans le chapitre suivant). Certains noteront que F. Lagarde utilise aussi le terme « sphère » en 1974 dans son livre Mystérieuses soucoupes volantes, mais il ne le fait qu’une fois et à la fin (au moment de la « disparition ») comme pour mettre un peu de distance avec le G.E.P.A.. On peut penser qu’un proche collaborateur de L.D.L.N. pouvait avoir accès à la revue Phénomènes Spatiaux (d’ailleurs le fait que J. Mesnard vienne plus tard y travailler…) beaucoup plus facilement qu’un enquêteur comme Claude de St Etienne. Dans l’ensemble, tous ces articles sont assez identiques et les propos des enfants ne semblent pas se contredire mais la presse orthographie mal le nom de famille des témoins, et donne parfois des titres à sensation (dans les deux cas La Montagne ou Paris Jour). On soulignera que la Montagne indique une taille qui ne correspond pas à une sphère (4m de large sur 2m de hauteur). Je reviendrai plus loin sur cet article. Lumières dans la nuit dans son premier article se contente de recopier les informations tirées dans la presse et fait les mêmes erreurs. Pour finir, c’est un enquêteur de L.D.L.N. (Claude de St Etienne) qui fait découvrir aux témoins le cas d’Arc-sous-Cicon.
L’erreur est toujours d’actualité
Les erreurs dans la presse et chez les ufologues sont très nombreuses. J’en citerai sept parmi tant d’autres :
Dans Les Mystères de l’Est n°2 (1996), page 2/24 : « Les premiers enquêteurs furent messieurs Ch. Caudy et Couzinie de L.D.L.N., puis J. Mesnard et Pavy du G.E.P.A. ». Cette affirmation est doublement fausse (voir chapitres IV et VI)
Le site http://benzemas.zeblog.com où le cas est situé en Dordogne, erreur que j’ai signalée au site le 9/1/2007.
Le site http://www.cielinsolite.fr/spip.php?article22 où l’on trouve au moins deux erreurs : la première concernant une trace signalée dans l’article de Phénomènes Spatiaux (de 1968), ce qui est faux ; la seconde est dans la phrase : "Précisons que les gendarmes, à l'époque des faits, avaient penché pour un appareil de l'ALAT. L'information provient d'une lettre de Jean-Jacques Vélasco lui-même à Eric Maillot, dans un courrier de 1996". Le courrier en question est paru dans les "Mystères de l'est" n°2 (1996), la revue du C.N.E.G.U. J-J. Vélasco y "présume" que les gendarmes ont vérifié. Ce ne sont donc pas les gendarmes eux-mêmes qui font cette affirmation! J’ai signalé ces erreurs à Grégory
Gutierez le 24/1/2007.
Coté presse, on pouvait lire dans un article du Journal du Dimanche du 31 décembre 2006 : «Ces petits hommes habillés de noir que deux enfants ont vu descendre d’une machine toute brillante à Cussac (Dordogne), en 1966… ». J’ai souligné les deux erreurs commises par le journaliste. Il est possible que la première soit dûe à un manque de précision lors de l’interview (de J. Scornaux) car il y a plusieurs Cussac en France. La date par contre ne peut être qu’une erreur de retranscription.
Côté ouvrages, citons au moins 2 erreurs et une invraisemblance dans le texte préparatoire des OVNI du CNES, trente ans d’études officielles (1977-2007) de David Rossoni (archiviste, diplômé en histoire), Eric Maillot (professeur des écoles, collaborateur du Laboratoire de zététique - université de Nice-Sophia Antipolis) et Eric Déguillaume
(généalogiste, diplômé en histoire des sciences, président de l'Observatoire zététique).
« Assis derrière un muret de pierres sèches, ils jouent aux cartes…Médor se met à aboyer. Le jeune garçon se lève et se retourne pour lui ordonner de les faire revenir (les vaches)…il aperçoit alors…quatre petits hommes… » Difficile ! S’il se retourne pour cette raison et voit les « quatre petits hommes… » cela signifie que le chien se trouve de l’autre côté du muret, sur la route ( ?). L’erreur a été signalée le 10/5/2007.
« Ils (les enfants) ont toujours été interrogés ensemble jusqu’à l’intervention du G.E.P.A.N. » Faux ! Les enquêteurs du G.E.P.A. interrogent d’abord la fille, puis le garçon qui était pendant ce temps aux champs. La fillette ne s’est donc pas effacée dans ses déclarations devant son aîné. L’erreur a été signalée le 10/5/2007.
« Il (François) n’y emploie alors le mot sphérique qu’une seule fois en réponse à un questionnaire ( fin 1967) formé de cette association proposant une liste de formes au choix (sphérique, conique, parallélépipédique…) » Ce terme apparaît bien dans le questionnaire-type du G.E.P.A. mais C. Pavy avait préféré personnaliser (et simplifier) son courrier du 17 septembre 1967. En définitive, le terme « sphérique » n’y apparaît pas. L’erreur a été signalée le 10/5/2007. Les auteurs en ont pris acte dans l'édition papier.

IV. Reconstitution des événements du mardi 29 Août 1967
Introduction
Je vais m’appuyer sur l’une des plus anciennes enquêtes, celle du G.E.P.A. (1968), afin de tenter de reconstituer les événements précis de cette observation. A cette fin, je vais d’abord essayer de tracer l’historique de l’enquête menée par C. Pavy et J. Mesnard.
J’avais précisé un peu plus haut comment C. Pavy avait obtenu une copie - grâce à sa sœur - de l’interview du père des enfants. Il s’est aussi procuré l’article de Paris Jour du 2-3 septembre 1967. Le 17 septembre 1967, il décide d’écrire au maire de Cussac au nom du G.E.P.A. Il précise qu’il ne s’agit pas de faire un article à sensation mais d’essayer de comprendre objectivement et sans parti pris le phénomène dont ont été témoins ses enfants. Sa lettre comporte 42 questions. Dans les documents conservés par C. Pavy on trouve un questionnaire-type (62 questions) qui n’a pas été utilisé car l’ufologue détenait déjà quelques informations par les média (ex : nombre d’objets, etc…).
Le 16 novembre, n’ayant pas de nouvelles, il poste une nouvelle lettre au maire en ajoutant « M. Delpuech », reprenant sans le savoir l’erreur d’orthographe de Paris jour. Il fait une autre erreur dans son courrier en indiquant que l’observation a eu lieu le 31/8 (hypothèse : l’enregistrement RTL a été diffusé le 1er septembre et C. Pavy pense que l’observation a eu lieu la veille). En pension, le garçon ne peut lui répondre.
Ce n’est que quatre mois plus tard que C. Pavy reçoit un courrier daté du 3 mars 1968 et rédigé par « François DH ». Apparaît près de son nom, l’âge qu’il a à cette date : 14 ans. Il confirme (en son nom et celui de sa sœur) les informations portées dans son courrier et dit joindre un croquis (voir à ce sujet, un peu plus loin, la question n°41). Il ajoute : « Au sujet de la question 38 nous n’avons rien reçu à ce sujet ». Il termine cette première page en écrivant : « Au sujet de la question 39, Radio Luxembourg nous avait questionnés par téléphone mais nous n’avons pas entendu la déclaration retransmise sur les ondes. Pourriez- vous nous la faire parvenir ? »
Je fais une pause dans le récit afin de voir en détail l’histoire de la « prime »
=> La prime :
Question n° 38 du G.E.P.A. (septembre 1967) : « A quoi correspondent les rumeurs rapportées par les journalistes sur une forte prime qui aurait été promise à qui rencontrerait le premier un martien dans la région ? »
A cette question, François DH répond en deux parties :
=> sur la première page du courrier, il avait donc noté : « Au sujet de la question 38 nous n’avons rien reçu à ce sujet »
=> sur la page originale du questionnaire, il avait ajouté : « Radio Clermont FD avait annoncé cela » (Clermont FD = Clermont-Ferrand)
Si C. Pavy a posé cette question, c’est qu’il a lu Paris jour qui précisait (voir un peu plus haut) : « Le papa de François, qui est maire de la commune, a fait venir les gendarmes. Ceux-ci n’ont recueilli aucun autre témoignage. Mais ils ont appris qu’on a raconté dans le pays, il y a quelques temps, qu’une forte prime serait remise à celui qui, le premier, rencontrerait les martiens ». Dans Les Mystères de l’est du C.N.E.G.U. n°10 (2005), Eric Maillot, qui a eu une copie des archives de C. Pavy, pose la question : « Le garçon était-il informé, par le bouche à oreille, de cette prime offerte au premier qui observerait des « martiens » ? Nul ne l’a jamais demandé... Une espérance (illusoire et innocente) de gain liée à l’observation d’un fait insolite aurait pu constituer une motivation inconsciente (une attente de PAN) chez un jeune garçon intelligent qui désirait manifestement s’extraire de sa condition sociale (et qui y réussira étant adulte). »
On note que dans sa réponse, François DH ne mentionne pas le mot « prime » et préfère même répéter deux fois le mot « sujet » à la place. Il écrit : « Nous n’avons rien reçu », il s’associe donc à sa sœur ou à sa famille. Il aurait pu écrire : « Je n’ai rien reçu, est-ce normal ? » mais non, au contraire, il ne pose pas de question, on sent de la distance. Peut-être s’est-il offusqué ? Imaginons, néanmoins, qu’au moment où il répond au courrier de C. Pavy, il soit intéressé par cette prime : comment lui en vouloir puisqu’il est le seul à ne rien gagner dans cette histoire ? On se moque de lui, la presse, les revues ufologiques, et plus tard, des écrivains - même s’ils ne consacrent au sujet que quelques lignes - vendent son histoire…et gagnent de l’argent. Contrairement à ce qu’écrit E. Maillot, dès 1967, un ufologue, C. Pavy, questionne les témoins et aborde le sujet de la prime. Bien sûr, C. Pavy n’a peut-être pas osé être plus précis et demander crûment : le saviez vous avant ? Comment lui en vouloir ? Il sait que le père des enfants n’est pas pauvre (au moins propriétaire de vaches, peut-être d’un terrain…) et surtout maire ! C. Pavy a rencontré l’institutrice de François qui le décrit comme un enfant « terre à terre, peu imaginatif ». C’est d’ailleurs ce pragmatisme qui lui permettra finalement de réussir dans la vie, grâce à la seule voie qu’on connaisse à l’époque : le travail, les études. S’arracher à sa condition, gagner de l’argent grâce à la célébrité et aux média, c’est une utopie beaucoup trop moderne pour 1967 (pas encore de téléréalité, de chanteurs préformatés ou de footballeurs millionnaires). François apparaît d’ailleurs plutôt comme un enfant introverti, incapable de se mettre volontairement sur le devant de la scène : son exposition médiatique aura des retombées désastreuses justement parce qu’il aurait été incapable de vouloir jouer les vedettes. Aucune théâtralité dans son comportement : il n’est en rien fier de ce qu’il a vécu. Il ne cherchait pas à voir ce qu’il a vu.
On notera, pour terminer, que le nom de la radio régionale qui aurait parlé de cette prime n’est pas connu. Il ne devait pourtant pas y en avoir beaucoup en 1967. T. Pinvidic, qui a enquêté sur ce cas, pense que cette prime serait en fait un « million » offert treize ans plus tôt par la revue Radar. Elle a pu être évoquée, en 1967, par cette radio locale qui – au vu des événements de l’été (voir « chronologie ») – voulait ainsi rappeler l’hystérie soucoupique de 1954. J’ai néanmoins trouvé un court article dans La Dépêche d’Auvergne du vendredi 4 août 1967. Il est intitulé « Soucoupes volantes ». Il signale que le mardi 18/7, vers 1h du matin, la chaleur poussant les badauds à la contemplation du ciel, nombreux sont ceux, en des endroits variés, qui ont vu des soucoupes volantes. « Hélas », écrit le journaliste, les témoignages étaient si précis qu’ils ont permis d’identifier de simples phénomènes météorologiques. Le journaliste conclut que « la science s’empare d’elles (les soucoupes) à leur tour pour les restituer à la physique et à la chimie ». On ne peut que noter le désappointement du journaliste (« Hélas ») qui regrette presque que l’on ait trouvé une explication. Rien qui puisse faire fantasmer de jeunes enfants dans cet article. Quant à la veillée de L.D.L.N. du 22 et 23/8/67, il est très peu probable qu’elle ait pu avoir un impact sur la famille DH, d’autant plus que la famille n’avait accès qu’à très peu d’informations. En comparaison, une nuit de veillée « nationale » organisée par L.D.L.N. en collaboration avec France Inter et signalée dans la presse écrite le 23/3/74 n’avait même pas provoqué une hausse spectaculaire des observations. C. Poher ajouta d’ailleurs que l’explication largement médiatisée d’une observation insolite, un mois plus tôt, par une rentrée spatiale banale aurait dû normalement inciter les témoins de Cussac à se taire, s’ils avaient lu une presse plus ouverte aux questions ufologiques.
Je reviens au récit…
En avril 1968, profitant des congés de Pâques pour voir les enfants, Joël Mesnard et Claude Pavy se rendent à Cussac pour enquêter. Ils n’ont prévenu personne, les enfants ne peuvent donc pas « réviser leur histoire ». Ils se présentent d’abord à la gendarmerie où ils ont confirmation de ce qu’ils ont déjà appris des média (et des enfants par courrier). Ils se rendent ensuite à Cussac à la maison du maire (père des témoins). Elle est simple, sol en terre battue, pompe à eau, lits dans le mur. Ils y rencontrent Anne-Marie, son petit frère André et leur mère. Ils sont bien accueillis. Les deux enquêteurs interrogent - à tour de rôle - la petite fille durant une heure environ. A la fin de l’entretien, Anne-Marie les emmène chercher son frère François, qui travaille aux champs avec son autre frère Raymond (Remarque : on ignore si la reconstitution sur place a eu lieu à ce moment-là. On peut présumer qu’ils retournèrent après sur les lieux pour prendre des photos et faire des croquis, aidés des enfants). Ils reviennent ensuite au foyer familial et interrogent le garçon de la même façon que sa sœur. Aucun des deux enfants ne s’est coupé dans son récit. Les enquêteurs ne remarquent aucun regard de connivence entre eux. Jamais ils ne paraissent embarrassés par les questions ; ils paraissent très tranquilles. Ils ne pensent plus à leur observation, elle est loin de leurs préoccupations. Les enquêteurs apprennent par la suite que M. DR, un habitant de Cussac, alors qu’il était en train de remuer du foin dans son grenier à environ 500m de là, avait entendu le sifflement émis par la « machine ». Ils ne le rencontrent pas. Ils ont aussi l’occasion de voir l’institutrice des enfants qui les décrit comme étant « terre à terre » et peu imaginatifs. François est en quatrième, il lit les trésors de la poésie française, Georges Sand et Chateaubriand(9), qui doivent correspondre à son programme d’études. Les enquêteurs demandent aux enfants qui est venu les interroger. Ils répondent n’avoir rencontré que le reporter de la Montagne et la gendarmerie (donc pas encore L.D.L.N.).
Avant de partir, les enquêteurs laissent un exemplaire de la revue du G.E.P.A. au père des enfants.
Le 15 mai, C. Pavy poste au Maire de Cussac le texte de l’article et des photographies prises au mois d’avril. Il lui demande l’autorisation de publier le texte dans le prochain bulletin du G.E.P.A.
Il rappelle que le but n’était pas de ridiculiser ou de discréditer ses enfants vis à vis des lecteurs.
Le 28 juin, le maire donne son accord pour la publication du reportage et signe ainsi que ses deux enfants.
Le 12 juillet, C. Pavy remercie le maire et lui envoie 3 bulletins du numéro dans lequel est publiée l’enquête. Il signale de légères modifications dans le texte. C’est C. Pavy qui a rédigé l’article, R. Fouéré a fait la mise en page et les quelques changement. En comparant les deux articles, on remarque qu’à l’origine, le passage où le garçon lance un appel aux 4 inconnus se trouvait avant leur description. Il a aussi été ajouté qu’à une concentration suffisante, l’ozone présente une odeur pouvant être confondue avec celle du souffre et qu’une odeur d’ozone a déjà été signalée dans quelques cas d’atterrissage. Un passage où l’on avait écrit qu’il ne doit pas y avoir plus de 2 000 personnes en France à lire des publications spécialisées (sur le phénomène) devient : « Nous sommes de plus en plus nombreux ». On notera que l’article ne mentionne pas que les enquêteurs avaient déjà correspondu avec les enfants avant le déplacement.
Additif : Aujourd’hui C. Pavy a délaissé l’ufologie pour la musique (guitariste électrique). Il déclare que ce que l’on peut lire dans Phénomènes Spatiaux est conforme à ceux que l’on savait à l’époque. Rien n’a été arrangé. Il est convaincu que les enfants n’ont rien inventé. Leur témoignage est quasiment identique. D’après lui les témoins ne tiennent plus à être dérangés pour cette affaire. Même s’il a transmis des documents à E.Maillot (via le C.N.E.G.U.), il ne croit pas à l’hypothèse hélicoptère. Je tiens aussi à préciser que M. DR a déclaré en 1979 au G.E.PA.N. qu’il n’avait jamais été interrogé auparavant, la revue du G.E.P.A. a donc cité son nom sans le consulter. Cet homme avait remarqué, vers 11h, un « sifflement mélangé à un ronflement » qu’il n’avait jamais entendu auparavant. Ce bruit a disparu aussi brutalement qu’il était apparu. Le G.E.P.A.N. a estimé, lors de la reconstitution, la durée du sifflement à 10 ou 12 secondes.
Le questionnaire
Le questionnaire (Q) du G.E.P.A. comptait 42 questions. J’ai rassemblé les questions et les réponses données par écrit le 3 mars 1968 dans 6 parties correspondant à cette journée particulière. La répartition chronologique de ces questions peut donc varier suivant la partie où elles ont été classées. Les 34 premières ayant été recopiées partiellement, par François DH, dans sa lettre, j’ai souligné les parties du texte qu’il avait reprises en répondant au G.E.P.A. (les autres ont peut être été négligées pour gagner du temps). Sous certaines questions, j’ai ajouté de nouvelles informations obtenues lors du déplacement des enquêteurs à Cussac ainsi qu’un commentaire personnel.
A/ Phase de découverte
Q1. Date : « 29 août 1967 »
Q2. Heure exacte de l’observation : « 10h30 du matin environ »
Q3. Etat du ciel : « beau temps, soleil »
Q4. Clarté ambiante et visibilité : « clarté très bonne »
Q5. Le temps était-il orageux ? : « non »
Q6. Vent (force et direction) : « léger vent d’ouest »
=> Commentaires personnels :
Dès 8 heures du matin, François et Anne-Marie DH mènent quelques vaches à la pâture que possède leur père, à peu de distance de l’entrée du village. Les enfants sont accompagnés d’un petit chien nommé Médor. Le travail aux champs n’intéresse pas vraiment François mais ce sont les vacances scolaires et il faut bien se rendre utile. Les enfants passent une grande partie des deux premières heures à jouer, notamment aux cartes, tout en surveillant les vaches. Ils voient défiler un certain nombre de voitures dont celle d’un parent qui les salue au passage. Ils décident de s’asseoir non loin du muret qui longe la départementale et profitent du soleil matinal. Soudain, l’un des enfants remarque que les vaches sont agitées. Le chien aboie, lui signalant qu’une vache s’apprête à franchir un muret. Elle risque de s’estropier. François se lève. La plupart des ouvrages qui relatent cette partie de l’histoire rapportent qu’il « se retourne » et aperçoit, de l’autre côté de la route, ce qu’il croit tout d’abord être quatre enfants, derrière une haie. Cette affirmation pose problème car si l’on regarde le dessin du G.E.P.A. ci-dessous, on ne comprend pas pourquoi il se retourne, d’autant plus qu’aucun bruit particulier n’est signalé. Le troupeau ne se situe pas dans la direction où se trouvent les « quatre enfants ».


G.E.P.A. (1968) Dessin de Frédéric Bauche (2007)
Position par rapport au cadastre (10): Les enfants se trouvent sur la parcelle n°13 (de la section C1). La « machine » et les « inconnus » se trouvent sur la parcelle n°146 (de la section B1) => face à la parcelle n°130 (de la section B1).
Un document peu connu va nous permettre d’éclairer cette zone d’ombre. J.-M. Bigorne, célèbre enquêteur de L.D.L.N. m’a transmis un extrait d’un manuscrit intitulé Ufonautes en France rédigé par lui-même et J. Mesnard et qui n’a jamais été édité à ce jour. Il m’a confirmé par écrit que le passage intitulé « les diables de Cussac » (page 116 à 120) a été écrit par J. Mesnard. La photocopie montre que le document initial a été tapé à la machine à écrire. Il y est écrit :
« Soudain, les vaches s’agitent et entreprennent de franchir le muret qui délimite le champ. François contourne rapidement le troupeau et lui fait face pour lui barrer le chemin. C’est alors qu’un spectacle étrange s’offre à ses yeux : au-delà de la route, derrière une rangée d’arbres, quatre personnages de petite taille, entièrement noirs… »
A cet instant, il est logique que François puisse voir les personnages. Pourquoi J. Mesnard est-il le seul à mentionner cet épisode ? Il arrive que deux enquêteurs se complètent. On note d’ailleurs qu’il ne précise pas que François se lève. On peut penser que François n’a jamais beaucoup insisté sur ce moment précis car son père n’aurait peut être pas apprécié qu’il ait abandonné ce qu’il était en train de faire (arrêter les vaches) pour retourner aussitôt vers le muret afin d’observer les « personnages ». C’est faire preuve de négligence envers le troupeau, d’autant plus qu’au début, il pensait avoir affaire à des enfants.
Tout ceci explique que François et Anne-Marie se trouvent séparés d’une dizaine de mètres à ce moment-là, d’où la phrase de Fernand Lagarde dans son ouvrage : « Intrigué, il alerte sa sœur Anne-Marie qui se trouvait un peu en retrait, et, déjà heureux d’une diversion possible, s’avance dans son pré dans leur direction… ». En retrait par rapport à lui et aux vaches. C. Poher parle aussi de cette distance entre les deux enfants sur son site internet : « Les deux témoins ont observé depuis des positions distantes de 13 m, selon la reconstitution, ce qui permettait à l’un de voir ce qui était masqué par l’autre » (Hebdo parle de 30m). François va néanmoins laisser les vaches et se rapprocher du mur. Etant plus près (comme sur le dessin du G.E.P.A.), observant mieux les inconnus, il va comprendre très vite qu’il n’a pas affaire à des enfants. Notons par ailleurs que cela explique aussi pourquoi sa sœur a observé le phénomène plus longtemps que lui (voir les durées mesurées par le G.E.PA.N. en 1978). En effet, il a fallu quelques secondes à François pour contourner les vaches et rejoindre sa sœur. Temps pendant lequel il ne pouvait donc pas bien observer la scène comme elle.
B/ Phase d’observation
Questions sur l’objet
Q7. Distance estimée des enfants à l’objet posé : « 60 à 70 mètres »
Q8. Dimensions apparentes : « de 2m à 3m x 2m à 3m »
Q9. Forme de l’objet (discoïdale, conique, parallélépipédique, etc.) : « sphérique »
=> Il répond par une forme géométrique qui n’est pas citée en exemple dans la question. Peut-être faut-il y voir la volonté de renseigner au mieux C. Pavy. Il a probablement dû regarder dans un dictionnaire ou dans un cahier de géométrie la forme ressemblant le plus à ce qu’il observé. Cela ne l’empêchera pas de répondre peu de temps après à Claude de St Etienne (L.D.L.N.) avoir vu « un rond en métal brillant » et non une « sphère ». Il semble avoir ajusté la réponse à la question.
Q10. Eclat, si l’objet était lumineux, et couleur : « argent lumineux »
=> Lors de son déplacement à Cussac, C. Pavy voulu se faire préciser si l’objet semblait éclairé comme de l’intérieur ou rayonnant de lumière. La question lui semblait justifiée puisque François aurait dit « qui m’éblouissait ». C. Pavy soulignera au retour : « rayonnant de lumière ». Il sera répondu au G.E.PA.N. « argent bleuté » par Anne-Marie et « métallisé argent » , « très blanc » (teinte 441 blanchie, au pantone), entre l’argent et une housse de plastique » par François. Ce « blanc » de François fait immanquablement penser au dessin (N&B) de la revue du G.E.P.A. Un hasard ?
Q11. Netteté des contours : « oui »
Q12. L’objet paraissait-il solide ou nébuleux ? « Solide »
Q13. L’objet donnait-il l’impression de tourner sur lui-même ? -- pas de réponse –
=> La « machine » a-t-elle tourné sur elle-même ? On pourrait le penser lorsque l’on regarde les dessins des enquêteurs de 1968 et celui de l’hebdo de toulouse. A-t-elle décrit un rayon ? C’est difficile à dire. Si du moins c’est le cas, il ne fut pas aussi grand que le déclara le G.E.P.A.N. dans son rapport de 1978. J’y reviendrai plus loin.
Q14. Présentait-il des détails particuliers : antenne, taches, ouvertures, etc. ? : -- pas de réponse –
=> Lors de sa venue à Cussac, C. Pavy posera la question et notera par la suite : « Non »
Q15. L’engin posé paraissait-il reposer ? : « Oui »
à même le sol ? « Non »
sur des béquilles ? Si oui, combien ? disposées de quelle manière, quelle forme avaient-elles ? « Oui, mais manque de visibilité pour distinguer le nombre »
Lors de sa venue à Cussac, Claude Pavy ajouta, après avoir questionné Anne-Marie, qu’il devait y avoir 3 ou 4 béquilles, droites. Au bout de ces béquilles, des spatules (ou patins) assez petites (7 ou 8 cm de diamètre). Au final, on lira dans la revue : « un train d’atterrissage composé de 3 ou 4 béquilles droites munies de patins circulaires de 10 cm de diamètre ». En 1983, François estimait quant à lui qu’il s’agissait sans doute d’une illusion imputable à la rangée d’arbres qui les en séparait. Claude Pavy demanda aussi si les béquilles étaient visibles lorsque l’objet était en vol. La réponse fut « non, rentrées »
l’engin paraissait-il flotter à quelque distance du sol ? : « Non »
Si oui, paraissait-il parfaitement immobile ou était-il affecté d’un balancement quelconque comme, par exemple, un hélicoptère atterrissant ?
=> notons que nous avons la preuve par cette question que C. Pavy aborde le sujet, sensible 40 ans plus tard, de l’hélicoptère, dès 1967.
Q16. Mouvements, indiquer leurs directions, ou arrêts : « arrêts »
Questions sur les petits êtres
Q23. Combien étaient-ils ? « Nombre : 4 »
=> Le 4 ième (à genoux ?) était peut-être le plus petit. François l’a peut-être constaté lors du départ.
Q24. Etaient-ils tous semblables ? « Non »
Q25. Taille : « 1 mètre environ »
Q26. Comment étaient-ils habillés ? « Habillement : une sorte de combinaison de soie noire »
=> Lors de l’enquête du G.E.P.A.N. il sera précisé que ce n’était pas un noir « brillant » mais un noir « soyeux » (Pantone 412). L’ombre projetée par la haie d’arbre n’a quant à elle pas pu créer une fausse impression de personnages uniformément noirs. En effet, dès qu’ils rejoignent (voir plus loin) la « machine », ils se trouvent à ce moment-là dans la partie éclairée du pré. Les témoins ne signalent aucun changement de couleur mais donnent, naturellement, plus de détails sur les personnes ainsi exposées.
Q27. Etaient-ils nu-tête ou portaient-ils un casque quelconque ? « Nu tête »
Q28. Les témoins ont-ils pu distinguer des détails de leur habillement, si oui, lesquels ? « Aucun »
Q29. Les proportions des membres et de la tête étaient-elles normales par rapport à la taille des personnages ? « Non »
Q30. Les témoins ont-ils pu distinguer la tête des personnages ? Si oui, ont-ils pu relever des caractéristiques des traits de ceux-ci (yeux, oreilles, bouche, menton, forme générale de la tête et du crâne) ? « Tête ?détails : menton pointu, crâne légèrement allongé ».
=> A Cussac, C. Pavy a voulu connaître d’autres détails. Il a souligné « barbe » dans ses notes. On ignore si les deux enfants donnent cette information. En 2004, C. Poher prétendit que les enfants avaient récusé ces détails mais on n’en trouve aucune trace dans le rapport du G.E.P.A.N. Rien non plus lors du passage de T. Pinvidic 4 ans plus tard. Il semble que la mémoire de C. Poher lui joue des tours (26 ans plus tard). Nous verrons plus loin que ce qui a été observé pourrait être autre chose qu’une simple « barbe ».
Q31. Leur démarche était-elle normale ? -- pas de réponse –
=> De la même façon C. Pavy demanda si les mouvements étaient rapides ou lents. Il souligna « rapides » dans ses notes.
Q32. Paraissaient-ils parler entre eux ? Communiquer par des signes quelconques ? « Ils paraissaient communiquer par des signes entre eux. Un d’eux semblait tenir à une main une sorte de miroir ou objet métallique »
=> Lors de l’enquête du G.E.P.A.N., François précisera avoir vu ce « miroir » refléter la lumière du Soleil sur la paroi de la « machine ». Ce reflet bougeait, d’où l’idée du miroir. Il avait déclaré à l’hebdo qu’il avait eu « l’impression » que l’un des personnages le regardait dans le miroir. C’est la seule fois où il fit cette déclaration. Probablement parce qu’il finit par conclure que cette « impression » était fausse.
L’appel que lance François aux quatre inconnus est quasiment cité dans tous les articles. Les quelques omissions (L.D.L.N. n°90, La Montagne du 1er septembre 1967, etc.) peuvent s ‘expliquer - en fonction du reste de l’actualité - par le manque de place disponible pour l’article. Même une revue spécialisée peut avoir ce type de problème. Mieux vaut faire court que de ne rien écrire ou de se faire battre par un concurrent. J-C. Bourret ne manque pas de signaler cet appel et va même jusqu’à nommer un petit chapitre « Vous venez jouer avec nous ? » dans son premier livre sur les OVNI : La nouvelle vague des soucoupes volantes (11).
Luc Bourdin, enquêteur L.D.L.N., se rappela l’article de J-C. Bourret lorsqu’il rencontra François DH étudiant à la faculté de Clermont en 1977. Les ouvrages ufologique précisent que c'est ce jour là qu'il apprend que la phrase attribuée à Anne-Marie ("Vous venez jouer avec nous ?") est une pure invention journalistique. En effet, d’après lui, les témoins se rendirent compte tout de suite qu'ils n'avaient pas affaire à d'autres enfants. Cette affirmation pose un problème. En effet, on ne trouve aucun écrit mentionnant que c’est « sa sœur » qui lance cet appel. Il est toujours mentionné que c’est « François ». C. Pavy m’a confirmé l’appel mais J. Mesnard m’a déclaré : « Impossible d’être sûr d’un détail pareil ! ». Je pris contact avec Luc Bourdin en avril 2007 afin de trouver une explication. Il me précisa qu’il avait arrêté l’ufologie depuis 20 ans. Sa cousine qui était à la faculté lui avait permis de rencontrer F. DH. L’enquêteur est né en 1961, il avait … 16 ans à l’époque. Il m’indiqua que les deux enfants avaient effectivement eu l’idée d’appeler. Ils en auraient discuté très (très) brièvement mais ne l’auraient pas fait car François se rendit compte très vite qu’il n’avait pas affaire à des enfants. C’est d’ailleurs cette version qui est illustrée dans la bande dessinée de Patrick Clayes (Exclusif OVNI). Il y a donc une petite différence entre les propos de C. Pavy et les siens. Les enquêteurs étant déjà âgés (l’observation date de 40 ans…) on pourrait penser qu’il y a peut-être une simple confusion. Le problème est que les enquêteurs l’ont aussi inscrit dans leurs notes de l’époque. Autre possibilité, François ayant indiqué à Luc Bourdin qu’il en avait « marre d’être embêté », il a pu répondre cela par agacement ou pour rompre avec une partie de son passé qui ne lui apportait que moqueries. De toute façon, comment pourrions-nous lui en vouloir ? La réponse est peut être beaucoup plus simple. On se rappelle que c’est Anne-Marie qui est interrogée en premier par les enquêteurs du G.E.P.A.. Elle mentionne effectivement l’appel car elle en avait probablement eu l’idée une dizaine de secondes - d’après les notes de C. Pavy et J. Mesnard - après que François soit monté sur le muret (elle semble d’ailleurs bien le confirmer à T. Pinvidic en 1983). Etant donné son âge et le fait que la presse a repris cette affirmation – à son initiative - cela a dû plus la marquer. Lorsque les enquêteurs rencontrent François en 1968, cet appel n’est qu’un point de repère dans le déroulement de l’observation. Ils n’abordent pas clairement le sujet avec lui parce que la presse en a déjà largement parlé (et Anne-Marie vient d’en témoigner). Ce qui les intéresse c’est d’aller au plus vite sur les lieux de l’observation avec les enfants et obtenir plus d’informations sur le phénomène. Joël Mesnard m’a d’ailleurs déclaré : « Nous n’avons certainement pas pu faire tout ce qu’il aurait fallu faire. Nous n’avions évidemment pas le recul qu’on peut avoir, aujourd’hui, sur ces choses. Et puis surtout, nous étions à pied, et nous avions un train à prendre, à la gare de St Flour ! ».
Si l’on regarde de plus près le questionnaire que C. Pavy avait envoyé aux enfants, l’appel n’y est pas mentionné. François qui répond au courrier apporte des précisions dans ses réponses mais à aucun moment il ne parle de cet appel. Il semble raisonnable de penser que c’est parce qu’il n’a jamais eu lieu. Luc Bourdin quant à lui réalisa un enregistrement audio de sa rencontre mais il ignore s’il le possède encore. Il a souvent déménagé. Il trouve l’hypothèse hélicoptère non négligeable car il pense que l’on devait en voir rarement dans le Cantal. Il précise néanmoins ne jamais avoir été sur place. Il ne fit jamais de compte-rendu de cette rencontre.
Q33. Comment sont-ils montés dans l’objet ? Les témoins les ont-ils vus monter par une ouverture ? « Les petits hommes se sont soulevés d’eux-mêmes et ont plongé tête première dans l’objet »
=> A Cussac, C. Pavy demanda s’ils étaient passés par une ouverture ou s’ils avaient paru passer au travers de la paroi. C’est la deuxième option qui fut retenue.
Q34. D’après l’article de Paris-Jour, François indique que l’un des personnages est ressorti, a fait quelques pas et est remonté dans l’objet. S’est-il baissé ? A-t-il paru ramasser quelque chose ? S’est-il intéressé à la surface de l’engin ? A-t-il regardé autour de lui voir ce qui se passait ? « Un petit nain est redescendu, et est remonté presque aussitôt à une hauteur de 20 m environ pour replonger dans l’appareil car celui-ci avait déjà démarré et était monté en spirale puis en ligne droite »
=> On remarque que c’est bien François et non l’enquêteur du G.E.P.A. qui signale le premier que la version donnée dans la presse ne correspond pas à ce qu’il a vécu ! La question ne suggérait rien dans ce sens.
=> Commentaires personnels :
Phénomènes Spatiaux n°16 : « Le premier personnage s’élève, bascule et entre, la tête la première, dans la sphère, imité par le second ; le troisième se redresse et en fait autant ; le quatrième s’élève puis redescend…»
Hebdo, édition Toulouse, du 12 octobre 1968 : « Les petits hommes sont entrés chacun leur tour dans la machine, par le dessus, après s’être soulevés en l’air » « il …est remonté tout seul en l’air »
Dans les deux articles, les personnages rentrent l’un après l’autre dans la « machine », Hebdo précise qu’ils sont rentrés par « le dessus ». Quelle machine possède une ouverture par le « dessus » ?
Dans Phénomènes Spatiaux ils s’élèvent, dans Hebdo ils se soulèvent en l’air. Les enquêteurs utilisent le verbe « monter » par similitude avec « s’élever » (dans les airs) et non « pénétrer » (dans la machine). Les enfants eux, ne l’utilisent pas. Cela aurait été pourtant beaucoup plus simple (ex : monter dans le tracteur, dans une voiture, dans un avion…). De même, si le terme « voler » n’est pas utilisé par les enfants c’est probablement parce que les personnages n’ont pas d’ailes. N’oublions pas que nous sommes dans une famille croyante. Il aurait été logique de les comparer avec un ange (ou un oiseau, un corbeau, etc.). Mais non, ce sont les termes « soulever en l’air » ou encore « s’élever » qui sont retenus par les enfants. Précisons que cette action a lieu avant le décollage car il est dit plus loin dans Hebdo : «…l’appareil s’est mis en marche : on entendait un faible sifflement, un peu aigu, et la machine a commencé à s’élever lentement ». Ils ne sont donc pas en appui sur une partie non visible de la machine, donnant l’illusion du vol des personnages.


G.E.P.A. (1968) P.Claeys © Témoignages OVNI Atelier 786
On a aussi utilisé dans la littérature ufologique le terme « plongeon » pour décrire la façon dont les personnages pénètrent dans la machine. En effet, ils pénètrent la tête la première, après s’être « soulevés » du sol, notamment le quatrième. Les enquêteurs noteront que « le quatrième monte, ne bascule pas, et redescend sans bouger ni bras ni jambes » ce qui semble exclure le fait que ce soit un passager d’hélicoptère (voir chapitre IX). En effet, il faut plier les jambes pour atteindre le marchepied et avancer les bras (pliés au minimum) afin de saisir de la main une partie de l’appareil (porte, siège…) et s’aider ainsi à monter.
E/ Phase de départ – disparition
Q17. Les vitesses de l’engin aux différentes phases de la trajectoire comparées à celle d’un avion particulier ou à réaction. Dans la déclaration à Radio Luxembourg par téléphone, la dame dont je n’ai pu avoir l’identité parle d’un démarrage en spirale puis l’engin part en droite ligne. A-t-il marqué un temps d’arrêt ou un autre comportement entre ces deux phases de la trajectoire et a-t-il diminué dans le lointain ou a-t-il disparu brusquement ? « Plus vite qu’un avion à réaction, 2 fois plus vite. L’engin a démarré en spirale puis ensuite en ligne droite sans marquer un arrêt »
=> François semble répondre ici à la réponse n°13


G.E.P.A. (1968) G.E.PA.N. (1978)
Q18. Vous déclarez à Radio Luxembourg que les vaches ont beuglé. Pourriez-vous indiquer à partir de quel moment elles ont beuglé ? « Les vaches ont beuglé au départ de l’appareil »
Q35. Dans quelle direction l’objet a-t-il disparu ? « En spirale puis en ligne droite jusqu’à l’infini »
Q36. Quels ont été les sentiments ressentis par les témoins ? « Peur »
=> ce qui peut donner une (fausse) impression de chaleur…
Remarque :
En analysant les résultats de l’enquête du G .E.P.A.N. (en 1978), on constate que les deux enfants donnent un temps quasi identique pour le décollage, mais qu’Anne Marie voit la « machine » disparaître sensiblement plus tard que son frère (aux marges d’erreur près). La durée de disparition dépend de la concentration et de l'acuité visuelle des enfants. Anne Marie avait probablement une meilleure acuité visuelle de loin. Cela peut aussi expliquer pourquoi elle aurait vu la « machine » un peu plus longtemps que son frère.
F/ Le retour à la ferme
Après le départ de la machine, une odeur commença à se faire sentir. Les enfants, encore sous le choc, décident de rentrer. Ils croisent « vers 11h » au niveau du carrefour qui mène au village un agriculteur : M. VX. Ce dernier revient avec son tracteur et sa remorque. Il a étalé du fumier dans son champ, situé à 680 m de l’emplacement de la « machine ». Le G.E.I.P.A.N. estime qu’il croise les enfants 10 à 15 mn après l’observation. En raison notamment de la conformation du terrain, l’agriculteur n’a pas vu le départ de la « machine ». Il confirme les pleurs et l’état de choc des enfants. Il leur propose de les raccompagner mais ils refusent (voir rapport du G.E.I.P.A.N. à la page A8.21). Certains ouvrage ufologiques indiquent qu’il «aurait » confirmé aussi l’agitation anormale des vaches (le rapport du G.E.P.A.N. ne dit rien). Je dis « aurait » car je ne sais pas si les vaches ont effectivement été rentrées par les enfants. Je m’en étonne un peu vu l’état dans lequel les enfants (et le troupeau) se trouvaient. Les vaches semblent avoir été tellement affolées qu’elles se sont rassemblées avec celles du voisin « comme à l’approche d’un orage ou après la foudre ». Leurs réactions étaient peut-être dues à cette odeur inhabituelle qui s’est fait sentir après le départ de la machine. Les enfants ont peut-être tenté de les rentrer mais y ont très vite renoncé (pas facile d’ailleurs quand l’on vient d’être ébloui…). Cette version semble confortée par le texte de J. Mesnard qui écrit dans son manuscrit: « Les enfants rentrent alors à la ferme abandonnant le troupeau ». J’ai décidé néanmoins de contacter C. Pavy et J. Mesnard. Le premier préféra s’en tenir à la version la plus connue : les enfants rentrent les vaches. Le second, J. Mesnard, avait une version totalement différente. Il me déclara : « Je crois vraiment me souvenir que les enfants s’étaient fait gronder par leurs parents, (avant d’avoir pu donner la moindre explication), parce qu’ils étaient rentrés en abandonnant les vaches sur place. Il me semble que François et Anne-Marie étaient paniqués par ce qu’ils venaient de voir, et qu’ils sont allés très vite se réfugier à la maison, en laissant les vaches…se débrouiller !...il se pourrait bien que chacun de nous ait écrit son propre texte, et que René Fouéré ait fait la synthèse des deux ». Cette version semble confirmée par le témoignage de M. VX. En effet, nous savons qu’il a proposé de ramener les enfants chez leur père et qu’ils ont refusé. Il ne leur aurait jamais proposé de les emmener sur son tracteur s’ils étaient avec les vaches en plein milieu de la route. Ils sont donc bien rentrés seuls. M. VX a néanmoins pu voir l’agitation anormale des vaches du haut de son tracteur puisque le pré est visible du carrefour. Le reste du récit nous est connu. Le chien - qui n’a pas de bétail à surveiller - parvient le premier à la ferme ce qui étonne le père des enfants. Il voit arriver ses enfants en pleurs peu de temps après. Il les trouve « commotionnés ». Les enfants lui racontent leur mésaventure. Le père décide de se rendre sur place avec son fils et un voisin. L’histoire dit qu’un homme a vu le « cirque des bêtes » et qu’il refusa par la suite de témoigner (il décédera malheureusement avant l’enquête du G.E.P.A.N., 11 ans plus tard). Peut-être est-ce le même qui accompagna le maire sur les lieux pour vérifier les dires des enfants. Le pré où tentèrent de s’échapper les vaches lui appartenait peut-être. Etait-ce un cultivateur qui était sur place (voir le livre de F. Lagarde) ? En rentrant, d’autres villageois constatent que les vaches sont « apeurées ». Le maire quant à lui se souvient d’une circulaire, parue quelques années auparavant, relative à des manœuvres militaires et recommandant de signaler tout fait anormal. Il décide de téléphoner vers 12h à la Gendarmerie de Neuvéglise. Les gendarmes n’étant pas assez nombreux, ce sont d’abord ceux de St Flour qui viennent enquêter dans l’après-midi, accompagnés de François. Anne-Marie, qui fait des cauchemars la nuit, finira par dormir avec ses parents pendant une semaine. François ne put dormir la première nuit. Il vit un oculiste par la suite (voir chapitre IX, « l’éblouissement »).
Sur l’objet et ses effets
Q19. L’odeur constatée évoquait quoi exactement ? « Odeur de soufre »
Combien de temps a-t-elle persisté ? « Durée : plusieurs heures » (Remarque : au moins jusqu’à 16h)
Q20. Y a-t-il eu d’autres effets constatés apparemment dûs à l’objet ? « Aucun autre effet constaté apparemment dû à l’objet »
Q21. Y a-t-il eu des traces constatées à l’emplacement de l’objet après son décollage (empreintes de pieds, de patins, herbe brûlée, foulée, le sol a-t-il été d’une façon quelconque modifié ? Si oui, de quelle manière) ? « Aucune trace »
Q22. Les témoins ont-ils ressenti un effet quelconque apparemment dû a l’objet (chaleur, souffle, etc.) ? « (aucun) »
Pour les questions suivantes, les réponses ont été apportées directement sur la feuille envoyée par C. Pavy. L’écriture est un peu différente à partir de la question n°36, ce n’est plus François qui répond.
Q37. Quelle a été la conclusion de l’enquête menée par la gendarmerie et qu’en pensez-vous ? « Aucune conclusion, cela semble assez bizarre »
Q.38 A quoi correspondent les rumeurs rapportées par les journalistes sur une forte prime qui aurait été promise à qui rencontrerait le premier un Martien dans la région ? « Radio-Clermont FD avait annoncé cela » (FD = Ferrand)
Q39. Avez-vous connaissance de ce qui est passé à l’antenne de Radio Luxembourg ? Qu’en pensez vous ? Etait-ce fidèle? « Pas la fin de l’article »
Avez-vous eu connaissance de l’article paru dans Paris-Jour ? Qu’en pensez-vous ? Etait-ce fidèle ?
=> La réponse à cette question se trouve ci-dessus, dans l’introduction.
Q40. Avez-vous des remarques particulières à faire ? -- pas de réponse –
Q41. Pourriez-vous faire un croquis des lieux avec les positions de l’objet et des enfants et l’emplacement du talus sur lequel était monté votre fils ? Pourriez-vous indiquer de quel endroit les témoins ont aperçu les personnages pour la première fois, leurs positions respectives, la direction du Nord ? -- pas de réponse --
=> Concernant le croquis, C. Pavy me précisa en 2007 : « Malheureusement, je n'ai pas ce croquis, et je n'ai pas souvenir qu'il ait été réellement présent dans son courrier. Je pense que ce fut une des raisons qui nous poussa à aller sur place interroger les enfants. »
Q42. D’après votre propre déclaration, vous paraissez convaincu de la bonne foi de vos enfants. Cette bonne foi paraît-elle partagée par la population de votre village ou, au contraire vos enfants ont-ils été l’objet de sarcasmes ou de moqueries ? « Oui mes enfants ont été victimes des pires moqueries, aux dires de certains victimes d’hallucinations, mirages, contes de lutins, etc..»
« mes enfants » confirme que c’est le père (ou la mère) qui répond aux 7 dernières questions.
« contes de lutins » fait probablement référence à la presse.
F. Lagarde signale dans son ouvrage, à partir de l’enquête menée par l’enquêteur de L.D.L.N., en 1968 : « Il aura été demander l’heure à M. VX, qui travaillait sur un tracteur… il était 10h30 à ce moment. Il s’en est étonné : François avait une montre marchant fort bien auparavant. La raison de sa démarche n’a pas été approfondie ». L’agriculteur était sur son tracteur en marche et tournait le dos au lieu d’atterrissage.
C. Poher d’après ses notes de 1979: « Nous n’avons pu reconstituer l’heure exacte de l’observation, car aucun des protagonistes ne portait de montre au moment des faits »
T. Pinvidic en juillet 1983 : « La montre de notre témoin s’arrêta. Mais peut-être s’était-elle arrêtée avant l’observation, ce qu’il ne peut nous préciser »
Pourquoi un tel décalage entre les ufologues et le G.E.P.A.N. ?
J’ai demandé à Claude Poher qui me répond : « Dans mon texte sur l'enquête que nous avons faite à CUSSAC, sur mon site www.universons.com, j'écris exactement ceci : "Nous n'avons pu reconstituer l'heure exacte de l'observation, car aucun des protagonistes ne portait de montre au moment des faits." D'ailleurs je dois dire que le contraire m'aurait fort étonné. Il faut se rendre sur place pour comprendre. En effet, le garçon avait alors 13 ans 1/2 et sa sœur 9 ans. Ce sont les enfants d'un cultivateur d'un village très pauvre du Haut Cantal. La famille n'avait manifestement pas les moyens d'offrir une montre à ses enfants. Pour le comprendre, il suffit d'aller sur place, chez les parents, comme nous l'avons fait. Il n'y avait donc pas de montre. Ce sont des rumeurs… Bien cordialement, C. POHER 23-03-2007 ». J’ai cru dans un premier temps que C. Poher avait mal interprété ses notes en les relisant plusieurs années après mais dans le doute j’ai aussi posé la question à Thierry Pinvidic qui m’a très vite répondu : « Effectivement, tu soulignes là une chose à laquelle je n'avais pas fait gaffe au moment de notre contre-enquête à Cussac: quand j'ai rencontré François DH pour la première fois, il était bâtonnier au barreau de Clermont et c'était à Clermont même, en 1983 ; donc il était adulte et il portait une montre. Lorsqu'il nous a raconté son histoire (pour la nième fois sans doute) il a évoqué l'épisode où sa montre s'est arrêtée. D'où ma spéculation selon laquelle ladite montre aurait pu s'arrêter avant l'observation, mais sans réfléchir, à ce moment là, à l'âge qu'il avait au moment des faits. En fait, puisqu'il a parlé d'une montre, je n'ai pas mis cela en doute, la seule chose qui m'intéressait étant de savoir si il pouvait ou non y avoir un lien entre l'arrêt de la montre et l’observation. Mais, en toute vraisemblance, c'est Poher qui doit avoir raison. Cordialement, Thierry. »
Thierry Pinvidic semble accepter très vite la réponse de Claude Poher mais cela n’explique pas pourquoi François DH parle de l’existence de cette montre en 1983 et pas en 1979. Le fait que
Claude de St Etienne n’en parle pas et que F. Lagarde l’évoque néanmoins dans son livre n’arrange rien. F. Lagarde semble d’ailleurs vouloir surtout nous inciter à nous poser des questions (la montre a-t-elle subi l’influence d’une force électromagnétique venant de l’objet ?…). La démarche de François est pourtant compréhensible. Suite à ce qu’il vient de vivre, il tient probablement à informer son père au plus vite mais cela va probablement contrarier ce dernier car il ne devait pas rentrer si tôt.
En résumé, soit le témoin se trompe (ce qui est compréhensible vu l’ancienneté de l’observation et ses lectures sur le sujet dans les années qui ont suivi), soit c’est Claude Poher en relisant ses notes. C’est très possible car il fait référence à ce qu’il a écrit sur son site. Sa réponse n’est pas spontanée (comme « je me souviens très bien… »). Il prend d’ailleurs la pauvreté des DH comme justificatif, oubliant qu’il était courant d’offrir une montre (surtout à son fils, pour sa première communion, etc…) à l’époque. Claude Poher a peut être confondu une note de 1979 telle que « montre = non » voulant simplement dire « non fonctionnelle, en panne » avec « absence de montre ». Tout cela est très possible car Cussac n’a pas été sa seule enquête.
Il est regrettable que le rapport officiel du G.E.P.A.N. ne nous apprenne rien à ce sujet. On peut néanmoins se féliciter que François DH ne cherche pas à embellir son témoignage en disant qu’il y a un rapport direct entre l’arrêt de cette montre (présumée) et le phénomène observé. Il dit simplement à Thierry Pinvidic qu’il ne sait pas. Claude Pavy me proposa une solution alternative. François DH n’avait pas pris sa montre pour aller au pré de peur de la casser (ou peut-être était-elle effectivement en panne). Claude Pavy pense de toute façon qu’ils durent obtenir l’heure de l’observation par les parents des enfants, surpris de les voir rentrer trop tôt des champs.
G/ Dimensions
Il existe une polémique entre E. Maillot et C. Poher concernant les mesures effectuées par le G.E.P.A.N. en 1978.
Eric Maillot - qui s’est rendu sur place en 2004 - déclare à ce sujet qu’« …aucune mesure exacte de l’arbre (ou des proportions engin/arbre) qui masquait l’engin en 1967 n’a jamais été effectuée, par aucun enquêteur officiel ou amateur… Cette lacune laisse songeur sur le souci de recueil des données objectives dans l’affaire. Aucun enquêteur privé n’a effectué de bi angulation pour situer l’engin en profondeur. Le G.E.P.A.N. a tenté de le faire, malheureusement 11 ans après les faits et sans mesurer les conséquences des biais issus des méthodes utilisées (ex : feuillage des arbres différent ; arbres retaillés ; marge d’erreur due à l’écart imprécis entre les enfants eux-mêmes,…) ».
C. Poher lui répond : « La haie ne comportait, en 1978, aucun arbre élagué ou raccourci, il s’agissait d’une haie d’altitude, non entretenue, sans feuilles les 18 et 19 avril 1978, à cause de l’altitude. Il est très probable que cette haie ait peu évolué entre 1967 et 1978 … »
E. Maillot a raison pour ce qui est de la saison. Les membres du G.E.P.A.N. (comme du G.E.P.A.) sont venus en avril au lieu du mois d’août. De plus, en 1978, cet arbre n’a peut-être pas été repéré de manière fiable. Il est vrai aussi que le rapport du G.E.P.A.N. ne donne pas la hauteur des arbres mais n’oublions pas qu’il devait synthétiser les résultats. Il est probable que le G.E.I.P.A.N. possède un dossier plus complet dans ses archives. On peut espérer qu’un enquêteur privé pourra un jour consulter ces documents dont les propriétaires actuels sous-estiment la valeur « pédagogique ».


V
D C
B A
Si l’on compare la photo N&B de l’hebdo de toulouse (1968) et la photo couleur d’Eric Maillot (2004), toutes deux prises en été, on a tout d’abord l’impression que la végétation a peu changé et doit correspondre assez bien à ce qu’ont observé les deux enfants. C. Pavy (G.E.P.A.) à qui j’ai montré cette photo en 2007 m’a dit que l’emplacement lui paraissait correct. On note néanmoins, déjà, deux différences. Les poteaux téléphoniques ont changé de côté et une stèle (avec croix) a été mise à la mémoire d’un jeune homme décédé lors d’un accident, en 1977. La stèle n’était pas présente en 1978, lors du passage du G.E.P.A.N. J’ai demandé l’avis d’un paysagiste qui a examiné la photo de 1968 et celles de 2004. Il m‘a averti que, sans voir les feuilles, il lui était très difficile d’identifier les arbres visibles sur les photos (hêtres ? ormes aujourd’hui décimés par la graphiose ? etc.). Il est dommage que l’équipe d’E. Maillot n’ait pas questionné l’agriculteur rencontré sur place. Le paysagiste m’a tout d’abord indiqué que les trois grands arbres visibles à droite (ci-dessus) ont déjà été élagués et sont déjà d’un certain âge. Ce ne sont plus les mêmes arbres que l’on découvre sur les photos 36 ans plus tard. En 2004, L’équipe d’E. Maillot avait aussi constaté que la plupart des arbres avaient été étêtés, élagués, ébranchés mais les arbres semblent plus jeunes. Rappelons qu’en pleine campagne, on ne s’amuse pas à tailler les arbres tous les ans. Il peut s’écouler plusieurs années entre deux coupes. La photo visible à la page suivante est prise avec plus de recul que celle de 1968. Le paysagiste remarque que la chaussée semble plus large, il y a peut être un petit fossé à droite qui n’existait pas en 1968. La route a-t-elle été refaite ? Les arbres près de la route ne sont plus les mêmes. Concernant la haie, sous le « V » repéré sur la photo de 1968, on distingue une sorte de buisson au dessus duquel émerge une petite crête. Peut-être est-ce le même arbre, assez haut, que l’on distingue (sans le « buisson ») en 2004. Les feuilles de cet arbre semblent composées. Est-ce un frêne ? Il aurait poussé seul.
Joël Mesnard, qui était repassé par là en 2003, m’a précisé : « J’ai eu du mal à retrouver les lieux précis… les arbres ont beaucoup changé ». En résumé, la végétation a totalement changé. La photo visible dans le rapport du G.E.P.A.N. est trop sombre pour permettre l’identification des arbres mais par contre, ce sont peut-être encore ceux de 1968.
E. Maillot a aussi constaté une très légère déclinaison derrière la rangée d’arbres, puis un terrain plus plat (apte d’après lui à l’atterrissage d’un hélicoptère). La photo prise par J. Mesnard en 1968 (voir page précédente) semble le confirmer ; néanmoins concernant le relief du terrain, sans connaître l’état de tous les terrains des alentours, on ne peut que spéculer. L’ufologue A. Delmon, (informaticien de profession) a beaucoup enquêté sur ce cas. Il me signale qu’un hélicoptère ne peut se poser sur un terrain très « pentu » (pas le cas ici) contrairement à ce qu’on a voulu faire croire en faisant circuler la photo d’une Gazelle dans cette position. Pour l’anecdote cette photo a été réalisée dans le cadre d'une instruction au vol en montagne dans des conditions limite en charge … Expérience qui a d'ailleurs relativement mal fini avec le décapotage d'une partie de la cabine.
Je pense, pour ma part, que les premiers enquêteurs se sont basés principalement sur les indications données par les enfants et la hauteur des arbres pour faire leurs estimations. Ils n’avaient malheureusement pas de théodolite pour faire des mesures plus précises. Notons pour terminer que selon C. Poher, les témoins « ont estimé que le haut de la sphère posée au sol atteignait presque le haut des arbres». On peut donc penser que plus l’arbre qui cache partiellement la « machine » sera haut plus la taille de celle-ci est importante. Ajoutons que si les enfants précisent que la machine est partiellement cachée au début de l’observation (voir le dessin de l’Hebdo) c’est qu’ils l’ont vue par la suite (plus clairement), en se déplaçant (en montant sur le muret pour François), et dans le ciel. La description finale sera « rond en métal », « sphère »…
V

E.MAILLOT 2004
|
|
Enquêtes |
1968 |
Reconstitution G.E.P.A.N. 1978 |
|
|
* avec les témoins |
Estimations |
Mesures |
Estimations |
Mesures |
|
|
témoins |
enquêteurs |
témoins |
enquêteurs |
|
Distance Machine/Témoins |
60 à 70 m |
70 m (Hebdo) ? |
|
71,5 et 82m * |
|
Distance Machine/haie |
|
|
|
8 et 10 m * |
|
Distance Machine/route |
|
|
|
30 à 33 m * |
|
Machine = Sphère => Diamètre |
2 à 3 m |
2 m |
2 à 2,50 m |
4 et 5 m (+ou- 0,3 m) * |
|
Hauteur des arbres |
|
6 à 10 m |
|
5,40 m |
|
Hauteur des "inconnus" |
1 à 1,20 m |
1 à 1,20 m |
1 à 1,20 m |
1 à 1,20 m * |
C. Poher déclare : « Les témoins eux-mêmes nous ont dit que nous avons été les premiers à tenter de reconstituer, avec leur aide, les dimensions de la sphère ». Il y aura eu au total huit reconstitutions distinctes. Lorsqu’on regarde les dessins de la revue du G.E.P.A. (et tous ceux qui les ont repris par la suite), la machine est représentée (au minimum) trois fois plus grande que les « inconnus » alors que les enfants parlent de 2m pour la première et 1 à 1,2m pour les seconds (?).
C. Pavy à qui je demandais en 2007 si cela pouvait être une erreur du dessinateur (J. Mesnard) me répondit : « Je n'en sais rien ! sans doute ... ». A la fin des années 70, Joël Mesnard, qui avait un projet d’ouvrage, redessina la «machine » et revit les dimensions à la baisse (voir page suivante). En 1968, il regardait (et photographiait) la reconstitution. Il avait donc une bonne vision d’ensemble. Il est possible qu’il ait pensé que les inconnus étant à quelques mètres devant la machine, il fallait nécessairement revoir à la hausse la hauteur de celle-ci. Concernant la taille des personnages il me précisa en 2007: « Elle avoisine bien la moitié du diamètre de la boule ». Pour le reste, ses souvenirs sont très flous. « Tout cela est très ancien ». En 1979, C. Poher pense que la fille sous-évalue les distances et les dimensions. D’après lui, le garçon sous-évalue un peu moins les distances que sa sœur. Pour ce qui est de la machine, les résultats ne surprennent pas le G.E.P.A.N. car un diamètre de 5 m, cela semble plus plausible pour que la machine puisse contenir 4 occupants de 1,20 m (Voir aussi chapitre XIV).

Nouveau dessin de Joël Mesnard réalisé en 1976 ou 1977
|
|
|
|
|
|
En août 2004, E. Maillot demande à un ami dont la taille est 1,88 mètres de se mettre à 10 ou 15 mètres derrière la haie (de 2004). Il ne descend pas en contrebas du pré des enfants et prend une photo de la route, ce qui finalement n’est pas trop grave puisque François était, lui, debout sur le muret (à peu près à hauteur d’adulte). Il pense que la configuration du terrain crée une impression de proximité ou de taille réduite selon l’endroit de la haie où se situe la personne et selon la position de l’observateur. Il précise qu’il n’y a pas d’herbe mais que les jambes paraissent tout de même plus courtes à cause de très faibles dénivelés localisés (de l’ordre du décimètre sur quelques mètres) qui peuvent expliquer cette illusion. L’anorak (tissu synthétique noir brillant) que portait son ami lui donne - d’après lui - une ressemblance étonnante avec ce qui fut décrit par les enfants.
J’avoue que les remarques sont intéressantes mais là encore je dois me montrer critique. La photo est assez sombre, le ciel est semble-t-il couvert. Un élément important dont il faut pourtant tenir compte car le soleil a peut-être un rôle important dans cette observation. Cette personne n’est pas du tout au bon endroit et plus on s’éloigne vers le fond du pré (à droite pour nous sur la photo), plus on a du mal à voir. Les enfants DH sont de la région, contrairement aux ufologues. Ils sont familiers de ce terrain. La hauteur - éventuelle - de l’herbe en 1967 ne pourrait donner un aspect court et tronqué aux quatre inconnus que si ceux-ci ne bougeaient pas. Ce n’est pas le cas ici puisqu’il y a «élévation » de corps (et d’ailleurs au moins un pied est observé). Eric Maillot n’a pas placé son ami plus près de la haie car la machine n’est pas très éloignée des inconnus… et le diamètre rotor d’une Alouette varie de 10 à 11m suivant les modèles. Cela ne signifie pourtant pas que la machine était si éloignée de la haie. Lorsqu’il se retourne après avoir coupé la route aux vaches (voir précédemment), François est beaucoup trop éloigné (et mal placé) pour pouvoir distinguer quelque chose à 10 ou 15m derrière la haie. Lors de la reconstitution du G.E.P.A. (voir photo avec C. Pavy) et celle de L.D.L.N. (dessin sur photo dans Hebdo 1968), les inconnus ne semblent être qu’à 2 ou 3m maximum. Eric Maillot l’écrit lui-même : « Très peu de détails sont perceptibles à 50m - alors à 70 ou 80m - mais nos yeux ne sont pas aussi performants que ceux d’enfants ». Pourtant, il pense que François DH n’avait pas une très bonne vue et que lui et sa sœur ont été éblouis. Tout ceci semble contradictoire. Il est pourtant plus logique de penser que les inconnus (et la « machine ») étaient très près de la haie.
Lorsqu’on y réfléchit, il paraît absurde de vouloir mesurer la hauteur d’inconnus éventuellement non humains et de leur « machine » en se basant sur des normes humaines sans avoir un point de repère parfaitement fiable. Il y a néanmoins une constante : la « machine » (ou sphère) est toujours décrite deux fois (voire davantage) plus haute que les êtres qui ont été observés près d’elle. Si les témoins les ont vus près de la haie sans remarquer que la « machine » était beaucoup plus en arrière, la différence va nécessairement s’amplifier et l’engin s’éloigner d’autant plus des modes de transport connus. Si la « machine » est beaucoup plus loin de la haie (erreur du G.E.P.A.N. ?), au moment d’embarquer les inconnus sont en plein soleil, et l’ombre de la haie ne peut pas expliquer cette couleur noire uniforme et soyeuse…
Si l’on regarde ces deux photos, il est évident que le personnage de la seconde (voir flèche) n’est pas bien positionné.

HEBDO 1968
| Zone plus logique pour une reconstitution | E.MAILLOT 2004 |
Ciel nuageux (et sombre ?) ne correspondant pas au matin du 29/8/67 ( ?) E. Maillot précise pourtant qu’il y avait une forte luminosité ( ?) en 2004. Le réglage de l’appareil est-il en cause ? |
Rappel: les 4 personnages ne sont pas dans l’ombre au moment d’embarquer !
Les
enfants ne signalent pas de changement de couleur et donnent -
logiquement - plus de détails !
Nous allons essayer de revoir les éléments dont nous disposons :
=> Taille des inconnus : « 1 mètre environ » (1 m 20 => enquêtes G.E.P.A et G.E.P.A.N.)
=> Forme de l’objet (discoïdale, conique, parallélépipédique, etc.) : « sphérique »
Dimensions « apparentes » de la machine: « de 2m à 3m x 2m à 3m »
(G.E.P.A. => 2 m, G.E.P.A.N. => de 4 à 5 m (+ ou – 0,3 m))
C. Poher a réévalué à la hausse la taille de la « machine » (car les enfants auraient sous estimé les dimensions) mais pas celle des inconnus (?). Ajoutons par exemple 80cm à la « fourchette basse » et cela donne 1 mètre 80 pour les inconnus. Une hauteur plus conforme à un être humain mais qui ne contredit en rien d’autres hypothèses. En effet, des humanoïdes de plus grande taille ont déjà été signalés dans d’autres observations. Pour la machine cela donne de 2m80 à 3m80 x 2m80 à 3m80. Je prends comme précédemment la « fourchette basse » et j’arrondis ce qui donne 3m. Cette hauteur est conforme à la double mesure faite par Anne-Marie (3m au théodolite confirmée à 3m par écart de deux personnes sur site). Ceci est aussi conforme au diamètre donné par François dans Hebdo.
Si on considère maintenant que les « patins circulaires » signalés par Anne-Marie (voir question n°15) sont des roues, sachant qu’un pneu roue d’Alouette a un diamètre de 34 cm (source Armée de Terre), on a deux possibilités :
a) fourchette basse => pour passer de 7 cm à 34 cm (arrondissons à 35) il faut multiplier par 5
la « machine » passe donc de 2 m à 10 m !!
b) fourchette haute (pour la « roue ») => pour passer de 10 cm à 35 cm il faut multiplier par 3,5
la « machine » passe donc de 2 m à 7 m !!
Dans tout les cas, la dimension a changé mais le rapport entre taille « inconnus » et taille « machine » (pour 3 m) n’a pas de raison de changer ! Notez, ci-dessous, à gauche, la hauteur des hommes et celle de la « bulle » (la « sphère ») d’une Alouette ! Les deux sont quasiment identiques


A même distance, apparence de la « machine » si sa hauteur est égale à 3m
Hypothèse hélicoptère ? Si les passagers se rapprochent de la haie, ils apparaissent plus grands (l’appareil étant derrière eux). Pourquoi les enfants décrivent-ils toujours la « machine » deux fois plus haute (au minimum) ? Dès que l’hélicoptère s’élève, il n’a plus l’aspect - à démontrer - d’une sphère et tourne pour s’éloigner (plus de reflet - à démontrer - car la cabine est à l’opposé, queue tubulaire tournée vers les enfants …). Ce n’est - toujours - pas une « sphère » !
H/ Le rapport du G.E.P.A.N. et les étranges conclusions de C. Poher
Comme le signale E. Maillot, le rapport du G.E.P.A.N. fait l’impasse sur les données relatives aux entités. Pourquoi ? On peut penser que le C.N.E.S. n’en aurait pas accepté les implications à l’époque. Ce rapport devait rester assez vague dans ses conclusions. En effet, l’existence d’un tel service avait surtout pour but de rassurer une partie du public en attendant que ce phénomène de mode disparaisse. La science officielle n’a jamais désiré aller plus loin. On remarque aussi dans le rapport que la mesure de distance entre Anne-Marie et la haie n’apparaît pas (un oubli lors de la saisie ?). De même, la spirale « croissante » qui « aurait été effectuée » par la machine au décollage semble très exagérée. Elle n’est d’ailleurs pas signalée en 1968. Le rayon de cette spirale « calculé » par C. Poher aurait amené l’engin quasiment derrière les enfants. Cela ne correspond pas aux déclarations des enfants. Le fait de tourner sur elle même – peut-être avec un très faible rayon suite à la proximité des arbres - a pu néanmoins donner l’impression - fugitive - que la « machine » augmentait de volume. Dans l’hypothèse hélicoptère sur laquelle je reviendrai par la suite, c’est la cellule qui pivoterait sur son axe rotor. Ce serait donc la queue de l’appareil qui décrirait un cercle de quelques mètres de diamètre. Or la queue de l’appareil (ou un quelconque marquage) n’a jamais été signalée par les enfants (?). Elle est beaucoup trop grande pour avoir été « noyée » dans les reflets du soleil…

Extrait du rapport du G.E.P.A.N. (page A8.23) sur lequel Eric Maillot signale que les enquêteurs avaient omis systématiquement de dessiner le virage. Plus simplement, un croquis - maladroit - de présentation qui n’entache en rien les mesures effectives sur le terrain. Le plan métrique de la page A8.36 par contre est faux.

Aucune personne connue n’ayant vu arriver la « machine », on ne peut qu’émettre des hypothèses, d’autant plus que l’on ignore où se trouvent tous les autres éventuels agriculteurs :
Nord ou Ouest => Très possible si les enfants sont bien assis derrière le muret et M. VX, l’agriculteur est dos au phénomène.
Nord Ouest => Cela semble assez curieux car l’engin serait reparti quasiment dans la même direction. Cela sous entendrait qu’il venait chercher quelque chose de très précis (voir notamment chapitre XI). Dans l’hypothèse hélicoptère développée par Eric Maillot (voir chapitre IX), le terrain semble s’y prêter et l’approche - même si elle peut paraître dangereuse - n’est pas impossible pour un professionnel. Le vent n’est sans doute pas très fort.
Nord Est à Est => Peu probable mais pas impossible si M. VX est gêné par le bruit de son tracteur (et suivant la disposition de son champ). Dans l’hypothèse hélicoptère, une colline proche pouvait masquer le bruit de son approche à basse altitude.
Sud Ouest à Sud Est => Peu probable - mais à ne pas exclure - car l’un des deux enfants aurait eu la possibilité de le voir (ou de l’entendre peut-être) arriver.
* Toujours dans l’hypothèse proposée par E. Maillot, le son de l’hélico aurait été atténué du fait qu’il arrivait (E/SE) contre le vent (O/NO). Le garde champêtre aurait entendu le bruit de l’hélicoptère lors de l’arrivée et non lors de son départ. Le muret derrière lequel se tenaient les enfants et les arbres aurait diminué le son à l’atterrissage => Signalons néanmoins quelques problèmes : pourquoi les 30 vaches du pâturage voisin n’ont-elles pas tenté de fuir vers le terrain des DH (au début) ? La panique aurait dû se communiquer au troupeau des DH et la fuite du troupeau aurait dû avoir lieu dans l’autre sens (au début)! Ce n’est pas seulement le bruit mais la vision de l’appareil qui les aurait effrayées, pourtant, les enfants ne signalent rien (?) F.Lagarde évoque bien dans son livre Mystérieuse soucoupes volantes (page 131) un cultivateur qui aurait vu les vaches du pré voisin rejoindre hâtivement le troupeau gardé par les enfants mais ce n’est guère logique. Les enfants font le récit inverse. Il n’y a qu’une seule explication possible. Les enfants ont abandonné le troupeau. Les bêtes livrées à elles mêmes se sont mélangées. Tout ceci bien sûr dans le pré voisin de celui des DH et après l’observation. Ce mystérieux cultivateur ne pouvait voir la « machine » puisque l’observation était terminée. Les enfants n’ayant pas perdu de temps à rentrer le troupeau, et l’observation ayant eu lieu vers 10h (voire 10h et demi d’après le père des enfants sur Radio Luxembourg), cela ne coïncide plus (30 mn d’écart) avec l’heure à laquelle M. DR, qui n’a rien vu, dit avoir perçu un sifflement. M. DR pensait avoir entendu un son d'hélicoptère puis, au cours de son écoute, avait réalisé que c’était différent. Le son entendu par M. DR n’a peut-être rien à voir avec l’observation. Là encore, un témoignage bien faible…
Joël Mesnard me précise: « Sauf erreur de ma part (ce qui est possible après tant d’années !), nous n’avons pas rencontré ce monsieur (remarque : le cultivateur). En tout cas, je n’en ai aucun souvenir. Je ne sais même plus si nous avons vu M. DR, mais je ne crois pas. Je pense que c’est plutôt le père des enfants qui nous a donné cette info. »
On retiendra aussi deux hypothèses « exotiques » :
La machine venait de l’espace, elle est donc « descendue » dans le pré
Elle venait d’une autre dimension, d’un autre temps, elle est « apparue » dans le pré

VI. Un ufologue : Christian Caudy
T. Pinvidic indique dans son livre que selon deux enquêteurs, MM Caudy et Couzinié, François DH participa de temps en temps à des réunions d’ufologues. Cette information apparaîtrait notamment dans une lettre de C. Caudy écrite le 11 décembre 1982 à M. Figuet. Problème, C. Caudy que j’ai interrogé à ce sujet m’a répondu : « En réponse à votre question je n'ai jamais écrit à M. Figuet. Ce que dit T. Pinvidic dans son livre est faux… ». Il n’a pas connu non plus de Couzinié ou de cercle L.D.L.N. à Clermont-Ferrand. T. Pinvidic aurait-il confondu avec Couzinié ? D’après G. Durand (Sceau), Couzinié serait décédé. J’ai contacté T. Pinvidic qui m’a répondu : « Sans avoir mes archives sous les yeux, il m'est difficile de répondre à ton mail. A l'évidence, si Caudy dit n'avoir jamais écrit à Figuet il peut simplement ne pas s'en souvenir, par contre lorsqu'il dit ne pas connaître Couzinié cela signifie que j'ai dû associer ce dernier à Caudy et que ce n'était pas Caudy... En tout cas, il étaient 2 et je ne retrouve pas le nom de celui que j'ai remplacé par Caudy. Désolé. Et je ne sais pas quand je trouverai…le temps de refouiller ce dossier…». C. Pavy me fit la même réponse que C. Caudy : « … Je ne connais ni l'un ni l'autre ! ». En avril 2007, j’en profitai pour demander à l’enquêteur Luc Bourdin s’il n’était pas l’auteur du courrier. Il me répondit avoir très bien connu M. Figuet mais ne pas être l’auteur de ce courrier. Il ajouta que vu l’agacement de F. DH vis à vis des gens qui venaient le questionner sur cette affaire (ufologues inclus…), il doutait qu’il ait pu assister à de telles réunions.
Christian Caudy est enquêteur de L.D.L.N. depuis 1969. Il venait d’avoir 56 ans (né le 1er mars). Toutes ses enquêtes ont été publiées et plusieurs ont fait la couverture de la revue L.D.L.N.. Il est aussi abonné à Inforespace. Il s’est bien rendu à Cussac en 1979. Il m’a précisé qu’il était accompagné de son épouse. Il n’a rencontré que les parents DH qui l’ont emmené ensuite sur les lieux de l’observation. Il a pris des notes mais rien n’a été publié. Il n’a rien trouvé d’anormal par rapport à ce qu’il savait des précédentes enquêtes. Il considère le cas comme authentique et rappelle que cette observation a été citée dans le « rapport COMETA ». Rappelons que COMETA (COMiTé des Etudes Approfondies) est une association privée composée d’anciens « auditeurs » de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN) et d’experts qualifiés dans divers domaines qui ont publié un document en 1999 intitulé « Les ovnis et la défense. A quoi doit-on se préparer ? ». Ce rapport était le résultat d’une étude approfondie qui couvre divers aspects du phénomène Ovni et spécialement les questions de la Défense. Il a été envoyé au président de la république Jacques Chirac et au premier ministre Lionel Jospin.
Le 19 juin 2007, Gilles Durand, membre du Sceau m’a envoyé un courrier électronique : «… Nous avons remis la main sur la lettre de Caudy à MFT, elle fait 6 pages A5, soit 3 pages A4. Mais il n'y en a qu'une petite partie consacrée à Cussac, les termes dont TPC (T. Pinvidic) fait état dans "Anthropologie" semblent se confirmer, mais personnellement je ne vois pas en quoi cela discrédite le témoin, encore moins pour le considérer comme un "accro" de la soucoupe. Il allait dans des réunions pour témoigner, un point c'est tout… ». J’ai pu en obtenir une copie fin septembre. En fait, elle n’était pas de 1982 mais de 1988. Une erreur supplémentaire. On y apprenait aussi qu’Anne-Marie avait travaillé dans un ******* de St Flour. C. Caudy écrivait : « J’ai fait une contre-enquête sur cet atterrissage en 1979 avec l’aide de M. Maurice Couzinié de Graulhet…c'est avec ma femme que je suis allé à Cussac. Quand à monsieur Couzinié, je l'avais contacté par correspondance, et je ne l'ai jamais vu ». C. Caudy avait bien oublié cette lettre. Ce n’est en soit pas très grave. Cela nous montre surtout les difficultés que l’on rencontre à enquêter sur un cas datant de 40 ans…
Fades (fées), lutins (ou « letien » ou encore « lequin » ou « tsoutsu ») mais aussi loups-garous ( ou galipots, masse noires et quasi sans membres qu’on entrevoyait la nuit…) font partie des légendes de l’Auvergne T. Pinvidic questionna François DH sur le mythe des Pédauques (12) (on parle aussi de signe pédauque = « en patte d’oie ») mais celui-ci n’avait apparemment rien lu sur le sujet. On peut aussi signaler que le seul Christ « noir » connu en France est à quelques kilomètres de Cussac, dans la cathédrale de Saint-Flour. Un grand Christ en bois du XII ou XIIIe (on a même prétendu que l’œuvre ne serait pas antérieure au XIXe siècle…). La signification de ce noircissement uniforme et la provenance de la statue restent une énigme. Ce Christ possède bien sûr une « barbe »…
VIII. Temps parallèle
En 1968, le père de F. DH - car ce dernier était trop jeune - donna son accord (et signa) pour la parution d’un article dans la revue L.D.L.N.. Il est bon de rappeler qu’elle n’était pas encore consacré entièrement à l’ufologie (13). Dix ans plus tard, lorsque le G.E.P.A.N. s’entretient avec François DH - ses parents sont présents - ce dernier admet l’hypothèse extraterrestre mais avec réserves. Le rapport officiel (14) indique qu’« il est très intéressé par le problème du temps parallèle (?) mais il est certain d’avoir vu une machine volante ». Ce point d’interrogation laissé après « temps parallèle » n’a pas été développé par le G.E.P.A.N. Essayons d’aller plus loin et de découvrir ce que voulait dire François.
Le temps parallèle ou plus exactement Les temps parallèles est le titre du roman de l’une des plus grandes figures de la Science Fiction : Robert Silvesberg. Cet ouvrage est paru aux USA en 1969 dans la revue « Amazing ». Son titre original était Up the time. L’édition française date de 1976 (15) soit deux ans avant l’enquête du G.E.P.A.N.. Le roman traite du tourisme temporel, du paradoxe d’accumulation et de la façon dont on évite de bouleverser l’histoire. Le paradoxe d’accumulation est assez complexe. Donnons un exemple assez « simple » : à force d’aller assister en touristes à des événements historiques, des voyageurs temporels formeraient des foules là où il n’y avait que des petits attroupements. A priori, pas de rapport avec l’observation de Cussac. Si François a lu ce livre, sa réponse est néanmoins assez logique. Il est écrit dans le rapport G.E.P.A.N. : « Il est très intéressé par le problème du temps parallèle (?) mais il est certain d’avoir vu une machine volante ». Notez le « mais » qui montre la contradiction ! En effet, il n’y a aucune boule lumineuse ou véritable « machine » à voyager dans le temps dans le livre de Robert Silvesberg. Si une nouvelle fois, on émet l’hypothèse que François a lu ce livre, il a donc voulu exprimer cette contradiction. Celle-ci a été notée par le rapporteur du G.E.P.A.N. qui n’y prête pas vraiment attention car cela ne fait pas partie des hypothèses « exotiques » qui intéressent les responsables du dossier OVNI au C.N.E.S.(16). Une autre question se pose : pourquoi emploie-t-il le terme « temps parallèle » et non « voyage dans le temps » ? C’est le « temps » et non le « déplacement » lui-même qui semble le fasciner. On sait qu’il demanda l’heure à un agriculteur en rentrant après son observation. A-t-il l’impression que l’observation a duré plus longtemps qu’elle ne le semble ? Cet incident l’a-t-il marqué plus que nous ne pourrions le penser au premier abord ou est-ce le prolongement de quelque chose qui nous aurait échappé dans son témoignage ?

En 1978, M. Guary, juge en retraite, produit pour le G.E.P.A.N. un rapport psychosociologique de 3 pages en annexe du rapport principal et conclut : « Il n’existe dans ces divers éléments aucune faille, aucune discordance qui permette de douter de la sincérité des témoignages, ni d’envisager raisonnablement une invention, une supercherie ou une hallucination ».
M.
C. Poher interrogé à ce sujet me répond : « …C'est
exact, l'analyse et le rapport psychosociologiques des témoins
dans l'enquête du GEPAN sur le cas de CUSSAC ont été
menés par le Président GUARY, ex magistrat ayant
plusieurs décennies d'expérience dans le domaine de
l'interrogation des témoins. Par ailleurs ce magistrat a
été membre du Conseil Supérieur de la
Magistrature, ce qui est une marque de confiance de la part de ses
pairs et des autorités judiciaires françaises.
Cependant, la méthode d'enquête psychosociologique
ainsi que la méthode d'analyse et de rapport ont été
mises au point avec une psychosociologue de l'Université de
Paris, qui était chargée de recherche et spécialiste
du mensonge et de la rumeur (sujet de sa thèse
scientifique). Le Président Guary a soigneusement respecté
la méthode préconisée alors. Un "canevas"
d'enquête psychosociologique avait été établi.
Les questions et réponses des témoins étaient
enregistrées sur magnétophone. Les interrogatoires
spécialisés se sont déroulés en tête
à tête entre le magistrat et chaque témoin,
dans un cadre officiel : la mairie du village. J'étais à
Cussac et je dirigeais cette enquête sur place, donc je peux
témoigner que cette partie de l'enquête s'est
déroulée dans les règles préconisées.
Après l'enquête j'ai personnellement participé
à l'analyse faite en concertation avec le Président
Guary. Son rapport reflète les conclusions du groupe
d'analyse. Monsieur Guary était alors au tout début
de sa retraite, et par conséquent il venait de quitter ses
fonctions de Président de cour. Il est aujourd'hui décédé.
Je dois ajouter que son expérience, son jugement sur les
témoins, sa probité,
ses qualités
humaines, en faisaient un collaborateur bénévole
d'une exceptionnelle compétence et efficacité. Je
considère que sur le plan des analyses psychosociologiques,
il était plus compétent et plus expérimenté
que notre psychosociologue "officielle et diplômée".
Son concours était très précieux
dans
toutes les enquêtes auxquelles il a participé. Son
jugement sur les témoins était toujours très
étayé. Sans son autorité naturelle, ses
méthodes de travail, et la qualité des relations
qu'il savait déployer, je pense que les témoins de
CUSSAC n'auraient pas collaboré autant qu'ils l'ont fait.
Ils étaient en effet très las des relations avec les
ufologues et les media. Grâce à Monsieur Guary, à
qui j'avais demandé de préparer cette enquête,
nous avons pu obtenir une entière collaboration non
seulement des témoins eux-mêmes, mais aussi des
membres de leur famille, des autres témoins du village, des
anciens gendarmes qu'il a fallu retrouver, etc. Monsieur Guary
était un homme exceptionnel, et je tiens à lui
rendre hommage. Les hommes de cette trempe sont très
rares. »
En 1983, François confirme à T. Pinvidic qu’il ne croit pas aux extraterrestres et pense plutôt avoir vécu une « distorsion » du temps dont il se sent incapable de donner un modèle physique, et il s’interroge toujours sur la nature exacte de son expérience. Il dit que cette observation le culpabilise sans qu’il en comprenne les raisons. A-t-il l’impression d’avoir interrompu quelque chose d’important ? Qu’on lui a transmis un don ? Il se déclare néanmoins intuitif (voir sensitif d’après T. Pinvidic) car il lui arrive désormais de tirer les cartes. On ne peut que spéculer. Il dit qu’il était obnubilé par l’objet lors de l’observation, et se déclare incapable de préciser si l’environnement immédiat « existait » toujours. Le temps (17) lui semblait arrêté. T. Pinvidic pense que tout ceci (sensation de détachement, calme absolu qui s’installe…) est typique de l’expérience du numineux. Après avoir confronté son témoignage à celui de sa sœur et comparé avec les modèles connus, il conclut à la véracité de l’observation. On pourrait aussi parler d’un état modifié de conscience (EMC), mais le sujet est encore mal connu de la science et il ne faut pas oublier qu’il y a deux témoins.
Le temps est aussi au cœur des origines de Cussac. L’histoire nous dit qu’un noble de Clermont nommé Amant, ayant perdu sa femme, se fit chrétien et vint vivre en ermite dans les solitudes herbues, là où est aujourd’hui Cussac. Sa fille l’avait suivi et vivait dans une maison qu’il avait fait bâtir à quelque distance de l’ermitage. Ainsi, tous les matins, la jeune fille pouvait-elle embrasser son père. Quand Amant pensa que Dieu exigeait plus de sacrifices encore, il pria sa fille de ne venir qu’une fois l’an. « Ce sera au printemps, lui dit-il, quand les pâquerettes seront revenues. » On était alors entre la Noël et les Rois et la neige recouvrait tout. Sa fille très triste passa la nuit en oraison. Quelle ne fut pas sa surprise quand, ouvrant sa porte le lendemain matin, elle vit que les pâquerettes, perçant la neige et bravant le froid, avaient fleuri par myriades autour de sa maison. Elle cueillit les fleurs et se précipita chez son père. En arrivant devant lui, elle jeta les fleurs à ses pieds avant de l’embrasser. De ce jour, elle ne le quitta plus : Dieu, par ce miracle, avait montré qu’il le voulait. L’église de Cussac est sous le patronage de saint Amant. On notera que la floraison inhabituelle des fleurs est le signe que « le temps est passé plus vite »… même si la neige est toujours présente. (Source : Guide de l’Auvergne mystérieuse, Les guides noirs, éditions Tchou princesse - 1980)
A noter que j’ai voulu téléphoner au presbytère de la localité afin de m’entretenir avec le prêtre. Peut-être était-il déjà en fonction en 1967. Son avis sur la question aurait pu être intéressant. Malheureusement, il n’y avait aucune trace d’un presbytère dans les pages jaunes. Finalement, je réussis à joindre un prêtre d’une localité voisine qui me dit que l’église de Cussac était fermée depuis longtemps. Il m’a d’ailleurs précisé : « Vous savez qu’il n’y a plus de curé… la mort, sûr ! ». Dommage…

IX. L’hypothèse hélicoptère
A priori, une méprise avec un hélicoptère semble possible et notamment dans les cas suivants :
de nuit
mauvaises conditions climatiques (exemple : brouillard)
à très grande distance
obstacle gênant l’observation
Dans le cas présent, l’observation a lieu le matin vers 10h par un beau ciel dégagé. La distance entre les témoins et la « machine » n’était pas très grande et celle-ci était clairement visible dans le ciel au décollage.
Revenons sur le journal la Montagne du 1er septembre 1967 qui est le seul à donner une dimension (4m de large sur 2m de hauteur) qui ne coïncide pas avec la vision d’une sphère et fait penser à un hélicoptère (cabine + machinerie, queue tubulaire exclue comme ci-dessous).

CELAG
Nous allons donc étudier la possibilité d’une méprise hélicoptère :
=> L’hélicoptère était-il connu du public en 1967 ?
Dès 1922, le Larousse illustre le mot « hélicoptère » par une photo. En novembre 1947, Mécanique Populaire (qui annonce fièrement être le magazine « écrit pour tous ») nous montre en couverture un ballonnet qui s’éloigne dans le ciel tirant un petit poste émetteur. Je pense immanquablement à l’observation de Roswell et au ballon Mogul. Néanmoins, l’article qui nous intéresse se trouve à la page 1. Il a été écrit par Stanley Hiller Jr et s’intitule « Voulez-vous un hélicoptère ? » Sur 6 pages, agrémentées de 23 illustrations (dessins + photos) d’hélicoptères , le génial concepteur nous donne les « rudiments » du pilotage. A sa lecture, on a l’impression qu’un hélicoptère trônera demain dans notre résidence familiale. On a d’ailleurs la même impression en regardant la couverture de Mécanique Populaire du mois de mars 1951 (voir page suivante). Stanley Hiller Jr ne cache pas qu’il y a quelques difficultés pour piloter, mais pas vraiment plus que pour apprendre à conduire une voiture. La même année, G. Busson et P. Lefort écrivent un livre intitulé Comment apprendre à piloter un hélicoptère (école, brevet, licences, circulation aérienne, etc.). En 1953, on peut trouver L’hélicoptère de J. Moine qui traite du pilotage (mais aussi du prix de revient, entretien, etc.). Le 3 juillet 1956, un Alouette II de présérie récupère à plus de 4 000m un alpiniste victime d’un malaise cardiaque, et le 3 janvier 1957 c’est encore une Alouette II qui va au secours de l’équipage d’un Sikorsky S-58 qui s’est écrasé sur le Mont Blanc à la recherche des alpinistes Jean Vincendon et François Henry. Ces opérations, largement couvertes par la presse nationale, facilitent l’obtention de la certification civile, délivrée le 2 mai 1957 par la DGAC. Le même mois, Charles Marchetti, ingénieur en chef du département « Hélicoptères » de Sud-Aviation (créateur des « Alouette ») confirme dans la revue Transmondia que l’hélicoptère est en plein développement. « Après les stratèges, qui l’ont déjà adopté, les économistes doivent le faire entrer dans leur arsenal ».

En 1967, cela fait donc 20 ans, et probablement plus, que l’hélicoptère fait parler de lui (voir aussi « Chronologie des événements » plus haut). L’hélicoptère fête ses 100 ans en 2007 (18) et tout bachelier peut aujourd’hui espérer en devenir pilote. On trouve encore quelques traces de l’époque héroïque - si l’on a gardé des souvenirs de famille - comme les images ci-dessous, que les enfants pouvaient collectionner dans les biscuits ou les plaques de chocolat. On peut donc penser après tout ceci que l’hélicoptère était bien connu, mêmes des enfants, à la fin des années 60. Il était de toute façon beaucoup plus facile à l’époque d’en voir un en photo qu’un ovni…


Biscuits Rogeron ( ? – 1955) Chocolat des coopérateurs ( ? – 1970)
La rédaction d’ HELICO REVUE (19) a eu l’amabilité de me communiquer l’adresse électronique de trois pionniers (Gérard Henry, Jean Boulet et André Morel) qui ont fait une carrière de pilote hélico depuis la fin des années 40. Ces personnes ont accepté de nous donner leurs avis sur le cas qui nous concerne. J’ai souligné les passages qui me paraissent les plus intéressants.
« En ce qui concerne J. Boulet et moi-même, nous étions pilotes d'essais à la SNCASE qui fabriquait, à l'époque indiquée, les Alouette 2 et 3. J. Boulet et moi-même (je ne peux parler au nom de A. Morel) ne croyons absolument pas aux OVNIS . Les phénomènes observés ont toujours eu, après coup, une explication logique ou scientifique .Mais nous ne voulons empêcher personne de rêver . J. Boulet et moi-même nous sommes TRES souvent posés dans la nature (le Cantal) pour des raisons diverses - en particulier mauvaise météo (brouillard) - au cours de convoyages sur le trajet Marignane - Le Bourget et retour . L'apparition fantomatique de l'hélico sortant du brouillard pour se poser avec en plus le bruit des turbines, a très bien pu impressionner des enfants proches du point d'atterrissage . Le "cas célèbre dans le Cantal en 1967" ne devrait plus faire débat . Comment des gens réputés sensés, intelligents (?) et instruits, ont-ils pu accréditer pareilles balivernes ? Vous trouverez toutes informations concernant la réglementation de l'époque auprès de l'Aéro-club de France , 6 Rue Galilée à Paris .Bon courage et . . . bien cordialement Gérard HENRY »
(Remarque : rappelons qu’il ne faisait pas mauvais temps le 29 août 1967 à l’heure de l’observation de Cussac. J’ai néanmoins demandé - à plusieurs reprises - à M. G . Henry ce qu’il entendait par « raisons diverses » mais je n’ai reçu aucune réponse à ce jour. Le convoyage consiste à amener un hélico d’un point à un autre et le trajet est établi en traçant sur une carte la ligne droite qui va du départ à l’arrivée et en évitant les éventuelles zones interdites de survol, les aérodromes militaire en particulier. Si on trace une ligne droite qui va de Marignane au Bourget on traverse à la rigueur l’Auvergne mais pas le Cantal. Il semble que M. Gérard Henry, né en 1924, se trompe dans ses souvenirs ou …qu’il n’apprécie guère le sujet OVNI. Je salue néanmoins sa riche carrière qui compte 11 575 heures de vol).


(Transmondia, la revue de tous les transports n°32 – mai 1957) Chaîne des Alouette à la Courneuve
« En réponse à votre mail que je viens de recevoir je vous signale que pour ma part j'ai volé en 1967 sur l'hélicoptère Bell 47 J , un quadriplace immatriculé F.BNPQ uniquement dans le département des Hautes Pyrénées. A cette époque tout pilote bénéficiaire du document administratif "autorisation d'utiliser les hélisurfaces" pouvait se poser n'importe où hors agglomération avec le simple accord du propriétaire du terrain. Cette législation existe d'ailleurs toujours mais il faut au préalable prévenir la Police de l'Air. Je comprends que votre recherche est très sérieuse et s'il était en ma possibilité de vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Agé de 85 ans j'étais pilote-instructeur planeur, avion et maintenant hélicoptère jusqu'au 31 mars de cette année mais avec la nouvelle réglementation , compte tenu de mon âge , je ne peux maintenant plus piloter qu'avec un deuxième pilote à bord, ce que je déplore... Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Bien cordialement. André Morel »

Je pris de ses nouvelles trois mois plus tard c’est ainsi qu’il me précisa avoir eu de nombreux problèmes de santé et ajoutait: « En ce qui concerne l'activité hélicoptère en 1967 on pouvait se poser et repartir de n'importe où , sauf dans les agglomérations, à la condition que l'on soit en possession d'une"autorisation d'utiliser les hélisurfaces" délivrée par le Ministère de l'Intérieur après enquête de la gendarmerie, de la police et des douanes. Ce qui peut expliquer la confusion qu'il y a peut-être eu entre un posé et un départ nocturne d'un hélico dans la campagne et un ovni. En ce qui concerne les ovnis je puis vous assurer que pour ma part, s'il m'arrivait d'en voir un évoluer je n'en serais absolument pas étonné et, à mon avis, il est bien prétentieux de croire que dans l'univers nous sommes les seuls à avoir su réaliser des engins capables de s'affranchir de la pesanteur en s'appuyant sur un fluide. Je reste à votre disposition pour répondre à toute question qui soit de mon ressort. Bien amicalement. André Morel ». Constatant qu’il parlait de méprise possible de nuit alors que je lui parlais d’une observation qui avait eu lieu le matin, je lui posai de nouveau la question et je reçus comme réponse : « Oui, c'est tout à fait possible car en 1967 l'hélico n'était pas encore vulgarisé comme il l'est maintenant. Il serait intéressant de savoir à quelle heure cela s'est passé car un faible éclairage peut avoir altéré la vision des témoins. Quant à ce qu'a pu effectuer comme manœuvre au décollage l'hélico il a aussi bien pu s'élever à la verticale jusqu'au dessus d'éventuels obstacles et prendre ensuite la direction qui lui convenait que partir en oblique vers son lieu de destination ! Bonne chance dans vos recherches de témoignages. André Morel ». Une nouvelle fois, l’évidence d’une méprise en pleine journée ne lui vient pas à l’esprit. Il pense d’abord à la nuit puis à l’aube. A noter qu’après avoir consulté ses carnets de bord (il en a 7), M. Morel m’a indiqué que le 29 août 1967, il était à Cauterets ( Hautes Pyrénées) avec un Bell 47 G2 (F.BIFN).
Remarque :
J’ai acheté la biographie d’André Morel intitulée Carnet de route où il fait découvrir l’épopée de l’hélicoptère. Sauvetage en haute montagne, évacuations sanitaires, construction de lignes à haute tension (etc.), de Dunkerque au Tassili, il a sillonné tous les cieux. Il a aussi testé une nouvelle combinaison de plongée dans les eaux froides des Kerguélen. Il a connu des personnages fascinants comme Charles Petitjean, homme de confiance du général Lejay qui a créé l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT), brevet de pilote n°1 de l’ALAT mais aussi Jacqueline Auriol. Il a piloté planeur, Bell 47, Lama et même transporté le ministre André Malraux dans un Djinn. Son livre de 158 pages, illustré d’une quarantaine de photos, est préfacé par Jean Boulet et présenté par le général Baffeleuf, ancien patron de l’ALAT et ancien directeur des Ecoles Militaires de France. Dans un autre ouvrage intitulé Dans le ciel du désert, André Morel raconte les 1 200 heures qu’il a effectué dans la prospection du pétrole au Sahara. Ce livre est préfacé par son camarade Paul-Emile Victor…
=> Annonces et courriers
J’ai passé une annonce le 30/01/07 sur le site HELICOPASSION(20): "Je cherche des pilotes (civils ou militaires) ayant volé en hélicoptère (principalement BELL ou ALOUETTE) au dessus du Cantal - même brièvement - en 1967. J’aurais quelques questions purement techniques à poser…». Deux annonces de même nature ont été passées sur le site des Amis du Musée de l’ALAT le 6 juillet et le 21 septembre 2007. Un courrier a été envoyé à 17 pilotes dont les coordonnées m’ont été transmises par A. Morel. Une demande similaire fut effectuée auprès de M. Gérard Henry et M. Jean Boulet (17 records mondiaux en hélicoptères) par courrier électronique.
=> Les méprises hélicoptères
L’ufologue Renaud Leclet avait préparé - avant sa disparition - un dossier portant sur les méprises hélicoptères. Je reçus début septembre 2007 un message électronique faisant la première liste de ces documents. Elle avait été dressée par Thierry Rocher (membre du C.N.E.G.U.) pour le S.C.E.A.U. (association de sauvegarde ufologique). Je demandai aussitôt à Thierry Rocher ce qu’il en pensait. Il me répondit : « La quasi-totalité des dossiers que j'ai listés pour le SCEAU sont des méprises "possibles", d'après RLT (Renaud Leclet). Il n' y a pas d'enquêtes élaborées, mais plutôt des références à des livres ou des coupures de presse. Il y a quelques courriers (les noms sont donnés dans le doc envoyé)… ». En résumé, une pré-étude sur des pistes d'explication par des hélicoptères. Rien de très détaillé …
=> L’éblouissement et l’état de santé de François DH
François est légèrement myope et fortement astigmate, défauts corrigés par des lunettes (non teintées) qu’il porte depuis l’âge de 6 ou 7 ans. Après cette observation, un oculiste, dans le cadre d’une visite de routine, observa que François avait été atteint d’une inflammation des yeux. Il constata la rougeur des yeux et leur larmoiement, comme chez un skieur qui a regardé la neige au soleil sans se munir de lunettes de protection. Habituellement, on appelle cela l’ophtalmie des neiges. C’est une brûlure de la cornée, dûe aux rayonnements ultraviolets. Les premiers symptômes apparaissent généralement quelques heures après l’exposition. Ils se manifestent par une forte sensation de gêne, des rougeurs, des larmoiements, des troubles de la vue, voire une cécité partielle. Dans les cas les plus graves, une forte douleur peut également apparaître. Il n’existe aucun traitement. Elle guérit généralement 48 heures après l’exposition, sans laisser de séquelles. Francois indiqua à T. Pinvidic en 1983 que les perturbations constatées disparurent dix jours environ après les faits. Dans les deux cas, le fait paraît très étrange. En premier lieu parce qu’en plein mois d’août, bien évidemment, il n’y avait pas de neige à Cussac, ensuite, comme l’a très bien fait signalé Alain Delmon, parce qu’un enfant aurait eu le réflexe de détourner la tête. Il n’y a que lorsqu’on fixe volontairement, sans bouger, une source lumineuse trop forte, que l’on abîme sa vue. Lors de la reconstitution du G.E.P.A.N. la machine est décrite comme « aussi lumineuse que le soleil à midi » (On trouvera plus tard dans le questionnaire type du S.E.P.R.A. la phrase « aussi lumineux que le soleil ». Peut-être suite à cette enquête). Les yeux des enfants sont bleus. François a-t-il été davantage touché parce qu’il portait des lunettes (indispensables pour un myope qui doit garder des vaches)? Dans tous les cas, un simple reflet peut-il occasionner ce type de désagrément ? Combien de temps a-t-il été ébloui ?
Le rapport du G.E.P.A.N. signale (page A8-25) que François a eu le plus grand mal à monter sur une pierre au début de l’observation. Il a donc été ébloui alors que l’appareil était encore au sol et avant de monter sur le muret. Peut-être a-t-il d’ailleurs cessé de l’être en étant surélevé, ce qui lui a permis néanmoins d’observer les personnages et leur « machine ». Il déclare d’ailleurs dans Hebdo : « Lorsque le troisième a plongé, on a bien vu ses pieds palmés, comme les canards ». Même si éventuellement il se trompe sur la forme des pieds, il arrive néanmoins à les voir ce qui est exceptionnel, à cette distance, pour une personne que certains soupçonnent d’avoir des lunettes avec une mauvaise correction. Par la suite, quant l’engin a commencé à monter, il a pu de nouveau être ébloui par celui-ci mais il ne signale rien de particulier en dessous de la machine. Si nous avions affaire à un hélicoptère, il aurait dû voir aisément en-dessous de l’appareil - partie plus sombre suivant l’angle de réverbération du soleil - quelques détails éventuels. De même, si Anne-Marie a été beaucoup moins gênée aux yeux que son frère (elle aurait vu des « béquilles ») elle ne signale rien à l’arrière. Elle aurait pu voir la queue d’un hélicoptère. Si c’est une queue tubulaire elle est d’autant plus visible, même brièvement, au (reflet du) soleil (?). Personnellement, je travaille près de l’aéroport de Roissy depuis 1993. A toutes les heures de la journée je vois passer des appareils qui volent très (très) bas car ils atterrissent au Bourget. Jamais je n’ai été ébloui. Ma vue est pourtant loin d’être excellente. Les appareils survolent plusieurs tronçons d’autoroute (un miracle qu’un terroriste n’ait jamais pensé à tirer à ce moment précis). Si les conducteurs sur l’autoroute étaient éblouis…
A. Delmon ajoute : « La verrière n’était pas aveuglante, au sol, puisqu’on y voyait le ciel bleu s’y refléter, et que François a même raconté avoir vu l’un des êtres provoquer un reflet sur la surface de l’engin. Ce n’est qu’en vol, sous un angle particulier et très fugitivement qu’un reflet réellement aveuglant a pu être éventuellement produit, comme le reconnaît Eric Maillot. Mais dans ce cas, même au sol et vues de face, les enfants auraient dû signaler les immenses pales du rotor. Et lors de la phase ascensionnelle hélicoïdale, l’hélicoptère présentant alors successivement et plusieurs fois toutes ses faces, les enfants auraient dû parfaitement noter, entre deux reflets gênants éventuels, les éléments caractéristiques d’un hélicoptère ? »
C. Poher (ex-G.E.P.A.N.) indique sur son site internet : « un pare-brise sphérique en plexiglas d’hélicoptère réfléchit la lumière. Quelques %, selon les lois de l’optique, mais, parce qu’il est sphérique, l’optique dit aussi que ces quelques % de lumière réfléchie sont répartis dans la presque totalité des 4 pi stéradians. Cela ne fait pas un flux lumineux réfléchi bien important reçu par la pupille des témoins à 80m de distance. Ce flux se calcule d’ailleurs très aisément, il est d’environ un dix milliardième du flux réfléchi. Aucun risque d’éblouissement par conséquent. Pourtant les témoins sont formels à propos de l’éblouissement, et leurs parents confirment leurs yeux rouges. Les lois de l’optique ne doivent pas être ignorées quand on analyse une observation visuelle ». A l’appui de ses dires, C. Poher a mis sur son site deux photos montrant la « bulle » d’un hélicoptère photographié de face et de profil à une douzaine de mètres - en plein soleil - en précisant que cela montrait bien que le reflet n’était pas éblouissant. E.Maillot contesta cette affirmation. Sur le fond, ce dernier à raison. Une photo ne prouve rien, mais on peut penser que si le photographe a réussi ces photos, c’est qu’il n’a pas, lui, été ébloui en regardant dans son viseur. Mon épouse, professeur de lettres classiques, a demandé conseil à deux de ses collègues professeurs de physique (l’un PEGC et l’autre certifié). Ils ont été interrogés séparément. Ils sont entièrement d’accord avec C. Poher sur ses déclarations d’optique mais ne peuvent trancher sur l’éblouissement. Il y a d’après eux trop de paramètres à prendre en compte. J’ai demandé à une collègue de poser la question à son ophtalmologiste. Il pense qu’ils auraient pu être éblouis mais ignore si le fait d’avoir déjà des problèmes aux yeux a pu aggraver les choses. La question a aussi été posée sur un forum d’ophtalmologistes mais je n’ai pas reçu de réponse à ce jour.
J’ajoute néanmoins la déclaration de deux pilotes :
C. Poher : «L’éloignement est observé dans l’azimut moyen 293°, ce n’est pas, un 29 août, à cette heure-là, à l’opposé du soleil. Le soleil était dans l’azimut 129°, à une élévation de 43,6°. Cela place le soleil à 164° de la direction de départ en azimut et 116° en élévation… Si la sphère reflétait la lumière du soleil, la luminosité du reflet aurait dû diminuer pendant l’éloignement, et non augmenter». (Remarque : d’autant plus que la « bulle » d’un hélicoptère n’aurait plus été éclairée lorsqu’il se serait éloigné dans la direction opposée aux témoins).
A. Morel (pilote d’hélicoptère en 1967): « …L’éblouissement par le reflet du soleil sur la bulle ou le plexi de la cabine je n'y crois absolument pas car j'ai assisté de très près à des dizaines de décollages de confrères avec les hélicos les plus divers sans jamais avoir été ébloui. En mettant les choses au pire un tel reflet ne durerait qu'une fraction de seconde. »
Additif de C. Poher pour clore le sujet :« La résolution rétinienne étant de l’ordre d’une minute d’arc, à une distance de 80m il est parfaitement possible de distinguer à l’œil nu des détails de 30mm. Probablement même 20mm pour de jeunes enfants de cette tranche d’âge, dont la résolution rétinienne est meilleure ». Le 10 juillet 2007, il ajouta un article sur son site traitant de la luminosité de l’OVNI de Cussac dans le cadre de la théorie des Universons. Il y précisait : « La charge induite est perçue comme de la lumière…La lumière était en réalité virtuelle, je veux dire « pensée » par les témoins, et en réalité due aux électrons chassés par le flux propulsif invisible. Pour voir cette fausse lumière intense il fallait être au bon endroit au bon moment, dans l’axe du flux propulsif très bref ». J’avoue n’avoir pas les qualifications requises pour juger de la validité de la théorie des Universons. J’ai posé la question au physicien Auguste Meessen en novembre 2007. Il m’a répondu : « Rien de ce que j'ai pu voir encore récemment ne justifie une modification des arguments que j'ai développés précédemment ». Ses arguments étaient en désaccord avec la théorie de C. Poher …
On peut profiter de l’occasion pour parler de l’état de santé de François DH. On sait de Thierry Pinvidic que François fut très souvent malade dans sa jeunesse (angines, rhinopharyngites…). Il contracta même une streptococcie qui, mal soignée, provoqua un rhumatisme articulaire aigu et des complications cardiaques dès l’enfance. Il fut exempté de sport durant sa scolarité, mis au régime sans sel, « bouffi » du fait de la cortisone qui lui était administrée. De là à imaginer que les médicaments ont pu agir sur sa vision, son interprétation des faits (etc.), il n’y a qu’un pas que certains n’ont pas hésité à franchir. Il semble si pratique de tout attribuer aux problèmes de santé du témoin ! Plus sérieusement, il est bon de rappeler que François était en vacances ce jour là et qu’il n’était pas seul. Est-il crédible de penser qu’un père confierait à son fils, malade (ou somnolent suite à la prise de médicaments…), la garde d’un troupeau de vaches et de la même façon, la sécurité de sa fille ? De même, il n’y a aucune raison de penser que son père l’aurait laissé avec une vision mal corrigée, qui l’aurait handicapé dans ses études. Il était d’ailleurs un très bon élève.
=> Les effets sur l’environnement ?
Alain Delmon et Jean-Louis Peyraut m’ont fait la même remarque. Un hélicoptère ça fait énormément de vent, ça remue pas mal de choses à des mètres à la ronde. Fernand Lagarde écrit : « On perçoit le bruit d’un souffle… ». Les enfants ne mentionnent pas ses effets sur la nature environnante. La cime des arbres aurait dû être secouée lorsque le phénomène s’est élevé dans le ciel…
=> Traces, odeurs, et petits désagréments…
En 1978, le G.E.P.A.N. ne put retrouver qu’un seul gendarme ayant participé à l’enquête de 1967. Ce dernier signala avoir vu à l’époque une trace au sol. Il s’agissait de traces d’herbe jaunie ou brûlée sur une surface circulaire de 4 à 5 m de diamètre (il semble d’ailleurs y avoir une erreur de dimension sur sa représentation à la page A8-36 du rapport G.E.P.A.N.). Selon lui, un cercle plein et non pas un anneau de type mycélium. Il confirma avoir noté une odeur persistante. François DH déclara en 1983 à T. Pinvidic qu’il trouvait ce gendarme peu sérieux, notamment à cause de cette trace (voir d’ailleurs sa réponse à la question n°21 de C. Pavy) qu’il n’avait jamais remarquée à l’époque. Il est possible que F. DH (avocat aujourd’hui) ait des griefs d’ordre professionnel envers ce gendarme qui viennent perturber son jugement. J’ai demandé à Pierre Gillard (21), qui est pilote, de consulter le site http://www.ovniland.com afin de nous donner son avis sur le cas de Cussac. Il me répondit : « Un posé d'hélicoptère ne laisse pas de trace sur de l'herbe mis à part les marques de patins (ex: Alouette II) ou de roues (ex: Alouette III) ou, encore, à moins d'une fuite de carburant ou d'huile ». Rappelons qu’une Alouette II pèse quand même plus de 800 Kg à vide. Il faut aussi noter aussi que si c’est un pilote - malade - qui s’est posé, il aurait pu laisser des traces. Pour une diarrhée ou une gastro-entérite, il est possible de se procurer quelques médicaments à l’hôpital le plus proche (la trousse de premier secours étant le plus souvent hors d’usage - d’après A. Morel - ou inadaptée…). La « machine » n’en prend pas la direction. Si c’est pour uriner, on cherche à se mettre à l’écart. Pourtant là, on observe 4 inconnus (?) assez proches. On pourrait aussi imaginer que c’est le dessous de la machine qui crée un sillon (partiel) en commençant à tourner (ou peut-être l’un des « pieds » s’il y a un léger déséquilibre au décollage). La conclusion se trouve malheureusement dans La Montagne qui précise: « Nulle part on n’a trouvé de traces… mais, répondent les enfants, l’endroit a été piétiné, entre temps, par les vaches ». Ce qui sous-entend que nous ne pourrons pas faire pencher la balance, ni d’un côté ni de l’autre. L’odeur signalée à l’époque a été plus ou moins identifiée - parmi quatre (kérosène, acétone, NO2, SO2) - par trois des témoins comme celle du SO2. Parmi ces quatre « témoins », M. DR se souvient qu’en rentrant ses bêtes en soirée, il sentit cette odeur suffocante (il étouffait) et cela devant chez lui (à 500m du lieu d’observation, où d’ailleurs il ne s’est pas rendu). Certaines personnes iront prétendre que cette odeur aurait pu être celle du fumier. Si elle a été sentie sur les lieux de l’observation, elle se déplaçait donc contre le vent (?). Comment des gens de la campagne pourraient-ils ne pas reconnaître l’odeur du fumier ? Le pilote Pierre Gillard qui a consulté le rapport du G.E.P.A.N. sur internet ajoute quant à lui : «Par ailleurs, les odeurs relevées ne correspondent pas à du kérozène brûlé ». Il me semble plus juste de dire que rien ne nous permet de savoir si l’odeur pouvait être reconnue en 1978. Les témoins (directs ou indirects) avaient déjà vécu trop d’expériences. L’environnement est de plus en plus pollué. L’expérience a été réalisée 11 ans trop tard. C. Poher déclara plus tard que le GEPAN avait prélevé de la terre et des pierres derrière la haie, et avait progressivement porté ces échantillons à 500° C le surlendemain, sans qu’aucune odeur particulière ne se manifeste. On aurait pu en effet penser à l’odeur de gaz sulfureux, perçue par quatre personnes, du fait que la région est d’origine volcanique, mais cette hypothèse s’est avérée sans fondement.
Remarque : le soufre exposé à des ondes électromagnétiques de type micro-ondes produit une intense lumière blanche. En Suède, des lampes au soufre ont été installées dans des bureaux de poste et des hôpitaux… électromagnétisme, odeur de soufre, lumière intense…
L’Alouette II
L'Alouette II a effectué son premier vol le 12 mars 1955. Elle a été conçue par la SNCASE sur la base du prototype Alouette avec une turbine en lieu et place du moteur à piston traditionnel, ce qui en fit le premier hélicoptère à turbine au monde à être commercialisé. Le 1er juin 1967, 969 exemplaires avaient été livrés. Elle a été fabriquée jusqu’en 1975 : au total 1 305 (22) appareils mis en œuvre pour 126 clients civils et militaires dans 46 pays du monde. Elle était employée en version militaire pour des missions de surveillance, de liaison, de sauvetage et de recherche. Elle a été utilisée par l’ALAT équipée de missiles SS-11. En France, elle a été retirée des forces armées en 1999. L’Alouette II a été également très répandue dans le milieu civil, où elle était utilisée pour tous types de travaux. Seules deux versions ont été produites en série : la SE-3130 à turbines Artouste II et la SE 3180 à turbines Astazou (renommées SA-313 et SA-318 à partir de 1967). L’Alouette II a donné naissance, en 1968, au SA-315 Lama. Dérivé du prototype SE-3150, le Lama est composé d’une structure renforcée à laquelle ont été adaptés les ensembles mécaniques et le moteur de l’Alouette III (SA 316B). J’ai trouvé dans la base de la DGAC des SA 315B dont l’année de construction est antérieure à 1967, il s’agit probablement d’Alouette qui ont été modifiées. Certains Lama sont des Alouette II ou des Alouette III reconstruites. On parle de 48 machines. Je les ai donc gardés dans mon étude. Conçu spécialement pour les opérations à haute altitude, le Lama est essentiellement utilisé pour le travail aérien, comme la pose de lignes électriques en montagne.
|
|
SE313B
Alouette II |
SA315B
Lama |
SA318C
Alouette II |
SA316B
Alouette III |
SA316C
Alouette III |
SE3160
Alouette III |
|
Nombre de places |
1 + 4 |
1 + 4 |
1 + 4 |
1 + 6 |
1 + 6 |
1 + 6 |
|
Diamètre Rotor |
10,2 m |
11,02 m |
10,2 m |
11,02 m |
11 m |
11 m |
|
Longueur totale * |
12,050 m |
12,919 m |
12,100 m |
12,840 m |
12,840 m |
12,840 m |
|
Hauteur |
2,75 m |
3,09 m |
2,75 m |
3 m |
3 m |
3 m |
|
Largeur |
2,080 m |
2,38 m |
2,380 m |
2,602 m |
2,602 m |
2,602 m |
|
Masse Max |
1600 kg |
1950 kg |
1650 kg |
2200 kg |
2250 kg |
2100 kg |
|
Charge à l'élingue |
500 kg |
1135 kg |
600 kg |
750 kg |
750 kg |
750 kg |
|
Vitesse Max |
185 km/h |
210 km/h |
205 km/h |
210 km/h |
220 km/h |
210 km/h |
|
Vitesse de croisière |
170 km/h 92 kts |
192 km/h 103 kts |
180 km/h 97 kts |
185 km/h 100 kts |
195 km/h 105 kts |
185 km/h 100 kts |
|
Moteur Turboméca |
Artouste IIC / IIC5 |
Artouste IIIB / IIIB1 |
Astazou IIA / IIA2 |
Artouste IIIB / IIIB1 |
Artouste IIID |
Artouste IIIB / IIIB1 |
|
Puissance thermique |
530 ch 390 kW |
870 ch 640 kW |
530 ch 390 kW |
870 ch 640 kW |
870 ch 640 kW |
870 ch 640 kW |
|
Puissance maximum continue |
360 ch 265 kW |
550 ch 405 kW |
480 ch 353 kW |
550 ch 405 kW |
550 ch 405 kW |
550 ch 405 kW |
Toutes les caractéristiques de vitesse et de puissance correspondent aux masses maximum au décollage
( MTOW ), en conditions ISA (= atmosphère type internationale ) et au niveau de la mer.
* Pales dépliées (A partir du site http://www.alouettelama.com/types/index.html)
L’Alouette III
L’Alouette III a été développée par Sud Aviation pour remplacer l’Alouette II. Elle en reprend les principaux composants dynamiques dans une cellule plus vaste et carénée lui permettant d’élargir son domaine d’utilisation. La première version (SE-3160) a effectué son premier vol le 28 février 1959. Elle est déclinée en versions A, B et C toutes équipées d’une turbine de type Artouste III. La version B est caractérisée par des transmissions renforcées et la C, sortie en 1972, par l’adoption de la version IIID de l’Artouste plus puissante. Le SA-319 est apparu en 1970 avec une turbine plus moderne et moins gourmande. Cette version étant postérieure à l’observation de Cussac, elle ne sera pas retenue. L’Alouette III est une machine très polyvalente (1 455 exemplaires construits). Utilisée par de nombreuses armées en configuration de combat, de recherche et de sauvetage, elle fut l’une des premières machines à être équipée en série d’un armement. Très présente également dans le monde civil, l’Alouette III est utilisée en mer et sur terre pour un grand nombre de missions en tous genres, allant du transport de personnalités à la surveillance routière. Elle reste cependant le meilleur hélicoptère de sauvetage en montagne : tous les montagnards connaissent l’Alouette III rouge de la Sécurité Civile.
Le Bell 47 J
National Air and Space Museum, Smithsonian Institution
Je reprends la présentation d’Alain Delmon qui me paraît assez complète : « Cet hélicoptère mythique (Le Bell) a été construit aux Etats-Unis à partir de 1946 à plus de 6000 exemplaires. Il s'agissait du premier hélicoptère au monde à être homologué tous usages. Parmi les 6000 produits, environ 1000 le furent par Agusta et d'autres par Kawasaki. La production ne cessa, dans les usines italiennes, qu'en 1976. De nombreux pays furent séduits par l'appareil qui entama une carrière militaire universelle. Après l'arrivée en France au début des années 50 de quelques biplaces Bell 47D, un petit nombre de Bell 47D-1 triplaces avec un GMP Franklin 6VA de 180 ch furent acquis par les armées. Ils ont été suivis par plus de 200 Bell 47G (moteur Franklin de 200 ch) et Bell 47G-2 (moteur Lycoming de 260 ch) pour la plupart affectés dans l'ALAT, quelques-uns allant dans l'Armée de l'Air, la Royale, la Protection civile ou la gendarmerie (à partir de 1954). Les Bell 47 militaires français ont volé jusqu'au début des années 70 pour des missions d'école, d'observation, d'évacuation sanitaire ou de liaison. La version la plus puissante (G-2) avait une autonomie maximale à vide limitée à 338 km… Une version quadriplace a également existé, le Bell 47-j. Mais en quantité très limitée. Sauf erreur de ma part ni la gendarmerie ni l'ALAT n'en ont jamais possédé. De plus dans cette configuration l'aspect "bocal à poissons" est nettement moins évident, l'appareil ressemble davantage à un hélicoptère classique, et il est difficile d'imaginer une méprise avec une sphère lumineuse».
NB : Cet hélicoptère américain unique en France a participé néanmoins à de nombreux films " AIR AMERICA " avec Mel Gibson. Bref, les Bell 47 étaient majoritairement biplaces (ce qui ne cadre pas avec les 4 "êtres"), et avaient une autonomie limite et risquée pour atteindre Cussac. Quant aux Bell 47 quadriplaces, ils étaient rares, non utilisés par les forces armées, et ne collent plus à l'aspect "sphérique" des descriptions. De plus, le Bell 47 est mû par un simple moteur à piston et non par une turbine. Ce qui ne cadre pas du tout avec la turbine que l'article mentionne plusieurs fois dans la suite du texte… pour expliquer la prise de conscience des enfants qu'un "truc bizarre" se passe. Enfin, les Bell-47 ont commencé à être remplacés dès 1957 par le modèle Alouette II. Le Service Historique de la Gendarmerie Nationale (Maisons-Alfort, 94) que j'ai sollicité, n'a hélas pas pu me confirmer le type d'engin qui était utilisé sur la SAG (Section Aérienne de Gendarmerie) de Limoges-Feytiat en 1967. »
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec sa remarque concernant l’aspect « sphérique ». Je reviendrai sur ses caractéristiques un peu plus loin lorsque j’évoquerai l’autonomie de l’appareil.

L’acteur Roy Thinnes utilisa l’hélicoptère dans la série TV Les Envahisseurs, diffusée bien après 1967 en France
Photo tirée du 4ème épisode intitulé « les sangsues » (1ère diffusion américaine le 31 janvier 1967 sur ABC)
Au début du 26ème épisode, les extraterrestres arrivent dans un Bell 47 J (1ère diffusion le 31/10/67 sur ABC)
Comment retrouver un hélicoptère qui aurait volé en 1967 ?
L’Aviation Civile
La Direction Générale de l’Aviation Civile (D.G.A.C.) m’a aidé dans cette recherche. J’ai pris contact avec le bureau des immatriculations qui fait partie de la Direction de la régulation économique de la DGAC. Son adresse est 50 rue Henry-Farman à Paris (75015), face à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. On peut consulter le registre des immatriculations (aéronefs inscrits et radiés) sur internet (23). Le registre des immatriculations est une obligation des Etats ayant signé la convention sur l'organisation de l'aviation civile internationale (annexe 7 de l’OACI). Lorsqu'il est noté "radié", cela signifie que l’appareil a été détruit, n’est plus aux normes, qu’il a été ferraillé ou exporté. La base de données contient des informations sur les propriétaires successifs. La base de données des immatriculations ne peut pas être interrogée par année. On peut sélectionner un type d’aéronef et ensuite visualiser ceux immatriculés ou l’ayant été, puis obtenir le nom des propriétaires successifs en cliquant sur l’immatriculation puis sur “données juridiques”.
En
cherchant par exemple “alouette” on obtient une liste
des types contenant ce nom :
SE 313 B ALOUETTE II, SE 3130
ALOUETTE II, SA 318 B ALOUETTE ASTAZOU, SA 3180 ALOUETTE ASTAZOU,
SA 318 C ALOUETTE ASTAZOU
En sélectionnant “SE 313 B ALOUETTE II”, on obtient 114 réponses, à visualiser une à une. Il faut ensuite recommencer avec les sous-types suivants...
On peut aussi faire une recherche spécifique comme SA 315 B (Lama) ou SE 3160 (Alouette III)
On peut trouver dans
la base de la D.G.A.C. des années de construction «2000»
alors que l’année réelle est plus ancienne. Il
s’agit d’une erreur au moment du basculement vers une
nouvelle base. Par défaut j’ai classé les
« 2000 » dans « date inconnue ».
Si une marque ancienne n'avait jamais été attribuée,
elle peut l'être pour un appareil "récent".
Les immatriculations ne sont par ailleurs jamais redonnées.
Les dates de radiation du registre ne figurent
malheureusement pas sur internet. Une modification a été
demandée. Les motifs de radiation ne sont pas indiqués.
Un hélicoptère construit en 1960 et inscrit en 1970
sur le registre civil peut avoir été utilisé
par l’armée, venir d'un registre de la sécurité
civile ou autre registre d'état (CEV,
Douanes, ...) mais
c'est tout à fait aléatoire. Des appareils peuvent
aussi venir de registres étrangers.
Aucun SA 318 B Alouette n’a été trouvé dans la base. Peut-être n’aurais je pas dû prendre en compte tous ces différents modèles mais le tableau que j’ai établi servira peut-être pour d’autres enquêtes. En consultant les fiches j’ai remarqué une anomalie - que j’ai d’ailleurs signalée à la DGAC - concernant la société Sud Aviation. En effet, quelques appareils (radiés) n’apparaissent que lorsque l’on indique le nom du propriétaire et non celui du modèle d’aéronef. Ils ont bien sûr été rajoutés dans la base. Au total, j’ai trouvé 403 appareils. Pour le Bell 47J, le nombre de 8 appareils me semble un résultat très correct. Pour ce qui est de l’Alouette, le chiffre peut paraître assez faible par rapport au nombre d’appareils construits mais n’oublions pas que l’armée, divers services d’état et surtout près de 50 pays en furent aussi destinataires.
|
|
|
|
|
|
PORTS |
D'ATTACHE |
|
|
|
|
|
|
Année de |
Dans un département |
|
Métropole |
|
|
|
|
|
|
construction |
contigu du Cantal |
En Auvergne |
(A et B) |
DOM |
Etranger |
|
|
|
|
|
(A) |
(B) |
inclus |
TOM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S |
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
79 |
2 |
3 |
|
|
E |
INSCRIT |
1967 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
Après 1967 |
|
|
1 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|
date inconnue |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
Avant 1967 |
1 |
0 |
18 |
3 |
0 |
|
|
B |
RADIE |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Après 1967 |
|
|
2 |
0 |
0 |
|
|
S |
|
Avant 1967 |
2 |
|
19 |
1 |
0 |
|
|
E |
INSCRIT |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
Après 1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ALOUETTE II |
1 |
|
Avant 1967 |
2 |
|
9 |
0 |
0 |
|
|
3 |
RADIE |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
Après 1967 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
date inconnue |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
8 |
1 |
0 |
|
|
S |
INSCRIT |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
A |
|
Après 1967 |
|
|
15 |
3 |
0 |
|
|
|
|
date inconnue |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
3 |
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
|
|
1 |
RADIE |
1967 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
Après 1967 |
|
|
20 |
0 |
1 |
|
|
C |
|
date inconnue |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|
S |
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
A |
INSCRIT |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
LAMA |
3 |
|
Après 1967 |
|
|
|
30 |
|
|
|
1 |
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
|
5 |
RADIE |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Après 1967 |
|
|
|
74 |
|
|
|
B |
|
date inconnue |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
S |
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
E |
INSCRIT |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
Après 1967 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|
date inconnue |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
RADIE |
1967 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Après 1967 |
|
|
1 |
0 |
0 |
|
|
S |
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
A |
INSCRIT |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
Après 1967 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
RADIE |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
Après 1967 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
ALOUETTE III |
|
|
date inconnue |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
S |
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
8 |
0 |
2 |
|
|
A |
INSCRIT |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
Après 1967 |
|
|
|
21 |
|
|
|
1 |
|
date inconnue |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
|
|
B |
RADIE |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Après 1967 |
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
date inconnue |
0 |
0 |
|
11 |
|
|
|
S |
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
A |
INSCRIT |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
Après 1967 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
RADIE |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
C |
|
Après 1967 |
|
|
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
INSCRIT |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Après 1967 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
BELL 47J |
|
|
Avant 1967 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
RADIE |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Après 1967 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
date inconnue |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les hélicoptères dont le port d’attache est proche du Cantal et/ou en Auvergne
Le SE 3130 Alouette II immatriculé : F-GJLK construit en 1964
propriétaire EURL Auvergne Héli Services à Clermont Ferrand (63100) mais enregistré le 3/7/1995
Le SE 3130 Alouette II immatriculé : F-GLED construit en 1960
propriétaire HELI CLUB d’Auvergne, port d’attache à Clermont Ferrand (63100) mais enregistré le 15/4/1999
Le SE 3130 Alouette II immatriculé : F-GHTU construit en 1960
propriétaire SARL Heli Centre, à Cournon d’Auvergne (63800) mais enregistré le 18/3/1992
Le SE 3130 Alouette II immatriculé : F-GJLN construit en 1964 => propriétaire EURL Auvergne Héli Services à Clermont Ferrand (63100) mais enregistré le 26/8/1994
Le SE 313 B Alouette II immatriculé : F-GTMC construit en 1961 => propriétaire M. Allafort Frederic, port d’attache l’aérodrome de Brive (19100) mais enregistré le 16/8/2001
L’idéal aurait été de trouver un appareil comme la SA 318C Alouette Astazou F-GERG construite en 1956 et enregistrée le 9/5/1960 (donc avant 1967) mais celle-ci a son port d’attache sur Paris. Son propriétaire aurait pu faire le trajet jusqu’en Auvergne (et au delà) mais l’avion aurait dû être plus rapide et confortable, surtout pour transporter 4 ou 5 personnes à plus de 400 Km.
Tentons de faire le tour des différentes hypothèses…
A/ Tourisme
Le téléphérique du Lioran avait été inauguré par G. Pompidou le 11 juin 1967. La « machine » avait disparu dans cette direction. Une famille de touristes aisés aurait-elle pu faire une promenade aérienne en hélicoptère ? Essayons d’étudier cette hypothèse. On parle effectivement, au cours des mois qui suivent l’inauguration, de son succès (40 000 passages d’après La Dépêche d’Auvergne du 1er septembre 1967) et des divers aménagement prévus aux alentours, notamment une ville, mais rien de plus. On peut essayer de se mettre à la place du propriétaire d’un tel hélicoptère qui, avec quatre places coûte beaucoup plus cher qu’un modèle plus classique. S’il désire se lancer dans le tourisme, il faut qu’il se fasse connaître. Dans les années 1950-1960, grâce à la très forte croissance économique, la publicité vit des moments de gloire. Elle est la vitrine de nouveaux secteurs économiques alors en plein essor comme le transport et les loisirs. L’annonce presse et l’affiche restent, pour cette période, les deux supports privilégiés de la publicité. Si des sociétés proposaient des transports touristiques en hélicoptère en 1967, on devrait logiquement en trouver des traces dans la presse. J’ai par exemple découvert une publicité passée par un certain Jean Vidal (35, place de la liberté à St Flour) pour la location et la vente de postes de télévision dans le Cantal (Montagnard du 7 avril 1967). J’ai aussi trouvé une publicité pour les vacances en train dans Transmondia - Spécial Aviation 1967 du mois de mai, mais rien sur le tourisme en hélicoptère. J’ai consulté divers journaux de la région (et au-delà) mais je n’y ai relevé aucune publicité, pas même d’allusion. J’ai même consulté en vain le Musée de la Publicité et le Musée du Bourget. La seule illustration que j’aie pu trouver (ci-dessous) se trouvait dans une brochure publicitaire de Sud Aviation. Le port d’attache de cet appareil était en région parisienne. Cette photo avait été réalisée pour vendre le produit à l’étranger (en l’occurrence en Allemagne…).

En lisant le livre d’André Morel, je découvris qu’il avait animé - en 1957 - une conférence de presse sur l’avenir de l’hélicoptère et ses utilisations civiles ! Il me répondit à ce sujet : « A l’occasion du centième anniversaire des apparitions de Lourdes qui devait y attirer une foule considérable de pèlerins venus du monde entier, la SNCF avait décidé, à titre publicitaire, de sponsoriser des baptêmes de l'air en hélicoptère près de la grotte de Lourdes. Etant originaire de la région la SNCF m'avait chargé d'organiser et de réaliser cette mission. Trouvant ridicule d'ennuyer les pèlerins avec le bruit d'un hélicoptère et le survol de la foule des pèlerins ne présentant aucun intérêt touristique, j'ai persuadé la SNCF de tenter l'expérience à Cauterets, d'où j'étais originaire et où les magnifiques paysages des Pyrénées permettaient des vols touristiques très spectaculaires. Cette mission a commencé le premier juillet 1958 et elle devait durer les trois mois d'été. Devant son succès elle a en réalité duré 15 années successives (prise en charge par la société Gyrafrance) et ne s'est arrêtée qu'en 1973, après que j'ai eu effectué plus de 1200 heures de vol, lorsque j'ai moi-même décidé de quitter la région… »
Sa réponse confirmait ce que je pensais. Seule une grosse société - en l’occurrence la SCETA, une filiale de la SNCF - pouvait financer ce type de projet. Je n’avais rien trouvé dans mes recherches car cela ne concernait pas la région Auvergne. Au sujet de Gyrafrance, la plus importante flotte d’hélicoptères d’Europe à l’époque (voir enquête en annexe 15), M. Morel me précisa qu’elle avait disparu depuis une dizaine d’année. Apparemment un dépôt de bilan. Originaire d’Algérie sous le nom de Gyrafrique, elle était spécialisée dans la prospection du pétrole dans le désert du Sahara, les travaux d’épandage agricole et les transports de matériaux, principalement les chantiers de montagne et les constructions de remontées mécaniques et lignes à haute tension.
En
2004, Eric Maillot avait quant à lui rencontré un
très ancien pilote (81 ans, brevet pilote avion en 1954)
décrit comme la « mémoire vivante »
du club d’Aurillac. Il n’y avait pas d’après
lui d'hélicoptère basé à Aurillac dans
le passé. L’aérodrome de Saint-Flour Coltines
n’était quant à lui pas encore ouvert. J’ai
téléphoné à deux sociétés
basées à Clermont-Ferrand qui proposaient des vols
touristiques en 2007. La première, Héli-club
d’Auvergne,
venait malheureusement d’arrêter ses activités.
Elle existait depuis une quinzaine d’année. Pour ce
qui est des années 60 mon interlocuteur me déclara : « Il
ne devait pas y avoir grand chose… ».
La seconde, Héli
Air Service,
partenaire de la « Carte aux trésors »
(F3) n’existait
que depuis 2001. Un responsable - M. Nicolas Boudard – me
signala que l’entreprise employait un ancien pilote. Je lui
transmis des questions par courrier. Ce dernier en prit
connaissance et en parla autour de lui. Il ne trouva
malheureusement aucune information. Le but principal des balades
aériennes est de survoler le parc régional naturel
des volcans d’Auvergne mais le parcours n’a été
créé que le 25 octobre 1977. Les sociétés
d’hélicoptères ne semblaient pourtant pas se
bousculer dans la région et, apparemment, elles ne duraient
pas très longtemps. Certaines semblent s’être
diversifiées pour survivre comme Jet
Systems Hélicoptère Services.
Cette société qui dispose de trois bases en France,
dont une en Auvergne, propose des baptêmes de l’air,
du traitement agricole, du transport de passagers, des services
pour la TV (etc.). Elle possède des hélicoptères
Hugues 500, des Bell (206 B3 et 47 G3), et des Ecureuils.
Malheureusement, elle n’existe que depuis 1987. A. Delmon me
signala aussi la société Hélivolcan
mais elle datait de 1989. J’en
profite pour rappeler que, selon Claude Poher, le pilote qui
aurait la malencontreuse idée de se poser pour « uriner »
(idée évoquée par Eric Maillot comme une
explication possible du cas de Cussac) risquerait purement et
simplement le retrait de sa licence de vol. Pour un pilote
professionnel (ex : Sté de tourisme) cela signifie le
chômage d’autant plus que l’immatriculation d’un
hélicoptère est clairement visible sur ses contours
(voir notamment un article d ans
la Voix du Cantal
du 9 septembre 1967 sur lequel je reviendrai plus loin). En
définitive, il était probablement plus simple à
l’époque de faire du tourisme en avion que dans un
hélicoptère. Un article paru dans Science
et Vie - Aviation
1967 précise
d’ailleurs qu’il existait déjà 3 000
appareils de tourisme en France. J’y ai ainsi trouvé
une publicité pour la location d’un quadriplace
rapide de grand tourisme. Un avion naturellement, pas un
hélicoptère. La Socota, filiale de Sud-Aviation pour
les avions de tourisme, offrait une gamme assez large basée
sur le Rallye (ex-Morane Saulnier) et le Gardan Horizon, tous deux
quadriplaces. M. Morel me précisa : « A
cette époque un hélico, Bell ou Alouette coûtait
environ 3 fois le prix d’un avion léger de même
capacité »
(un document de l’Armée de Terre que j’eus
l’occasion de consulter par la suite indiquait qu’une
Alouette II Astazou avec son lot de bord coûtait à
l’Etat 467.870 F en 1968 - voir annexe 11 - mais c’était
peut être un prix remisé car en 1970 la presse
parlait pour un particulier de 700 000 à un million de F).
En 1970, un hélicoptère de la société
Héli-Union, avec pilote et mécanicien, se louait
environ 1 000 F de l’heure. Il aurait aussi mieux valu être
implanté dans la région mais je n’ai trouvé
aucune Alouette enregistrée en Auvergne ou dans un
département contigu au Cantal (voir tableau précédent).
L’office du tourisme du Lioran (en Auvergne) m’a par
ailleurs confirmé que le secteur attirait déjà
les skieurs avant que le Conseil Général
n’investisse dans le téléphérique.
Parmi les divers moyens de communications qui existaient pour s’y
rendre il y avait la gare du Lioran. Elle existe depuis le début
du siècle dernier et permet notamment la liaison Clermont
Ferrand - Aurillac. Un employé de la gare m’a précisé
par téléphone qu’elle était à
800 m du téléphérique. Ce dernier - ouvert
début 1967 - rendait donc moins utile qu’auparavant
l’usage de l’hélicoptère. Lorsque l’on
veut rentabiliser un tel projet ou simplement survoler le Plomb du
Cantal, il y a des moyens de transport beaucoup moins onéreux
et surtout beaucoup plus confortables - la cabine n’étant
pas insonorisée - que l’hélicoptère. En
été, des vêtement clairs (et courts)
sont plus logiques pour des civils en vacances que les vêtements
sombres (et couvrant) observés à Cussac…
ans
la Voix du Cantal
du 9 septembre 1967 sur lequel je reviendrai plus loin). En
définitive, il était probablement plus simple à
l’époque de faire du tourisme en avion que dans un
hélicoptère. Un article paru dans Science
et Vie - Aviation
1967 précise
d’ailleurs qu’il existait déjà 3 000
appareils de tourisme en France. J’y ai ainsi trouvé
une publicité pour la location d’un quadriplace
rapide de grand tourisme. Un avion naturellement, pas un
hélicoptère. La Socota, filiale de Sud-Aviation pour
les avions de tourisme, offrait une gamme assez large basée
sur le Rallye (ex-Morane Saulnier) et le Gardan Horizon, tous deux
quadriplaces. M. Morel me précisa : « A
cette époque un hélico, Bell ou Alouette coûtait
environ 3 fois le prix d’un avion léger de même
capacité »
(un document de l’Armée de Terre que j’eus
l’occasion de consulter par la suite indiquait qu’une
Alouette II Astazou avec son lot de bord coûtait à
l’Etat 467.870 F en 1968 - voir annexe 11 - mais c’était
peut être un prix remisé car en 1970 la presse
parlait pour un particulier de 700 000 à un million de F).
En 1970, un hélicoptère de la société
Héli-Union, avec pilote et mécanicien, se louait
environ 1 000 F de l’heure. Il aurait aussi mieux valu être
implanté dans la région mais je n’ai trouvé
aucune Alouette enregistrée en Auvergne ou dans un
département contigu au Cantal (voir tableau précédent).
L’office du tourisme du Lioran (en Auvergne) m’a par
ailleurs confirmé que le secteur attirait déjà
les skieurs avant que le Conseil Général
n’investisse dans le téléphérique.
Parmi les divers moyens de communications qui existaient pour s’y
rendre il y avait la gare du Lioran. Elle existe depuis le début
du siècle dernier et permet notamment la liaison Clermont
Ferrand - Aurillac. Un employé de la gare m’a précisé
par téléphone qu’elle était à
800 m du téléphérique. Ce dernier - ouvert
début 1967 - rendait donc moins utile qu’auparavant
l’usage de l’hélicoptère. Lorsque l’on
veut rentabiliser un tel projet ou simplement survoler le Plomb du
Cantal, il y a des moyens de transport beaucoup moins onéreux
et surtout beaucoup plus confortables - la cabine n’étant
pas insonorisée - que l’hélicoptère. En
été, des vêtement clairs (et courts)
sont plus logiques pour des civils en vacances que les vêtements
sombres (et couvrant) observés à Cussac…
B/ Pilote instructeur
André Morel, 86 ans, qui a été pilote instructeur sur planeurs, avions et hélicoptères m’a répondu : « … Dans les vols d'école c'est l'élève qui est toujours en place pilote par conséquent ces vols ont lieu sans passager qu'il s'agisse de l'Alouette ou du Bell 47. Il est certain que si un accident était survenu en étant en infraction avec cette règle les assurances auraient refusé tout recours. De plus actuellement la réglementation devient tellement draconnienne qu'elle décourage beaucoup de candidats qui envisageaient une formation aéronautique.... Cependant, lorsqu'on utilisait des appareils plus importants que les Bell 47, R.22 ou Hughs 300 (Alouette II ou III, Bell 206 etc) il est certain que lorsqu'on se rendait sur un terrain spécifiquement adapté au vol particulier qu'on allait y faire ( montagne, autorotations etc) pour éviter des convoyages onéreux on amenait avec soi les différents candidats ou élèves et une fois rendus sur place on les déposait pendant que leur collègue exécutait l'exercice prévu et lorsque la séance d'instruction était terminée on ramenait tout le monde avec soi au terrain de départ. »
Alain Delmon précise à ce sujet : « A cette époque bien plus encore qu'aujourd'hui le coût d'un permis privé était exorbitant. Je ne peux imaginer que dans cette région pauvre (Auvergne, Cantal), il ait pu se trouver au même moment 3 ou 4 quidams assez fortunés et motivés pour passer simultanément cette licence…si chacun des 3 ou 4 passagers-élèves doit tour à tour manœuvrer l'hélico ! Un tel hélico consomme de 100 à 150 litres à l'heure. En comptant 30 à 45 minutes par élève (ce qui parait ultra minimum pour pouvoir parler d'une "leçon" digne de ce nom), on dépasse les 2 heures de temps de vol, soit 200 à 300 litres minimum. On est là clairement en limite d'autonomie… Par ailleurs l’auto-rotation est un exercice potentiellement très dangereux, ayant déjà causé de nombreux accidents mortels. Il est très douteux que le pilote instructeur ait embarqué 2 ou 3 passagers dans ce cas. De même l’instructeur aurait demandé à son élève de le faire en plein milieu de la vaste parcelle, et non à 10 ou 20 mètres à peine d’une haie (20 mètres sont franchis très rapidement lors d’une descente non maîtrisée)… La question n'est pas de savoir s'il était à 10 m ou à 20 m de la haie, mais pourquoi il ne s'est pas posé bien plus loin, à 100 mètres, au milieu du champ! »
Cette phrase entraîna une nouvelle polémique puisque Eric Maillot lui répondit : « Prouve-moi aussi qu'à l'époque, comme le font souvent les agriculteurs qui ont des grandes pâtures, ce grand champ en herbe n'était pas utilisé en alternance pour le pâturage donc scindé dans sa largeur par un barbelé ou un fil électrifié en 2 zones : l'une avec vaches (à l'ouest) et l'autre zone à l'est sans vache (côté ovni) où l'hélico se serait donc logiquement posé vu l'absence de bétail... Prouve que ce n'est pas possible, ni logique. Quelles données possèdes-tu pour exclure cette pratique agricole connue ? »
Claude Pavy me répond à ce sujet : « Aucun souvenir d'une quelconque séparation, désolé. De toute façon, les vaches n'étaient pas dans le même champ que l'objet mais dans un autre de l'autre côté de la route. Comme séparation c'est pas mal ! Donc la remarque de Maillot ne tient pas, on se demande même s'il a regardé le plan des lieux publié dans le bulletin du Gepa !… »
J’ai pour ma part bien compris ce que sous-entend Eric Maillot. Néanmoins, pour ceux qui ont vu cette grande pâture (ou son tracé sur un plan, voir ci-dessous), il est plus pratique (et plus économique) de faire une séparation Nord/ Sud que Est/Ouest. Et même là, on constate que la machine n’a pas cherché la facilité. Faut-il y voir une volonté de se dissimuler ou de se mettre à l’abri du soleil ? De plus, Eric Maillot lors de son passage sur place en 2004 n’a jamais mentionné de séparation dans ce champ. Aucune séparation Est/Ouest n’est visible sur les photos prise en 2004. J’ai néanmoins contacté le conservateur des hypothèques d’Aurillac qui moyennant finance (pour l’Etat) m’a communiqué les copies de documents qui montrent que le terrain appartenait en indivision aux membres d’une même famille (suite à un héritage). Cette famille possédait à l’époque de très nombreuse parcelles. Aujourd’hui, le terrain appartient encore à l’un de ses membres. En 1967, parmi les parcelles de cette famille, on en trouve une très proche (d’une taille au moins identique à celle des DH) où auraient pu aller en alternance des vaches. J’ai tenté de contacter le propriétaire par téléphone mais sans obtenir de réponse. Finalement, j’ai reçu un courrier de sa part fin août où il me confirmait que l’hypothèse (voir bas de la page précédente) d’Eric Maillot était la bonne. Eric Maillot avait montré précédemment qu’un hélicoptère pouvait atterrir assez près d’une haie d’arbre. Cela signifiait qu’il pouvait atterrir aussi assez près d’une clôture (évidemment plus basse qu’un arbre…) près du centre du pré. Je signale au passage que le propriétaire a hérité du terrain de ses parents. Il a entendu parler de cette « machine » qui s’était posé dans son pré. Il ne la compare pas à un hélicoptère bien que j’utilise le terme dans mes questions. On peut en déduire que certains villageois n’avaient pas de réponses ou d’idées préconçues sur la nature de l’objet à l’époque, car il aurait pu ajouter : « le fils du maire a raconté une histoire, il a confondu avec un hélicoptère, tout le monde le savait, mes parents me l’ont dit… ». Non, il ne dit rien dans ce sens…
On peut aussi remarquer que si le quatrième « inconnu » est le seul (cela reste à prouver) à « s’élever » dans cette observation, ce sont par contre les pieds du troisième qui sont observés (voir Hebdo). Celui-ci est donc visible « au niveau du sol ». Le bout des « béquilles » (en forme de boules) est aussi visible. L’herbe ne semble pas très haute. Elle a donc été mangée (broutée) récemment. On ne peut pas exclure totalement la présence de vaches quelques part dans cette partie du champ au moment de l’atterrissage. D’ailleurs La Montagne du 1er septembre mentionne que « l’endroit a été piétiné, entre temps par les vaches ». Si le journal est imprimé la veille, l’observation ayant eu lieu un peu avant midi le 29 août, cela laisse - encore une fois - très peu de temps au journaliste pour venir sur place et recueillir cette information auprès de F. DH. L’emplacement a probablement été piétiné le 29 ou le 30 août au plus tard. On peut en conclure que les vaches étaient sur cette parcelle (côté « machine ») dans la matinée du 29 août car il n’y avait aucun intérêt à y amener du bétail par la suite si l’herbe était déjà basse. Dans ce cas, pourquoi avoir posé la « machine » de ce côté là si ce n’est pour la dissimuler derrière la haie ?
On verra aussi plus loin qu’un terrain devait être habilité pour ce type d’exercice. Ce qui n’est pas le cas du pré de Cussac où a eu lieu l’observation. De plus, des exercices (d’autorotation ou autres) auraient logiquement dû se succéder pour chaque élève. A. Morel précisant : « on les déposait pendant que leur collègue exécutait l'exercice prévu ». De même, on s’entraîne au poser « en pente » en haute ou moyenne montagne mais pas dans une zone du culture et de prairie relativement plate. Ce n’est de toute façon pas ce qui est décrit par les enfants. On peut aussi imaginer que le propriétaire n’aurait sûrement pas apprécié de voir un hélicoptère se poser au milieu de ses bêtes (voir déjà la réaction d’un cultivateur en 2004 quant il a vu E. Maillot et ses collègues tourner autour du pré…).
Tentative de reconstitution d’après les éléments d’enquête du G.E.P.A.N.

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) et Héli-Union
Aucune information n'est disponible dans leur documentation ni même leurs archives pour répondre précisément à nos questions portant sur l'usage de techniques aéroportées à des fins de prospection dans le Cantal. On m’a juste répondu que des autorisations de survol de territoire doivent être obtenues auprès des préfectures des zones concernées (avec restriction pour certaines infrastructures stratégiques). La police de l'air doit être avertie et le matériel de mesure embarqué doit être déclaré et faire l'objet d'une autorisation administrative pour son utilisation. C'est donc auprès de ces organismes (Préfecture et Police de l'air) et de leurs archives que le B.R.G.M. pense que je pourrais « peut-être » trouver des informations. Si le B.R.G.M. ne peut me répondre, il n’y a quasiment pas d’espoir que la préfecture ou la police de l’air puissent le faire vu le nombre de dossiers traités depuis 1967. La demande a pu précéder de plusieurs semaines la date de l’observation (et je n’avais déjà trouvé aucun ufologue pour m’aider à fouiller les archives militaires…). J’ai néanmoins constaté sur le site de l’association civile qu’il n’y avait aucun hélicoptère associé au propriétaire ou locataire « B.R.G.M. ». Il devait probablement en louer, comme par exemple à Héli-Union.
La société Héli-Union, créée en 1961, est rapidement devenue le premier opérateur d’hélicoptères. André Morel avait rencontré son fondateur, Jean-Claude Roussel, peu de temps avant qu’il ne la fonde. En 1967, près de la moitié de la flotte (12 Alouette II - dont 3 Astazou - et 3 Alouette III) opère en France. Les hélicoptères étaient basés à Paris, Tarbes et Grenoble. Un aller-retour Tarbes - Grenoble ne pouvait pas passer par le Cantal. D’ailleurs, l’école et les travaux en montagne étaient à l’époque deux départements différents. L’école était gérée directement par Héli-Union Paris et les travaux en montagne était gérés par Grenoble. Les Alouette II servaient à la formation, aux missions de T.A. divers (notamment le cinéma). Les Alouette III étaient destinées au travail en montagne et à la télévision. Réalisant aujourd’hui plus de 70% de son chiffre d’affaire à l’international, la société est présente sur 4 continents. Elle s’occupe notamment de prospection géophysique (électro magnétisme, VLF, spectrométrie). Le terme VLF signifie « Very Low Frequency » ou encore émetteur d’ondes à très basse fréquence. Héli-Union fournit habituellement un service « clé en main ». Je pris contact avec cette société fin juin 2007. Mon contact - Olivier de Marolles - n'ayant rejoint la société qu'au début des années 2000, il me conseilla d'entrer en relation avec M. Eric Tresamini qui avait longtemps été pilote chez Héli-Union. Il était aussi président de l'Amicale des Anciens d’Héli-Union et travaillait à présent chez Eurocopter. Je lui téléphonai aussitôt mais j’appris que malheureusement il n’avait travaillé pour eux qu’à partir des années 80. Il me communiqua les coordonnées de Charles Schmitt, l’une des personnes qui avaient contribué au développement d’Héli-Union. Ce dernier me contacta quelques jours plus tard : « Bonjour, je viens de rentrer de voyage et j’ai trouvé votre courriel. J’exploitais effectivement des hélicoptères durant cette période de 65 à 70 en qualité de chef pilote d’Héli Union. Nous exploitions des ALII, des Lamas et des AL III, la majorité d’entre elles étaient achetées neuves à Sud Aviation puis à Aérospatiale. Nous avons effectué des opérations de géophysique en France en particulier la recherche d’uranium pour le compte du CEA, si je me souviens bien l’activité s’est déroulée dans le secteur de la Souterraine. L’équipage était composé d’un pilote, d’un navigateur et d’un technicien chargé des enregistrements et de l’exploitation des données…». Il ajouta qu’il ne se souvenait pas d’être intervenu dans le Cantal à l’époque. L’équipage (3) n’était pas assez nombreux pour correspondre à l’observation de Cussac et la région, bien que proche, n’était pas le Cantal mais la Creuse.
=> Que pouvait-on prospecter dans le Cantal ?
L’industrie de l’uranium est la dernière-née des industries minières, tant en France que dans le monde. Dans les années 50 tout le territoire a été parcouru par des prospecteurs. En 1965, les grands districts miniers sont déjà en place, les ressources globales (y compris celles qui sont exploitées) sont estimées à 38 600 tonnes d’uranium. La part du lion revient au CEA qui possède 65 % des réserves métropolitaines sur 3 divisions minières. Les exploitants privés se répartissent les 35 % des réserves restantes sur trois principaux secteurs : Bretagne, Lozère et Saint-Pierre du Cantal. Le gisement du Cantal a été exploité de 1955 à 1982 par la SCUMRA (Société Centrale de l’Uranium et des Minerais Radioactifs). Il produisait environ un millier de tonnes. Ajoutons que dans ce domaine en particulier, il n’était pas vraiment utile de prospecter à l’époque de l’observation de Cussac. En effet, les mines d’uranium subirent une première récession dans les années 60 en raison d’une surproduction et du retard pris dans les programmes d’installation des centrales nucléaires. Cela provoqua une baisse des prix. Il fallut attendre le premier choc pétrolier de 1973 pour relancer la prospection et la production. Pour le reste, le Cantal est un département encore rural où l’élevage bovin pour les produits laitiers (fromages) constitue la ressource essentielle. L’industrialisation y est très faible, je ne vois donc pas ce que l’on pouvait encore espérer prospecter en 1967 dans cette région. Les divers journaux de l’époque que j’ai consultés ne mentionnent aucune prospection par hélicoptère en Auvergne. Une telle recherche aurait nécessairement duré plus d’une journée - vu la surface à couvrir - et aurait été relatée par la presse. Je signale au passage que l’usine de traitement du minerai de Saint-Pierre ferma en 1985. Les habitants ont depuis découvert que la commune avait été contaminée. On y relève par endroit jusqu’à 5 000 becquerels, contre 200 en temps normal…
D/ EDF
Alain Delmon qui a fait des recherches nous communique les informations suivantes :
« Les hélicoptères EDF étaient utilisés principalement en 1967 pour la surveillance aérienne des lignes HT. Dans ce cas il est inutile d'avoir un équipage de 4 personnes, qui diminue d'autant l'autonomie. Ils furent également utilisés plus tard en tant que "grue" aérienne, pour le levage de charge lourde en terrain difficile. Dans ce cas aussi il est exclu que l'hélico soit chargé avec un équipage au complet (4 personnes), qui réduit d'autant sa capacité d'emport. Cette thèse est également incompatible avec l'explication "plongeurs". De nos jours le Cantal dépend du CRTT Sud Ouest, dont la Base Nord à Rodez couvre la Gascogne, le Limousin, l'Auvergne, le Cantal et le Forez Velay. La distance Rodez => Cussac est de moins de 100 km à vol d'oiseau. Donc compatible avec un aller-retour avec équipage réduit et une courte mission de levage ».
Mais y avait-il un hélico EDF à Rodez en 67 ?: «Hélas, non :"Un nouveau Agusta-Bell 47 G2 est acquis en mars 1963 (n°284 F-BLGT), en remplacement du F-BGOS . Disparition du Bell 47 G2 F-BHAD dans l'incendie du hangar, où il y était remisé pour la nuit, à l'aéroclub de Lens. La production et le transport se divisent ; la France sera sectionnée en Centres Régionaux du Transport. Seuls les Centres des Alpes et de Paris seront couverts par un hélicoptère. Et ce, jusqu'en 1974, date à laquelle un troisième centre reçoit un hélicoptère, ce qui porte le parc EDF à trois appareils seulement, des "lamas" (des Alouette II modifiées). Il n'y avait donc aucun appareil EDF à proximité. Bien sûr un prêt de centre à centre n'est pas totalement exclu. Mais ça ferait encore une "coïncidence" de plus. NB : le seul appareil de type Alouette en service en 1967 était une Alouette II immatriculé "F-BIEC", en service en zone de montagne depuis 1957. La seconde Alouette II n'est arrivée qu'en Avril 1968, soit bien longtemps après l'épisode de Cussac. » (24)


Pierre Vincent, l’homme en « blanc » © RTE © Médiathèque RTE / MEIJER Igor
En effectuant des recherches, notamment sur le site de la DGAC, j’ai pu obtenir quelques informations sur les premiers hélicoptères E.D.F. :
E.D.F achète son tout premier hélicoptère Bell en 1952. Ce type d’appareil ne peut embarquer que 3 personnes au maximum. Il aura un accident - sans victime - un an plus tard alors qu’il avait été prêté au Centre National d’Etudes des Télécommunications. Détruit à 70 %, il est irréparable.
Le Bell 47 D1 (n°609 F-BGOS) a été construit en 1952. Après avoir appartenu à EP Electricité de France, il change de propriétaire en 1959 et part pour Alger. Il reviendra en France en 1963 et son port d’attache deviendra l’aéroport de Frejorgues (départ 34). Il changera encore deux fois de propriétaire. Il est toujours en service.
Un Bell 47G-2 de 260 CV (n° 1496 F-BHAD) est enregistré pour la première fois le 14/06/1956. Son propriétaire est EP Electricité de France. Il a été radié des registres de la DGAC. Il a brûlé dans un hangar, où il était remisé pour la nuit, à l’aéroclub de Lens en 1964.
Un second Bell 47G-2 (n° 284 F-BLGT) a été enregistré à la DGAC le 30/04/1963. Il a été construit sous licence par Agusta (filiale de Bell en Italie). Il est revendu par E.D.F. en 1974. Il appartient d’abord à SA France Aviation (78117 Chateaufort) puis à M. Jean-Pierre Guérin à Boissy les Perche (28340). Il est actuellement radié des listes de la DGAC. Probablement hors service.
L’Alouette II immatriculée (n°1083-04) F-BIEC a été enregistrée par EP Electricité de France auprès de la DGAC en 1957. C’est le 83ème engin de cette lignée. Tous les précédents ont été livrés à l’armée. Elle est classée en tant que SA 315 B donc un hélicoptère LAMA, véritable « grue volante ». Le prototype du SA 315 ayant volé en 1969, le F-BIEC a donc dû être transformé en LAMA (à Marignane) entre le mois de décembre 1970 et le 15 février 1971. C’est principalement cet appareil qui nous intéresse dans le cas de Cussac. Son second et actuel propriétaire est SA Avions Pierre Robin Centre Est aéronautique qui l’a acquis en 1978.
E.D.F. avait demandé pour ses appareils une peinture ayant un reflet bleu/vert particulier. On se rappelle que Anne-Marie parle d’« argent bleuté ». Est-ce une coïncidence ou plus simplement le reflet du ciel (bleu) sur la «Machine » ? A. Delmon précise à ce sujet : « Certes le reflet du ciel sur la verrière d'un hélicoptère peut donner à celle-ci, vue de loin une couleur bleutée. Mais dans ce cas, cette même verrière bombée n'était alors pas du tout "brillante" au point d'éblouir et aveugler les enfants. Dans ce cas, rien n'empêchait que les enfants voient distinctement la queue, la superstructure, le rotor, bref ... un hélicoptère posé au sol !».
Une ligne à haute tension passe au Sud-Sud/ Est de Cussac (voir « plan de situation », ligne fléchée). L’inspection d’une telle ligne nécessite parfois de parcourir de longues distances. Le pilote (avec son casque blanc) doit tenir compte du poids des passagers afin de gérer sa consommation en carburant. Le transport de 4 ou 5 personnes semble apparemment contre-indiqué pour remplir une telle mission. Nous allons voir si ma déduction est juste.
J’ai questionné EDF par l’entremise de son site internet le 14 mars 2007. Une semaine plus tard, j’ai reçu un message du Réseau de Transport de l’Electricité (RTE) m’invitant à prendre contact directement avec le Services des Travaux Héliportés de RTE (STH). J’ai aussitôt envoyé un courrier à l’adresse indiquée (RTE / STH 225, Chemin de la Croix Blanche 13300 Salon-de-Provence).
Le 7 mai 2007, je reçus un message de l’assistante de direction de RTE. : « Après avoir questionné nos responsables, nous ne pouvons malheureusement pas vous donner ces informations ! En effet, nous n’avons pas d’archives historiques de ce type… ». Je décidai aussitôt de lui téléphoner. Finalement, une personne très chaleureuse me communiqua le numéro de téléphone d’un ancien pilote, M. Christian Sornette. Ce dernier me confirma qu’il avait bien piloté l’Alouette II F-BIEC mais en 1968. Il me donna le nom de l’un de ses prédécesseurs : Pierre Vincent, le premier pilote EDF. En cherchant dans les pages jaunes, je réussis à le retrouver. Il habitait dans les Bouches-du-Rhône. Lorsqu’il commença à travailler pour EDF le 15 janvier 1953, c’était la grande époque de la construction des barrages. Des sites souvent difficiles d’accès. Aux lignards comme aux hydrauliciens, l’hélicoptère offrait un nouvel horizon. La presse se fit le témoin de leur succès et de leur dévouement (dans le Cantal, comme ailleurs…). Il fut même détaché en Hollande, avec son appareil, pour secourir les victimes des inondations de 1953. Jusqu’au début de l’année 1968, il n’y avait que deux pilotes. Il était le seul à piloter l’Alouette II en 1967. Le second pilote, Roland Fetiveau avait rejoint Issy-les-Moulineaux pour la Direction Générale. Il y était chargé, avec son Bell 47 G2, des missions photo et cinéma à des fins topographiques et météorologiques. Par la suite, Pierre Vincent travailla principalement dans les Alpes. Il fut à un certain moment sur le secteur de Clermont-Ferrand mais il n’y faisait que des visites de lignes (aujourd’hui, 80% du temps de vol y est consacré). Un article dans La Voix du Cantal du 9/9/67 (page 2) mentionne à ce sujet que des personnes habitant approximativement 20 Km à l’ouest d’Aurillac avaient connaissance de la présence en Auvergne d’un hélicoptère assurant la surveillance de la ligne à haute tension en direction de Laval-de-Cère II ( "Laval de Cere II" fait référence à une tranche de travaux réalisée en 1967 sur le barrage et la centrale hydro-électrique EDF de Laval de Cere => http://www.industrie.gouv.fr/energie/hydro/biblio/candes.htm).


© Médiathèque RTE / LE LOET Loïc © RTE
A gauche, des agents du GIP Sud-Est taillant un poteau en bois à l'aide d'une tronçonneuse suite à des intempéries survenues dans la région du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, le 2 mars 2001. Rappelons qu’à Cussac, au mois d’août 1967, il faisait beau temps…
A droite, Pierre Aigouy (le mécanicien) et Christian Sornette (le pilote « barbu ») à partir de 1968


Juxtaposition de la photo du « F-BIEC » et de celle de l’Hebdo de 1968
L’ensemble de la structure (cabine, pales, train, queue) est visible…pas vraiment sphérique…
L’appareil de Pierre Vincent n’embarquait que deux contremaîtres équipés d’un magnétophone qui servait à noter les anomalies détectées au cours de la visite. Lors d’interventions (Alpes) il emmenait des équipes de 4 hommes le matin et les récupérait le soir. A midi il leur apportait le repas. Il lui arrivait aussi de transporter des charges lourdes. Il ne pouvait pas dans ce cas emporter 4 hommes. Il ne se souvient pas d’être intervenu dans le Cantal, mais se rappelle par contre des travaux dans la « Vallée des Merveilles » du côté de Nice. Il semble avoir gardé de bons souvenirs de cette époque et notamment des « gros souliers », les hommes d’intervention. Il n’a malheureusement aucune photo les montrant en action. Lors de dépannages dans la vallée, c’est un camion qui allait sur place. Il m’a précisé que si pour une raison particulière il avait dû conduire une équipe sur place, il l’aurait emmenée au plus près de la ligne (et pas à plus de 2 km comme à Cussac). Il ne s’est jamais posé dans un champ sans avoir l’autorisation du propriétaire. Le pilote Christian Sornette arrivera en 1968. Il semble qu’il faille donc abandonner cette piste.
 |
 |
| Aucune lettre du numéro de série de l’appareil n’est mentionnée par les enfants de Cussac…© RTE | Pierre Vincent et un agriculteur Un homme reconnu pour ses qualités humaines © RTE |
Concernant Laval de Cère, Alain Delmon m’a apporté cette information : « Selon moi, Laval de Cère se trouve sur la rivière "Cère", plus à l'ouest du Cantal. La ligne haute tension qui en part, file vers le Nord/Nord Ouest, en direction de Limoges. Elle ne passe pas du tout près de Cussac* et encore moins de Clermont-Ferrand. En revanche j'ai trouvé précédemment la ligne HT qui passe près de Cussac, qui a globalement une direction Nord/Nord Est, qui part d'une centrale hydroélectrique sur la rivière "Truyère" au sud et file N/NE vers St Flour (un peu à l'ouest en fait, vers Savignol de mémoire). » (* Remarque : la « machine » part dans la direction opposée à cette ligne)
La « houille blanche » générée par la Truyère représente 10 % de l’énergie hydraulique produite en France. Simple ruisseau au départ, la Cère coule quant à elle dans une vallée relativement étroite jusqu’à Vic sur Cère, puis s’engage dans des gorges étroites et impressionnantes avec une dénivellation de 260 m sur 21 Km pour rejoindre Laval de Cère et la Dordogne à Bretenoux. L’aménagement de Laval de Cere II (le barrage de Candes) s’est terminé en 1967. Les habitants du Cantal (et notamment ceux de l’ouest) devaient s’y intéresser puisque la Cère prend naissance près de chez eux. Je reparlerai un peu plus loin de cette partie du Cantal suite à un événement très particulier survenu en septembre 1967…

Carte des lignes EDF transmise par A. Delmon (ajout de l’emplacement approximatif de Cussac)
Plus de 2km entre Cussac et la ligne
E/ IGN (Institut Géographique National)
D’après le site internet de l’I.G.N., aucune mission photographique n’a couvert la commune de Cussac entre 1948 et 1987. Alain Delmon précise de son côté : « L’IGN, organisme issu de l’armée, a utilisé uniquement des avions (exemple : Boeing B-17). Des hélicoptères seraient moins adaptés à la photographie haute résolution (à cause des vibrations). Ils sont de plus inutiles : on ne cherche pas une capacité de décollage / atterrissage tout-terrain, ni même à faire du sur-place, mais juste à survoler à vitesse constante une zone afin de prendre des photos. A titre exceptionnel néanmoins, des hélicoptères furent utilisés en complément des avions, afin de faire des photos obliques à basse altitude, afin de mieux évaluer les dégâts de la fameuse tempête de 1999 ». Pour la petite histoire, le 2 ou 3 juillet 1977, un hélicoptère de l’I.G.N. qui faisait des relevés topographiques a dû malencontreusement se poser dans le champ d’un agriculteur de Dolcourt. Ce dernier n’apprécia guère et porta plainte pour violation de propriété. Cette affaire confirme ce qu’avait déclaré C . Poher, à savoir que l’on doit toujours demander une autorisation pour se poser, et nous enseigne que deux ingénieurs sont largement suffisants pour ce travail. (Sources : Dauphiné Libéré du 4/7/77 et contre-enquête du G.E.P.U.N.).
F/ La sécurité civile
Le site internet du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire nous apprend que chaque année, les 40 hélicoptères de la Sécurité Civile, mis en oeuvre par 210 pilotes et mécaniciens sauveteurs, portent secours à 10 000 personnes. Implanté dans 21 bases en métropole et 1 en Guadeloupe, le Groupement Hélicoptères dispose à Nîmes d'un centre de formation des équipages et d'un centre de maintenance des appareils avec une cinquantaine de techniciens.
La sécurité civile dispose de 22 bases hélicoptères opérationnelles et d'une base de commandement et logistique située à Nîmes (Gard). Elles rassemblent 40 machines réparties comme suit : 30 EC 145, 6 Alouette III, et 4 Ecureuil.
Les missions des hélicoptères sont, par ordre de priorité décroissante, en notant toutefois que le secours aux personnes est toujours prioritaire :
. secours urgent et sauvetage
. lutte contre les feux de forêts – secours non urgents
. police et assistance technique
. mise en condition du personnel et du matériel
A chaque Zone de Défense correspond un secteur opérationnel qui dispose d'une base régionale. Les hélicoptères du Groupement Hélicoptères sont affectés aux secteurs opérationnels et répartis dans les bases et détachements implantés de manière permanente ou temporaire sur le territoire national. Pour répondre au mieux à l'exigence de rapidité d'intervention en mission de secours, une permanence est assurée sur toutes les bases ou détachements d'hélicoptères de 9 h 00 à l'heure du coucher du soleil (pour au moins un équipage). En dehors de ces horaires, l'équipage reste joignable par tout moyen approprié. L'hélicoptère doit être en mesure de décoller : dans les 30 minutes suivant l'appel lorsque l'équipage est en alerte sur la base (le délai est généralement plus court) ; dans l'heure suivant l'appel lorsque l'équipage en astreinte est en dehors de la base (domicile ou transit). Sur demande du COZ, et avec l'accord de l'échelon central, les bases dotées de deux appareils ou plus peuvent être amenées à maintenir en alerte un deuxième équipage, soit pour des missions de courte durée, soit en fonction de risques particuliers tels qu'inondations, feux de forêts ou autres catastrophes potentielles. Le premier exemplaire du nouvel hélicoptère de sauvetage et de secours (Eurocopter EC 145) du Groupement des Moyens Aériens de la Sécurité Civile a été réceptionné le 24 avril 2002 à Nîmes. Destiné à remplacer progressivement les Alouette III et les Dauphins il entre progressivement en service dans les bases, pour atteindre le nombre de 30 en 2005.
J’ai envoyé un courrier au mois d’avril 2007 à la base Hélicoptère de la Sécurité Civile de Clermont-Ferrand (139, avenue Brézet). Un mois plus tard, ne recevant pas de réponse, je décide de téléphoner. Mon interlocuteur m’annonce qu’apparemment, il ne dispose pas de beaucoup d’archives. Il me laisse néanmoins l’adresse d’une boîte aux lettres électronique où j’ai pu de nouveau poser mes questions.
A bout d’une semaine, j’ai repris contact avec la base de Clermont-Ferrand. J’ai découvert alors avec surprise que mon interlocuteur était justement en train de regarder mes questions. Il m’a appris tout d’abord que la base existe depuis 1961 et couvre toute l’Auvergne. Elle a toujours été dotée d’un seul hélicoptère à la fois. Elle possédait une Alouette II en 1967, remplacée par une Alouette III en 1973. Lorsqu’un hélicoptère est en intervention il ne demande - bien sûr - pas l’autorisation pour se poser ; néanmoins, en dehors de cela, il doit prévenir le propriétaire du terrain. Concernant les exercices avec plongeurs, ils se faisaient autrefois près du littoral car il n’existait qu’une dizaine de bases. Ces « manœuvres » avaient pour but de se prémunir contre les crues de l’Allier. Aujourd’hui, elles se font avec des plongeurs du Puy-de-Dôme. Pour ce genre d’exercice, mon interlocuteur m’a confirmé qu’il n’était pas nécessaire d’aller jusqu’au barrage de Grand Val (voir chapitre XII). Par la même occasion, il m’a signalé qu’un hélicoptère du SAMU était basé à Aurillac depuis une dizaine d’années (1996 précisément, j’ai vérifié). Eric Maillot avait trouvé dans un article internet 3 hélicoptères pour la base de Clermont Fernand. J’ai décidé de contacter l’auteur de l’article, Dominique Roosens, sapeur pompier passionné d’aéronautique. Ce dernier m’a confirmé lui aussi la présence d’un seul hélicoptère, m’écrivant à ce sujet: « Les bases ne recevaient qu'une machine et je situe plusieurs machines car elles sont passées par Clermont-Ferrand en différentes dates. Maintenant les machines avaient des contraintes d'entretien et montées sur Paris pour cela, donc une machine était nouvellement affectée dans la base. » La base de Clermont-Ferrand avait donc connu 3 Alouette II successives. J’ai pu retrouver les 3 appareils dans la base de la DGAC parmi treize autres aéronefs dont le propriétaire est « Etat/Ministère de l’intérieur service de la sécurité civile ». Ils ont tous été radiés. Parmi ces appareils on note un BELL 47J-2 et cinq SE 3130 Alouette II. Leur dernier port d’attache était Issy-les-Moulineaux. Fin juin, j’ai réussi à retrouver M. Roland Deval, ancien chef de la base de Clermont Ferrand. Selon lui les combinaisons de vol étaient de type « ALAT- vertes » (les « inconnus » de Cussac étaient « noirs »). Il ne pouvait malheureusement pas m’en apprendre davantage car il était arrivé à Clermont en 1975. Il n’avait plus de contact avec les autres navigants et les deux précédents chefs de base étaient décédés. L’hélicoptère pouvait naturellement transporter 4 personnes, mais cela dépendait du poids et de la mission. L’équipage conventionnel était constitué d’un pilote et d’un mécanicien secouriste. Il était mécanicien car il y avait parfois du treuillage à effectuer. Un treuil de sauvetage = 31 kg, installation sanitaire porte-charges (sans les brancards) = 45 kg, une installation de chauffage cabine = 6 à 10 kg, tout cela réduit d’autant l’autonomie de l’appareil…
Eric Maillot a émis l’hypothèse qu’un hélicoptère transportant une femme enceinte ou une personne âgée se serait posé en urgence afin que cette personne puisse uriner. Nous allons essayer de voir si la réaction de cet éventuel pilote est cohérente. Cet hélicoptère devait en toute logique avoir comme destination initiale un hôpital. Le plus proche se trouve à St Flour. Le secrétariat de direction du centre hospitalier de St Flour m’a indiqué par téléphone que l’établissement existait déjà en 1967. Le 14 mars 2007, j’ai reçu une lettre de Pierre Jarlier, sénateur-maire de Saint-Flour qui confirmait que le Centre Hospitalier a une histoire très ancienne. Par ses attributions, le monastère bénédictin à l’origine de la ville est l’ancêtre de l’hôpital. Il y eut par la suite un hospice connu sous le nom de Saint-Etienne. Celui-ci fut déplacé à la fin du XVIème et prit le nom d’Hôpital-Vieux. En 1755, il fut décidé - vu l’état de ruine - de construire un nouvel hôpital. L’ouvrage fut achevé en 1771. L’Administration publique en prendra la charge après la loi hospitalière du 21 décembre 1941. Il a évidemment subi des transformations internes, dont la principale, décidée en 1933, ne sera réalisée qu’en 1947, à cause de la guerre. Aujourd’hui, le centre hospitalier dispense des soins à une population d’environ 60 000 habitants. En effet, son attractivité s’étend au-delà des limites administratives du département du Cantal, notamment sur celui de la Lozère.


Alouette II utilisée près de la mer avec des roues F-ZBAC, une Alouette II de Clermont-Ferrand
pour faciliter les « appontages » Aucune « roue » sur cet hélicoptère
(Infos AGHSC – Amicale Sécurité Civile)
En résumé, si un hypothétique hélicoptère s’était posé en urgence à Cussac, il aurait dû logiquement se diriger vers St Flour, qui disposait d’un hôpital très connu, lorsqu’il a quitté le pré. Pourtant, le phénomène observé prend une tout autre direction (?) Si la réaction du pilote envers son passager (femme enceinte, personne âgée, etc.) est à la rigueur compréhensible, le décollage - en spirale - qui suit est totalement injustifié si, justement, il veut garantir le confort (et la sécurité) de son passager. Le pilote d’hélicoptère Pierre GILLARD précise à ce sujet : « Le décollage en spirale est possible mais non conventionnel…». Si maintenant cet hypothétique hélicoptère est en intervention et se dirige vers un accident il est totalement illogique - si l’un des membres d’équipage a besoin d’uriner - que toutes les personnes à bord descendent de l’appareil. Lors d’une intervention, la Sécurité Civile n’en profite pas pour flâner pendant que quelqu’un urine, d’autant plus qu’elle ne dispose que d’un seul hélicoptère pour couvrir toute l’Auvergne. A la rigueur, une personne serait descendue mais pas quatre. Si par contre, cet hélicoptère venait de déposer une personne à l’hôpital (déjà peu probable, étant donné qu’il y avait au moins 4 places de prises à bord) il devait logiquement rentrer directement sur Clermont-Ferrand. Pourquoi aurait-il fait un détour par Cussac ? S’il enchaîne sur une autre intervention, pourquoi se poser - vu l’urgence - à Cussac alors qu’il vient juste de quitter St Flour? Il n’y a d’ailleurs pas eu d’accident sur le secteur de Cussac ayant nécessité l’intervention d’un hélicoptère (voir plus loin « Gendarmerie »). On trouve décidément beaucoup trop d’invraisemblances.
G/ Epandage agricole
Une étude du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) pour la sécurité de l’aviation civile portant sur les accidents survenus lors d’épandages agricoles (réalisés en hélicoptère) sur le territoire français entre 1992 et 1999 concluait qu’ils représentaient la moitié des accidents de travail aérien. Trois types d’hélicoptères étaient concernés par l’étude : Bell 47 (37 accidents) , Hughes 300 (28) et Alouette II (4). 5 accidents avaient eu lieu en Auvergne mais rien n’indiquait qu’ils concernaient des Alouette. Je n’ai rien trouvé de particulier concernant l’année 1967 (voir plus haut DGAC) mais de toute façon, il y a fort à parier que l’on n’embarquait pas 4 personnes pour ce type de travail. La spécificité de l’épandage agricole par hélicoptère (travail à très faible hauteur près du sol et à très faible vitesse) fait que ce type d’appareil aurait été

connu des habitants de Cussac. Je doute malheureusement que les propriétaires de l’époque aient pu se payer ce type de service. On peut aussi remarquer que de face (ou même de côté), avec ses deux réservoirs, l’appareil n’avait pas un aspect très « sphérique ». Un équipement de pulvérisation agricole pour Alouette pesait à lui seul 90 Kg. Cela réduit d’autant l’autonomie de l’appareil. L’hélicoptère Djinn, plus ancien et moins cher, était davantage utilisé. Christophe BRAS de la cellule environnement de FREDON Auvergne m’a précisé qu’il n'y avait plus de traitement réalisé par hélicoptère en Auvergne aujourd'hui. La FREDON Auvergne est maître d'ouvrage des opérations du Groupe Régional d'Actions contre les pollutions des eaux par les Produits Phytosanitaires. Jérémie Bouquet, responsable Contrôles DRAF (Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt) - SRPV (Service de la Protection des Végétaux) Auvergne ajoute : « L'utilisation de l'hélicoptère pour appliquer des produits phytosanitaires a fortement diminué depuis les nouvelles dispositions concernant cette pratique (arrêté du 05/03/2004 relatif aux traitements aériens de produits phytosanitaires), et est cantonnée en zone de culture du Puy de Dôme et de l'Allier (quelques chantiers annuels seulement). Pour la période de 1965 à 1970 au mois d'août dans le Cantal : je ne sais pas, car je ne sais quelle était la réglementation à l'époque, et si nous avions des déclarations de chantier. » Le propriétaire actuel du champ où a eu lieu l’observation m’a certifié quant à lui qu’aucun hélicoptère n’avait effectué des épandages sur sa commune…
H / La Gendarmerie
Les gendarmes de deux brigades (Neuvéglise et St Flour) se sont rendus sur les lieux en fin de journée, le jour même de l’incident de Cussac. On n’a pourtant aucune connaissance d’un rapport de gendarmerie sur les événements. En 1983, T. Pinvidic passa à la gendarmerie de St Flour où un gendarme crut pouvoir lui affirmer qu’aucun procès-verbal concernant cet incident n’avait été dressé à l’époque. Les gendarmes de Neuvéglise ne purent lui apporter plus d’informations. Il fit la demande au Procureur de la République mais ne reçut aucune réponse.
Eric Maillot émit l’hypothèse en 1996 (dans Les Mystères de l’Est n°2, page 7/24) que la gendarmerie n’aurait pas rédigé de procès verbal pour ne pas ridiculiser un maire, après avoir eu confirmation que l’OVNI était un hélicoptère. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’imaginer une quelconque manipulation pour expliquer le cas. Fin février 1977, le commandant Cochereau, responsable du dossier OVNI au bureau des relations extérieures à la direction de la gendarmerie de Paris accorda une interview au journaliste Robert Roussel (qui écrira par la suite deux ouvrages sur le phénomène). Il lui précisa que les premiers dossiers dataient, officiellement, de 1954. A l’époque, il s’agissait d’établir s’il y avait violation du territoire national et de renseigner les préfets. Ensuite, la vague s’était apaisée. Les années qui ont suivi, la gendarmerie n’était pas encore pleinement consciente de l’intérêt de ces témoignages. Les enquêtes donnaient souvent lieu à un résumé succinct où l’enquête de moralité occupait la plus grande place. Ceci explique en partie pourquoi il ne faut pas s’attendre à trouver de révélations spectaculaires dans les archives de la Gendarmerie concernant le cas de Cussac. D’après le commandant Cochereau, entre 1954 et 1974, il ne s’est pas passé grand-chose. Il précise qu’il y a bien eu quelques apparitions très marquantes comme celle de Valensole ou de Marliens (il ne cite même pas Cussac), mais dans l’ensemble, cela reste limité. En 1974, une nouvelle « vague » fit son apparition. A peu près au même moment, le Ministre des Armées de l’époque, Robert Galley, déclarait sur France Inter que le phénomène OVNI était digne d’intérêt. Cela conduisit la Gendarmerie à recueillir systématiquement les renseignements lors d’observations. Il est vraisemblable que, les témoins étant mineurs, aucun procès-verbal ne fut établi. Eric Maillot avait émis une autre hypothèse plus intéressante que je voulais vérifier (extraits) : «Ce type d’appareil militaire (l’hélicoptère) s’affranchit des couloirs de vols réservés aux avions. Il se déplace en général en ligne droite d’un point à un autre, par principe d’économie de carburants et de temps… il suffit donc de prendre l’azimut donné par le site d’atterrissage et le sommet du plomb du Cantal, visible de Cussac, puis de prolonger la direction ainsi obtenue sur une distance d’au moins 250 km, environ la moitié d’autonomie d’un hélicoptère. Ensuite, il convient de regarder si sur cette ligne ou à proximité se trouve une base de l’A.L.A.A.T. ou de la Gendarmerie. On trouve alors, peu à l’écart de la ligne obtenue, le premier site possible : Egleton, détachement aérien de la gendarmerie. Renseignement pris, 1975 serait la date de création de ce détachement. Exit ce site ! Limoges est le deuxième candidat sur la ligne où se trouvent encore un détachement aérien et une base de la Gendarmerie Nationale. Les gendarmes, très aimables, m’apprirent que leur détachement n’existait pas en 1967 mais que celui de Feytiat était en activité. Ce détachement aurait été équipé principalement de Bell à pistons. Les Alouette étant principalement sur Bordeaux. Après consultation de carte, Feytiat est en banlieue de Limoges, très exactement sur la ligne de trajectoire, à environ 160 Km à vol d’oiseau de Cussac. La direction correspond parfaitement avec le témoignage ! »
Ayant appris que les archives de la Gendarmerie avaient été transférées du fort de Charenton (Maisons-Alfort) à Vincennes, là où se trouvaient déjà celles de l’Armée de Terre, je vis là une occasion inespérée de faire la démarche auprès des deux institutions. Le 16 avril 2007, après m’être fait délivrer une carte de lecteur, je me rendis au Département de la Gendarmerie Nationale (D.G.N.) afin d’avoir un entretien avec le gendarme chargé des archives. Il sembla très intéressé. En effet, on ne lui avait jamais demandé de renseignements sur les « sections aériennes ». Pendant qu’il recherchait les cotes nécessaires pour vérifier l’hypothèse citée ci-dessus, j’en profitai pour feuilleter Histoire de la Maréchaussée et de la Gendarmerie - guide de recherche sous la direction de Jean-Noël Luc (2004), qui s’ouvre sur les mots de Hegel : « Un peuple sans mémoire est sans défense ». Finalement, le gendarme me communiqua les renseignements et me transmit un formulaire de « demande de consultations d’archives publiques par anticipation du délai légal de communication » à retourner par la poste (BP 166 00468 Armées). Il me suggéra, très aimablement, d’en profiter pour demander les procès verbaux. J’y ajoutais les « procès verbaux accident » pour vérifier si un hélicoptère avait pu être demandé à l’époque sur ce secteur. Je joignais un courrier pour le conservateur ainsi que quelques documents pour appuyer ma demande. Le délai de réponse était deux mois. En cas de refus, il me faudrait attendre les 60 ans réglementaires, soit 2027, pour pouvoir y avoir accès. Les archives de l’Armée de Terre étant fermées, je remis à plus tard le dépôt d’une demande similaire auprès de leurs services. Entre temps, A. Delmon m’indiqua aussi que la formation était assurée à l’ESALAT de Dax puis à celle du Canet des Maures. Ce n’était donc pas non plus un vol d’école. Le 14 juin 2007, je reçus enfin une réponse. Le courrier précisait que les 8 documents que j’avais demandés ne contenaient aucune information relative à mon thème de recherche (OVNI, intervention ou passage d’hélicoptère…). Il était néanmoins précisé que l’étude du journal des services aériens du Détachement Aérien de Limoges (Feytiat) avait permis de découvrir un tableau attestant d’un vol hélicoptère le 29 août 1967. Il s’agissait malheureusement du vol de contrôle technique local d’un Bell 47 G2 (3 personnes maxi) ayant duré 5 mn. Un délai beaucoup trop court pour atteindre Cussac. On m’avait joint la copie du tableau. Cette réponse sous-entendait clairement qu’il n’y avait aucun procès-verbal sur l’observation de Cussac et qu’aucun hélicoptère de la gendarmerie n’était passé dans le secteur. Le document indiquait que l’équipage se limitait à deux gendarmes (1 pilote + 1 mécanicien) et pouvait éventuellement embarquer suivant la mission au moins un militaire d’une autre arme. Il me fallait abandonner cette piste. Suite à un courrier que j’avais adressé au Détachement Aérien de la Gendarmerie d’Egletons, je reçus une réponse (voir ci-dessous) qui indiquait qui n’y avait pas de possibilité de ravitaillement « avant 1967 » ( ?). Je pris contact aussitôt par téléphone avec le détachement où j’eus confirmation qu’il y avait une erreur dans le courrier et qu’il fallait bien lire « en 1967 ». Le gendarme (pilote) me précisa que l’aérodrome ne pouvait accueillir à l’époque que des planeurs et ne pouvait pas ravitailler une Alouette.

Le 24 octobre, je fis de nouveau une visite au service de la Gendarmerie pour prendre de nouvelles cotes. J’eus aussi confirmation que d’autres archives se trouvaient à Le Blanc. D’après l’officier de service, elles commençaient aux années 80. En fin de semaine, je postai une nouvelle demande de consultation et j’y ajoutai une demande spécifique portant sur les carnets de bord de 22 appareils. Il n’existait apparemment pas de cotes pour ce type d’archive mais je décidai néanmoins de tenter des les obtenir en joignant les numéros d’immatriculation des appareils. Pendant ce temps, Alain Delmon me signala que le gendarme P l’avait contacté. Alain Delmon me communiqua quelques extraits de ses échanges : « Je suis allé sur votre site internet et comme je suis gendarme aux hélicos, je vous confirme que le détachement aérien de Limoges Feytiat en 1967 était équipé d’un Bell 47 immatriculé FMJAD… techniquement, cela pourrait être possible à vitesse réduite mais le pilote aurait vite la tête tournoyante. Au niveau technique, rien n’empêche mais c’est un peu risqué tout de même… quant aux reflets, on arrive tout de même, malgré un reflet du soleil, à distinguer s’il s’agit ou non d’un hélicoptère ; dans ce cas, les témoins malgré leur jeune âge auraient fait la différence entre une machine connue et quelque chose d’inhabituel… de plus, le bruit particulier d’une turbine est assez reconnaissable. Il y a un sifflement soit, mais aussi le bruit du rotor qui se rapproche plus d’une machine « terrestre ». Je pense que les enfants auraient fait la différence entre un hélicoptère et une machine inconnue. Je crois les enfants. »
Fin décembre, ma demande de consultation fut agréée pour les dossiers ne contenant pas d’informations nominatives susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée. Pour les autres, je saisis la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (réponse négative). La réalisation de reproductions ne donnant pas de droit d’utilisation autre que privée, j’en profitai aussi pour demander l’autorisation de faire une diffusion restreinte à quelques chercheurs. Sans réponse, je décidai de censurer moi même les photocopies. Mon but n’était pas, de toute façon, d’en tirer profit. La consultation proprement dite eut lieu le 18 janvier 2008. La salle de lecture de la section de gendarmerie ne pouvait accueillir qu’une dizaine de personnes. La responsable des archives s’étant blessée au bras, elle me demanda de l’accompagner dans le stock pour récupérer les cartons que j’avais réservés. Le temps de charger un petit chariot, je commençai aussitôt à examiner les dossiers.
Cote n°105, registre du journal des services aériens (R.J.S.A.) de la section aérienne (S.A.) Lyon-Bron: le 29 août 1967, deux vols d’Alouette III (n°1098) avaient eu lieu pour effectuer des réglages. Ils n’avaient pas dépassé 15 mn. Après un échange de joints, une Alouette II (n°1117) transportant 5 cinq passagers avait volé pendant 20 mn. Tous ces vols avaient eu lieu dans la localité.
Cotes n°183 et 184, R.J.S.A. de la S.A. de Hyères (1965-1967) : le premier carton (cote n°183) n’allait que jusqu’au 15 août 1967. Le second (n°184) signalait le vol du SE3160 n°1122 avec 3 passagers. Il n’avait duré que 10 mn en local.
Cote n°195, les rapports (R/2) de la section aérienne de la Haute-Vienne Limoges (1966-1967) : un message « postalisé » du commandant du détachement permanent d’hélicoptère au commandant de la section d’hélicoptères à la Teste de Buch ( ?) indiquait « potentiel Bell 47 G2 F.MJAO n°203 du 21 au 31 août 1967 incluant les heures de missions s’élevant à 1h50 et heures CT (contrôle techniques ?) pour 45 mn ». Un déplacement à la Courtine (un site dont je parlerai un peu plus loin…) était signalé le 12 mai. Rien à signaler le 29 août. Le Bell G2 ne pouvait de toute façon pas emporter plus de 3 personnes.
Cote n°245, les rapports (R/2) de la division aérienne (D.A.) de Montpellier (1964-1967) : documents des plus divers. On y trouvait des courriers allant de la redevance pour consommation d’eau à la demande d’autorisation d’emploi de cyclomoteur. Un compte rendu de mission aérienne signalait néanmoins la recherche le 11 août d’un jeune campeur disparu suite à la crue de l’Ardèche aux Sauzes. Un autre document en date du 23 août rapportait qu’une Alouette II (n°1518) avait procédé à l’évacuation sanitaire d’un accident de la route de Mende à Montpellier. L’intervention avait eu lieu le 12 août et avait duré deux heures. Je notai aussi une mission d’observation préfectorale régionale qui avait eu lieu le 16 août. Rien à signaler le 29.
Cote n°260, R.J.S.A. de la D.A.de Montpellier (1966-1974) : plusieurs vols du SE3130 n°1518 jusqu’au 17 août puis plus rien avant le 30 septembre.
Cote n°364, J.M.O. de Toulouse (1957-1967) : les documents signalaient divers déplacements aériens (prise de vue aérienne, transport de personnel et matériel ORTF pour Cinq colonnes à la une, etc.) mais les archives s’arrêtaient le 30 juin 1967. Je signalai aussitôt le problème à la responsable de salle qui ne put me répondre. Je décidai de faire un courrier de réclamation dès mon retour.
Cote n°367, les rapports (R/2) de Toulouse (1966-1967) : le carton contenait des compte rendus de missions aériennes mais aussi des documents traitant de permissions, d’examens prénataux concernant les épouses de gendarmes, etc. Rien à la journée du 29 août 1967.
Cotes n°571 et 572, les rapports (R/2) de G.S.T.(Technique) de 1966 à 1967: à la suite d’une erreur, ces cotes avaient portées à la fois dans la partie agréée et la partie refusée. Le Gendarme m’avait signalé par téléphone avant ma venue que ma requête était en définitive agréée. Le premier carton (cote 571) s’arrêtait au 14 avril 1967. Il donnait néanmoins quelques informations intéressantes. On trouvait des convoyages d’Alouette SE3130 (n°1250 et 1518) en provenance de l’A.I.A. de Clermont Ferrand ou de l’A.C.H. (Atelier Central Hélicoptère Gendarmerie de Satory). J’aurai l’occasion de reparler de l’A.I.A. un peu plus loin. Un autre document donnait le coût de réparations d’ Alouette SE3130. Il donnait les numéros de série de chaque appareil et leurs lieux d’origine (parfois l’outre-mer). Un courrier du 6 janvier précisait que la gendarmerie utilisait 6 Alouette II SA3180 équipées de turbine Astazou II et souhaitait l’extension du domaine de vol du poids de 1 650 kg. A partir d’autres documents je pus déterminer que la plus grande partie d’entre elles étaient en poste en outre-mer. Les autres avaient toutes eu des pannes en 1967. De même, la section de Lyon devait posséder un SE3160 (Alouette III n°1098) qui avait aussi dû être réparé cette année-là. La gendarmerie possédait deux autres Alouette III. L’une d’entre elles (n°1122) était à Berre près de Marseille, l’autre (n°1160) à Satory. Pour se rendre à l’atelier central de la Gendarmerie, ces deux appareils n’avaient pas besoin de traverser le Cantal. Un télégramme de l’A.C.H. en date du 13 février indiquait que pour éviter la consommation potentielle de l’Alouette III (n°1122) et l’Alouette II (n°1087), les appareils seraient convoyés directement à Briançon puis pris en charge par des pilotes de la section d’hélicoptères de Lyon. Un chauffeur de l’A.C.H. devait rejoindre Grenoble en camion de dépannage. Là encore, il est difficile d’imaginer que ces appareils soient passés par le Cantal pour se rendre en région parisienne. Le second carton (cote 572) contenait divers courriers. L’un d’entre eux émanant de l’A.C.H. de Versailles Satory précisait qu’il y avait besoin en urgence d’une caisse pour transporter un hélicoptère par wagon. Cet appareil devait être rendu à la Réunion le 15 décembre 1967. Un télégramme du 16 juillet signalait le convoyage de Montpellier à Toulouse par une équipe de l’A.C.H. d’un SE3130 (n°1518). L’équipe devait arriver le 17 et l’hélicoptère devait être convoyé sur Clermont Ferrand le 18. L’appareil était probablement passé par le Cantal ce qui laisse supposer que les habitants (et les enfants) étaient habitués à voir passer ce type d’appareil. Il était dommage de ne pas avoir eu accès au J.M.O. de Toulouse (voir cote n°364) pour l’heure du vol. Je trouvai aussi dans le carton un autre document signalant une visite de contrôle à Sud Aviation le 19 août 1967. Aucun convoyage n’était signalé le 29 août 1967.
Cote n°617, R.J.S.A. de G.S.T. de Le Blanc (1966-1969) : au 29 août on pouvait trouver a) vol du Bell 1630 en local (Dijon). Durée : 35 mn avec 3 personnes à bord
b) vol du Bell 197 de Dijon à Auxerre. Durée : 1h 25 avec 3 personnes.
c) vol du Bell 197, d’Auxerre à Satory. Durée : 1h 35.
d) vol du Bell 197 en local durant 5 mn avec 3 personnes.
Puis autres vols en local (Satory) de 5mn chacun (à 2 ou 3 personnes).
Le 5 janvier 2008, je reçus un message électronique du lieutenant S : « Suite à votre demande en date du 19 janvier 2008, j'ai l'honneur de vous informer que les archives du Détachement Aérien de Toulouse, contenues dans le carton n° 364, sont lacunaires. En effet, nous ne détenons pas le journal des marches et opérations allant du 1er juillet au 31 décembre 1967. Ce document ne nous a jamais été versé et a vraisemblablement été détruit. »
I/ L’Armée de Terre
Le rapport du G.E.P.A.N. mentionnait (page A8-33) qu’il n’y avait pas eu de manœuvre militaire au moment de l’observation. Alain Delmon avait pu obtenir quelques informations d’un colonel (en retraite), nommé L, chef du service historique de la Base Pétrolière Inter Armées (B.P.I.A.) de Châlon-sur-Saône : « Le remplissage se faisait à l'époque soit directement par camion, soit par citerne souple… pour les petits hélicos, on pouvait ravitailler avec un " gros bidon " de +/- 200 litres et une pompe à main de type JAPY, le tout amené par un camion ou une camionnette. Il faut une bonne quinzaine de minutes pour faire un plein. Le type de carburant pour ces appareils est du TR0, spécifique pour les hélicoptères. Il m'a aussi dit qu'à cette époque, il y avait fréquemment des exercices en tenue NBC - à cause de la guerre froide -, impliquant des appareils venant de plus loin faisant des " sauts de puce " - par exemple Paris-Clermont, puis Clermont-Limoges (etc.). Enfin, le ravitaillement des unités de l'ALAT à cette époque dépendait de l'Armée de Terre et non du SEA ( Service des Essences des Armées qui, depuis 1945, gère l'approvisionnement en carburant de toutes les unités de l’Armée Française)… Et pour finir, toutes les unités ont un " journal de marche des unités" obligatoirement rempli pour toute mission. Ils sont versés régulièrement au Service Historique de l'Armée de Terre ou de l'Air au Fort de Vincennes et sont accessibles au bout de 15 ans. Ceux de 1967 sont donc libres de consultation ! »
Je passai au Département de l’Armée de Terre (DAT) à Vincennes à la fin du mois d’avril 2007. La personne pouvant m’aider à trouver les unités de l’époque étant absente, je laissai mon numéro de téléphone et la copie d’un article de presse sur Cussac. La semaine suivante, n’ayant pas de nouvelles, je décidai de téléphoner. L’Adjudant-chef Foucher que j’eus au téléphone semblait penser qu’il faudrait « un certain temps » pour trouver les cotes. Suite à ses conseils, je décidai de faire une demande écrite auprès du service. Un mois plus tard j’appris que ma demande était en cours d’examen et que je devrais avoir la réponse par courrier courant juin. Le 30 juin, je trouvai effectivement un courrier du Service Historique de la Défense qui me communiquait les cotes à consulter. Début juillet, je me présentai de nouveau à la DAT. La personne de l’accueil - bien qu’en tenue civile - semblait être en réalité, au vu des réponses qu’elle apportait aux personnes qui me précédaient, un militaire haut gradé. Ce dernier m’indiqua que je devais remplir un formulaire pour avoir l’autorisation de consulter les documents. La procédure était identique à celle de la gendarmerie. Il semblait qu’un militaire devait consulter le document avant qu’il soit mis à disposition du lecteur. On pouvait se voir refuser la demande ou apprendre seulement qu’il n’y avait rien en rapport avec le sujet de la recherche. On me précisa aussi que je ne pouvais consulter que 3 cotes par jour, 3 jours par semaine. Je me rendis compte que les 4 répertoires qui auraient pu me renseigner étaient déjà à ma disposition le premier jour où j’étais venu ; malheureusement, l’agent d’accueil (un « vrai » civil) n’en savait rien. J’avais perdu 2 mois. Je décidai de vérifier à quoi pouvait correspondre l’ensemble des cotes que l’on m’avait communiquées. J’en éliminai très vite 6 (clauses techniques, marchés, commandes, armements des Alouette, etc.) et les remplaçai par 9 autres (dont 4 de la sous-série T que l’on m’avait conseillée). Le militaire vérifia ma demande. Je compris à son air qu’il avait vu le « sujet » de l’enquête mais il ne fit aucune remarque. Après tout je cherchais à trouver une explication au phénomène. Il finit par m’indiquer le secrétariat où je pouvais déposer le document. J’en profitai pour faire une demande complémentaire et ajouter 2 nouvelles cotes. J’avais aussi découvert que les archives sur les « journaux de marche des unités » s’arrêtaient en 1964. Le responsable m’informa qu’elles n’étaient peut-être pas encore classées ou alors qu’elles se trouvaient toujours dans les unités(?). Cela n’allait pas me faciliter les choses. Il me faudrait à terme faire une demande de dérogation afin de consulter l’année 1967.
Entre-temps, j’obtins l’accord de l’Armée de Terre pour consulter les premières cotes et un rendez-vous fus pris pour le 3 août 2007. J’arrivai pour l’ouverture à 9 h et me présentai à la salle de lecture pour les trois premières cotes (13T 170, 306 et 28T 5). Après quelques minutes, le militaire me répondit : « non communicable ». Je lui présentai mon autorisation que j’avais heureusement emportée avec moi. Il en prit connaissance et la montra à l’un de ses collègues qui en fit une copie. Quelques minutes plus tard, il me rendit le document, m’informa que l’on allait me les chercher et qu’il me fallait attendre 30mn … au minimum. Je pris donc mon mal en patience. Les autres visiteurs avaient déjà commencé leurs explorations. La salle devait avoir 80 places. Apparemment, on pouvait venir avec un ordinateur portable. J’en profitai pour demander à la présidente de salle si les photocopies étaient autorisées. Elle me répondit affirmativement mais précisa qu’il me faudrait présenter mon autorisation. Je restai perplexe en voyant certaines personnes dans la salle prendre des photos avec des appareils numériques. Avaient-elles une autorisation ? Alors que je prenais quelques notes, une militaire qui passait dans les rangs m’informa qu’il était interdit d’utiliser un stylo bille (?). Un peu surpris, je me rendis à l’accueil pour le déposer provisoirement et, contre une signature sur un cahier, on me remit un crayon à papier. Je fis remarquer que je n’étais pas la seule personne à utiliser un stylo dans la salle. Un peu décontenancé, le militaire fouilla la pièce des yeux - sans résultat - pendant que je retournais à ma place (n°10). A 10h, je pris enfin possession de ma première cote.
Le carton référencé 28T 5 contenait divers documents :
Un registre intitulé EMAT - COMALAT - catalogue des aéronefs en service dans l’aviation légère de l’Armée de Terre et des matériels de servitude importants. Le document était séparé en 6 parties distinctes dont 2 sur les hélicoptères. Seule la section « hélicoptères légers » m’intéressait. Elle portait sur le Bell 47 G2, le Djinn et surtout l’Alouette (SE 3130). Je commençai à prendre des notes : « 2 sièges avant et 3 sièges arrière ; turbo-propulseur Artouste II ; atterrisseurs à patins (version terre) ; pneus roue diamètre 34, écartements patins 2,20m et hauteur 2,75 ; pouvant être transporté sur un camion P45 ou par voie ferrée (en caisse), etc.. ». Prendre des notes allait encore me faire perdre du temps. Je décidai de faire des photocopies. Le prix n’était pas excessif. Une photocopie A4 revenait à 0,25 €, une A3 à 0,50 €. Ce matin-là, l’un des visiteurs semblait avoir monopolisé la photocopieuse. La liasse de documents qu’il avait près de lui effraya toutes les personnes présentes. Fort heureusement, il y avait une seconde photocopieuse et le militaire chargé d’encaisser l’argent ne me demanda pas de justificatif pour effectuer mes copies.
Un catalogue des opérations de révision périodique et de réparation des aéronefs de l’A.L.A.T.
Une notice sur G.M.C. (ravitailleur d’aéronef)
Deux documents sur l’instruction à tenir en cas d’accident ou d’incident aérien. L’un des deux documents avait été rédigé le 27 décembre 1967. Sensiblement identique, je fis des photocopies du plus ancien (voir en annexe 3). Le texte stipulait très clairement que « dans le cas où un accident léger ou un incident a entraîné un atterrissage en rase campagne, le Chef de bord doit envoyer télégraphiquement et sans retard un message d’avis aux fins de dépannage ». Plus loin il était écrit que « tout accident léger ou incident donne lieu à … la rédaction d’une fiche d’accident aérien léger ou d’incident aérien ». Si un incident – même léger – avait eu lieu à Cussac, on pouvait en trouver une trace. On savait déjà qu’il n’y avait pas eu d’envoi de « dépanneurs » car si un militaire s’était rendu à Cussac pour envoyer un télégramme le 29 août, il aurait pu difficilement passer inaperçu.
Les autres documents avaient pour titre : règlement de manœuvre de l’aviation de transport, instruction provisoire relative à la conduite à tenir en cas d’avaries, et pour finir, aptitude des aéronefs militaires à la mise en œuvre et à la maintenance.
Le carton référencé 13T 306 contenait cinq chemises épaisses:
Un dossier A.L.A.T .- 26 Drome 5ème région militaire contenant plusieurs courriers et divers plans. Une lettre datant de 1965 évoquait l’implantation future du GE/A.L.A.T. et rappelait la nécessité d’avoir des communications rapides par avion ou train avec Paris, le C.E.V. Bretigny/ Istres-Toul ainsi qu’avec le constructeur à Marignane et Bordes. Une sous-chemise couvrant la période « 57-67 » traitait succinctement de l’implantation du groupe d’expérimentation A.L.A.T. de l’aérodrome Valence-Chabeuil. Un courrier du 21 janvier 1969 avait été envoyé par le Général de Division D au Ministre des Armées (Direction centrale du Matériel). Extrait : « Lors de l’installation à Valence-Chabeuil au cours de l’été 1967 du groupement ALAT de la STA, il a été jugé expédient d’admettre une cohabitation provisoire dans la hangar K d’éléments de ce groupement et des ateliers du Mam/Alat… dans le même temps, l’arrivée progressive des SA 330 entraîne pour mon groupement la nécessité de disposer des surfaces indispensables d’entretien ». Une autre sous chemise (1969-72) portait sur l’installation d’une soute à ingrédient unique pour les organismes de la base. J’avais aussi trouvé un rapport et des photos prises après l’effondrement d’un hangar suite à des chutes de neige en décembre 1970. Parmi les appareils détériorés on trouvait 2 SA 330, 1 alouette II, 1 Alouette III et 2 Bell. Des sources internet m’apprirent par la suite que STA signifiait Section Technique de l’Armée de Terre. Le groupement aéromobilité de la STA avait quitté Satory en 1967 pour s’implanter sur l’aérodrome de Valence-Chabeuil. Aujourd’hui, ce groupement est impliqué dans de nombreux programmes dont le développement des hélicoptères du futur…
Un dossier A.L.A.T – 38 Isère 5 ème région militaire (1963) traitant de l’implantation du P.M.A.H. de la 27e Brigade Alpine à Grenoble-Eybens puis plus tard sur Grenoble-Montbonnet.
Une chemise couvrant la période 1968-1969 contenant un courrier du 26 novembre 1968 qui précisait que la création de l’aérodrome Lyon-Satolas aurait des incidences sur le 5ème GALAT qui était déjà implanté à St Symphorien-Chaponnay.
Un dossier Aérodrome du Versoud (Grenoble) 5ème région militaire, 38 Isère (1968-69) où il était question de la base A.L.A.T./27 au Versoud (brigade Alpine). Un courrier du 30 mars 1967 précisait que l’aéroport d’Eybens devait être fermé en raison des travaux d’urbanisme à réaliser par la ville de Grenoble avant l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de 1968. Un autre courrier du mois de mai indiquait le transfert prochain du PMAH (Peloton Mixte Avions-Hélicoptères) de Grenoble-Eybens sur Grenoble-le Versoud. Le déplacement devait s’effectuer progressivement, les hélicoptères en dernier. Un courrier du 10 mai 1967 indiquait que le peloton serait équipé entièrement en hélicoptères (6 au total). Il semblait déjà y en avoir 4, avec 4 avions. Les autres documents concernaient l’année 1968. J’eus l’occasion par la suite de recouper ces informations avec un site non officiel de l’A.L.A.T. (http://www.alat.fr) . Il semblait indiqué que la 27e brigade devait au moins avoir deux Alouette III en 1967. Il pouvait s’agir de SA3160 (qui prirent la désignation de SA-316A à compter de 1968).


Une « sphère » … de face uniquement !
Cet appareil pouvait emporter 7 personnes. Malheureusement, deux éléments s’avéraient contradictoires pour mon enquête :
L’Alouette III possédait un train tricycle Messier à roue avant orientable, ce qui allait dans le sens des tenants d’une méprise à Cussac.
L’Alouette III était entièrement carénée, ce qui en faisait difficilement une sphère.
Les premières SA-318 C Alouette II Astazou (poids à vide 1 650 kg) furent quant à elles livrées en janvier 1969 (voir Annexe 6).
Additif de M. C. Schmitt de la Sté Héli-Union pour l’aérodrome du Versoud : « Il y avait peu de mouvements entre les aérodromes. Nous n’avons jamais été basé sur l’aérodrome de Saint Geoirs. Nous utilisions occasionnellement l’ancien aérodrome jusqu’aux Jeux Olympiques et le Versoud pour la maintenance et le carburant. »
Rappel : Grenoble est à plus de 200 Km de Cussac.
Ces informations me permettaient de visualiser sur une carte les différentes implantations des aérodromes et bases A.L.A.T. de la 5ème région militaire. Aucune n’était très proche du Cantal. La base située en Isère avait été très occupée pendant l’été 1967 à déplacer son unité mais tout ceci s’était déroulé à l’intérieur du même département. Les déplacements importants (C.E.V., Marignane, etc.) de la GE/A.L.A.T. implantée dans la Drôme ne nécessitaient pas de traverser le Cantal. Je fis part de mes découvertes au responsable du forum du Musée de l’A.L.A.T. qui me répondit : «… Pour ce qui est de Chabeuil, quand même loin du Cantal, c'est une base pour les essais des futures machines ALAT. On y a donc trouvé à toutes époques plusieurs types d'aéronefs différents, et évidemment des AL II et Bell 47, puisque ces appareils étaient des appareils de liaison. On peut trouver aussi des machines de passage dans le camp de La Courtine, là aussi à toute époque, puisque toutes les formations ALAT y sont passées un jour. »
Le camp militaire de la Courtine était situé dans la Creuse (plateau de Millevache). Il faisait partie des « grands camps ». Pour aller de ces bases à la Courtine il n’était pas nécessaire de passer par le Cantal. Le responsable du forum du Musée de l’A.L.A.T. ajouta : « Le transit des aéronefs en général coupe au plus court. »


Le carton référencé 13T 170 portait sur les casernes de l’Ardèche et du Cantal
Ardèche (4 chemises)
1949 - 1963 : une caserne était implantée à Privas.
1962 - 1964 : un champ de tir à St Andeol de Berg (un camp de manœuvre d’infanterie sur la montagne de Berg)
1963 : terrain de Toulouad
1972 : Meysse. Acquisition de parcelles - extension d’un champ de tir
Cantal
. Domaine militaire d’Aurillac
Une chemise contenant divers documents. Exemples : une note du 7 juin 1961 indiquant qu’Aurillac avait été retenu pour l’implantation d’un centre mobilisateur (CM.92 – Sergent Barra) chargé de la mise sur pied d’un régiment subdivisionnaire, implantation et logement (18 000 m2 au final) ; cession gratuite d’une bande de terrain à la ville en 1968 ; acquisition d’un terrain pour la construction d’une gendarmerie en 1969, etc…
Courrier du 26 août 1966 indiquant la cession au département d’une parcelle du terrain militaire de Laveissère pour l’aménagement d’un téléski (Lioran) + plan. Le terrain devait être occupé par l’action sociale des armées.
Divers documents portant sur les années 1968 à 1971.
Une note émanant de l’Etat-Major de l’Armée de Terre en date du 10 septembre 1971 se révéla très instructive (voir Annexe 5). Elle faisait suite à une demande de la commune de Clavières qui est située dans l’arrondissement de St Flour. Le maire de la commune souhaitant l’aménagement de terrains de manœuvres, il lui était répondu que l’Armée ne possédait pas de domaine militaire dans ce secteur et ne tenait pas à en acquérir. Des raisons financières étaient avancées ainsi que le fait que la région était située trop loin des zones retenues pour les forces de manœuvre. En l’occurrence, les projets actuels (en 1971) dans le Massif Central concernaient uniquement la région du Larzac. La première demande de ce maire remontait à 1969. Cussac étant situé dans l’arrondissement de St Flour, on pouvait en déduire qu’il n’y avait aucune zone de manœuvre dans ce secteur en 1967. Un hélicoptère ne pouvait donc pas participer à des manœuvres dans les environs de Cussac le 29 août 1967.
Ma seconde visite eut lieu le 4 septembre 2007. La veille un officier avait téléphoné à mon domicile pour vérifier (de nouveau) si j’avais bien une autorisation pour consulter la série T. Je m’empressai de le « rassurer » et lui précisai que je ne tenais pas à attendre de nouveau comme la fois précédente pour les recevoir. Apparemment le message fut bien reçu. Il est vrai que j’avais amené deux crayons à papier. J’étais installé à la place n°60. Le premier carton contenait des documents sur le camp de la Courtine mais j’en parlerai un peu plus loin.
Le second carton référence 9 T 64 portait sur la mise en place et la revalorisation du parc des Alouette III (1967 -1971). On y trouvait diverses chemises :
Compte rendu de réunions de la commission locale de modification (1967 - 1968)
La 15e réunion portant sur les SE 3160 avait eu lieu à Marignane le 7 juin 1967
Expérimentation d’amortisseurs (1967-1971)
Expérimentation de l’Alouette III et de ses équipements (1969-1972). On y trouvait un projet (avec photos) consistant en la fabrication de « simulacres » d’Alouette III pour leurrer un observateur aérien.
Expérimentation d’équipements radios (1967 - 1972)
J’avais aussi pu trouver une note datée du 11 avril 1967 stipulant que les tirs de (missiles) SS-11 à partir d’hélicoptères Alouette II ou III devaient être exécutés au camp de Mailly. Ce camp d’une surface de 12 000 ha était situé dans le département de l’Aube donc bien loin de Cussac (voir annexe 13).
Le troisième carton référence 15 T 639 avait pour titre « Description campagnes d’essais et modifications apportées sur les Alouette ». Il contenait lui aussi plusieurs chemises :
Réunions et clauses techniques, marchés, commandes, campagnes d’essais (1957 - 1971)
Elle contenait des brochures dont on retrouve des extraits en annexe 13, avec divers documents pour l’année 1967 : un courrier du 19 septembre mentionnant que pour une campagne d’expérimentation du système R.20 (?) qui devait se dérouler du 14 au 30 octobre, on aurait besoin d’une Alouette II, une commande d’hélicoptère Alouette II Astazou datée du 7 novembre, une fiche technique du 21 novembre sur les observations concernant l’installation radio prévue sur Alouette II Astazou SA 318 C, clauses techniques, etc.
Réunions documents et règlements (1956-1959)
A noter, un manuel d’équipage où l’on aperçoit « carburant TRO - norme Air 3405… »
Commission locale de modifications apportées (1962 à 1968 et 1970 à 1971)
Un courrier du 24/11/67 indiquait qu’une commande de 12 appareils allait avoir lieu. Une liste de modifications était jointe. Parmi celles-ci, on rappelait que le remplacement du plancher en bois du SA 3180 Astazou II A par un plancher en nid d’abeille analogue à celui monté sur l’Alouette III permettait un gain sur la masse de 6kg.
Alouette II, Procès verbaux de réunions de la commission centrale de modifications des matériels aériens de l’Armée de Terre (1971). Le but était de connaître les répercussions sur la masse. Exemples : trousses médicales de secours pour usage aéronautique ou encore « renforcement de la poutre queue par augmentation de l’épaisseur de certains panneaux de revêtement » (pour le SE 3160)…
Une fiche d’examen de marché portant sur l’acquisition de 16 hélicoptères SA 318 C (Alouette II Astazou) semblait indiquer qu’il fallait - au minimum - attendre 16 mois pour recevoir les deux premiers appareils (voir annexe 11). Les délais de livraison semblaient donc assez longs. Les appareils devaient être livrés en état de vol sur l’aérodrome de Marignane (à approximativement 250 Km de St Flour, 275 Km d’Aurillac et 410 Km de Limoges). Les lots de rechange devaient êtres expédiés (emballés) sur un wagon à la Réserve Générale du Matériel A.L.A.T. à Montauban (82). Il n’y avait aucune précision sur les convoyages mais il était peu probable qu’ils se fassent avec 4 ou 5 passagers. Si la base à atteindre était très éloignée, il était préférable d’économiser du carburant. De plus, ces appareils étaient - comme nous l’avons vu précédemment - attendus depuis longtemps. L’Alouette II pouvait satisfaire ces deux exigences. En effet, sa consommation décroît quand sa vitesse augmente et quand le poids diminue.
Christian Malcros, précisait sur son site internet - non officiel - http://www.alat.fr: « 54 exemplaires d’Alouette II Astazou (SA3180 et SA318C) ont été livrés à l’A.L.A.T. La première machine (n°1636) est une Alouette II Artouste transformée en Astazou. Elle est suivie par une première tranche de 10 machines (SA3180). 3 appareils (1946, 1949 et 1952) sont perçus en remplacement de 9 Djinn cédés à Sud Aviation. Cinq appareils sont cédés par l’Armée de l’Air en 1969. Suivent ensuite deux tranches de 12 appareils du marché signé le 6/02/68. Un autre marché, du 15/11/68, concerne 10 appareils (8 + 2). La dernière Alouette Astazou livrée à l’A.L.A.T. est la machine n°2285, perçue le 17/10/72 ». La fiche d’examen de marché que j’avais consultée avait dû se concrétiser par une commande ferme de 10 ou 12 appareils (et non des 16 initialement prévus). On pouvait néanmoins en déduire qu’il devait y avoir (au moins) 14 Alouette II Astazou en activité dans l’Armée de Terre en 1967 .
Parmi les documents, je trouvai aussi un courrier du 22 février 1971 adressé au Directeur de l’Etablissement de Réserve Générale du Matériel de Montauban qui mentionnait l’existence d’un Atelier Industriel de l’Aéronautique (A.I.A.) à Clermont-Ferrand. Une recherche sur internet me permit de découvrir un document de la Cour des comptes qui mentionnait que des ateliers régionaux avait été créés dans les années 30. En 1967, il devait en rester deux :
L’A.I.A. de Bordeaux spécialisé dans les moteurs
L’A.I.A. de Clermont-Ferrand spécialisé dans les cellules, les équipements, ainsi que dans les chantiers d’avions spéciaux.

Dans le cas présent il s’agissait de mettre au standard SA 318 C les hélicoptères SA 3180 dans le but d’uniformiser au maximum le parc hélicoptères Alouette II. Les travaux de « mise à hauteur » seraient effectués par l’A.I.A. de Clermont-Ferrand au cours des visites I.R.A.N. (Inspection et réparation si nécessaire) et, à l’occasion de visites périodiques (ou rattrapages) à l’établissement de Réserve Générale du Matériel de Montauban.
Je réussis à retrouver un « ancien », M. Josef Vebr, qui m’apporta son témoignage : « Monsieur, j'ai reçu votre courrier par mes collègues de l'AIA de Clermont Ferrand. Je peux vous apporter les élément d'information suivants: - l'activité de maintenance Alouette II à l'AIA de CF a commencé en 1962 (après fermeture de l'AIA d'Alger). Les travaux de maintenance profonde ont été réalisés sur cet hélicoptère jusqu'en 2000 (plus de 1000 machines traitées). D’après mes souvenirs et ceux d'un ancien mécanicien de piste, les vols d'essai qui étaient réalisés en fin de travaux pour qualifier ces aéronefs se déroulaient sur le département du Puy de Dôme. Plus précisément dans un secteur Aulnat - Cournon - Billom dans les alentours des grand et petit Turluron (collines qui voisinent Billom). Il n'y avait pas nécessité à réaliser ces vols d'essai "mécanique" et de "navigation" plus loin, pas même dans le ciel du Cantal. Un mécanicien d'essai m'a donné les informations suivantes : 1 vol d'essai enregistré sur son carnet le 29 août 1967 sur Alouette II 1668 après travaux de visite "IRAN" pour test de puissance "P/sigma" durée : 1 heure, 3 atterrissages. Pilote : M. G.R (détaché CEV). Compte tenu de la nature du vol et de sa durée, on peut penser qu'il s'est déroulé dans la zone locale habituelle ». Je pris contact avec le mécanicien qui me précisa : « A la vue de mon carnet de vol il n'y avait pas de passager. Vol d'essai classique. Un seul vol effectué le 29/08/ 1967. »
La troisième visite aux archives eut lieu le 26 septembre 2007. Le premier carton référencé 28 T 11 portait sur les décisions de clôture d’enquêtes suite à accidents et incidents aériens (COMALAT – 8/1/64 au 11/12/68). Il y avait plus d’une centaine de décisions pour chaque année mais rien à la journée du 29 août 1967. Je fis une photocopie - à titre d’exemple – de la décision prise suite à accident qui avait eu lieu au mois de septembre 1967. Le document est visible en annexe 4. Le carton suivant (référencé 28 T1) était intitulé « Organisation générale, implantation, équipements et formations de l’A.L.A.T. (1963-1972) ». J’y trouvai 5 (grosses) chemises dans lesquelles je fis quelques photocopies. Notamment la situation des aéronefs de l’A.L.A.T. au 1er décembre 1967.
Dans la région proche de Cussac : 8ème G.A.L.A.T => Alouette II : 2 Alouette III : 0
P.M.A.H. 27ème B.A. => Alouette II : 2 Alouette III : 2
Autres possibilités ? 9ème G.A.L.A.T. (Aix les Milles) => Alouette II : 2 Alouette III : 0
EA.ALAT (Cannet-des-Maures) => Alouette II : 12 Alouette III : 3
Le dernier carton (référencé 28T 8) était constitué de rapports d’études du groupe A.L.A.T. (E.M.A.T – COMALAT). Il semblait se dérouler au Luc (ou Buc ? papier peu lisible) et à Satory. Il couvrait malheureusement la période de 1963 à 1964. J’aurais dû demander le carton suivant (28T 9). Je pus néanmoins consulter des documents très intéressants comme celui portant sur l’utilisation de la télévision pour l’atterrissage de nuit des hélicoptères (en 1964). Un autre portait sur un transpondeur (modèle ATC Wilcox) monté sur Alouette III. Les essais avaient permis de vérifier qu’il était possible d’identifier un aéronef à basse altitude (40 m) jusqu’à 25 km en terrain dégagé, alors que le radar primaire « ne voyait pas » cet aéronef, ceci dans des conditions expérimentales défavorables. Un contrôleur aurait-il pu voir disparaître des écrans radar un hélicoptère en difficulté à Cussac ?
J’eus confirmation dès le mois suivant que le carton référencé 28 T 12 ne portait que sur les accidents et incidents aériens compris entre le 9 mai et le 11 décembre 1968. Le carton suivant (28T 9)
couvrait cette fois-ci la période 1965 à 1971. Je remarquai, parmi une multitude de dossiers, une évaluation (1970 ?) assez intéressante sur l’éclairage du sol à partir d’un SA 330. Le phare pouvait se voir à 30 Km. Un autre document portait sur une simulation d’attaque chimique par épandage aérien (avion ?). Elle s’était déroulée de janvier à mars 1967 entre le C.E.V. de Brétigny et le terrain de Mourmelon. La troisième cote (13T 252) portait sur le luc, l’école d’application de l’aviation légère de l’armée de terre et l’aérodrome du Cannet des Maures. J’y trouvai des échanges remontant à 1967 et divers travaux semblant menacés par un projet d’implantation de l’accélérateur de particules du C.E.R.N. Un courrier de Georges Pompidou en date du 6 mars 1964 précisait déjà à ce sujet qu’il fallait suspendre tous travaux sur cet aérodrome. Un courrier du 5 mai 1969 rappelait que l’école avait pour but de former au vol tactique (ex : rasant) sur champ de bataille les pilotes d’hélicoptères et
avions légers. La dotation cette année-là était de 12 Alouette II, 3 Alouette III et 5 M.19. D’autres documents portaient sur divers domaines militaires (Puget s/Argens dans le Var, la citadelle de St Tropez, etc…). L’ensemble était assez intéressant mais peu en rapport avec l’affaire de Cussac. Je terminai la journée en aidant un autre ufologue, R. Robé, à obtenir une carte d’accès aux archives pour ses propres recherches.
. Après 1964 ?
Les archives de Vincennes ne pouvant me communiquer beaucoup d’informations au delà de 1964, je décidai d’écrire aux bases A.L.A.T. encore en activité. Une réponse me parvint du GAMSTAT de Chabeuil le 13 septembre 2007. Le lieutenant-colonel Sirodot m’informait que le groupe d’expérimentation n’avait rejoint Valence que le 1er septembre 1967. Il me signalait aussi que le camp de la Courtine était régulièrement fréquenté par des hélicoptères. Il ajoutait qu’il ne connaissait pas les consignes que devaient appliquer les équipages à cette époque lors d’un atterrissage forcé en campagne. Heureusement, j’avais trouvé entre temps des informations à ce sujet (voir notamment en annexe 3). Le 12 octobre 2007, j’obtenais enfin une dérogation pour consulter les J.M.O. (Journal des marches et opérations) de l’année 1967.
. Le camp de la Courtine
Le camp s’étendait sur le territoire d’une dizaine de communes dont la plus importante était la Courtine. Il avait une surface de 6 200 ha. Il était à un peu moins de 100 km de Cussac. Ma première recherche aux archives concernant ce camp remontait au 4 septembre 2007. Le carton (référencé 11T213) que j’avais consulté alors portait principalement sur les manœuvres aéroportées et exercices de cadres par la 11ième division aéroportée. J’avais choisi cette cote car bien que cantonné à Pau (caserne Bernadotte), cette division semblait souvent faire des manœuvres à la Courtine et les archives couvraient la période 1963 à 1967.
Le carton contenait plusieurs chemises :
Région de la Courtine – manœuvres de groupement « Condor ». Expérimentation des structures nouvelles des unités aéroportées. On pouvait traduire cela par « adaptation aux conditions d’une guerre nucléaire en 1967 ». Le document était oblitéré par un « diffusion restreinte ». Période 8-10/3/64 et 25-27/3/64
11ème DLI, manœuvre aéroportée « Milan » 4ème RM (Région Militaire) - Septembre 1964
11ème division manœuvre aéroportée de la 25ème brigade au camp de la Courtine 22/2 – 16/3/65
11ème division de parachutistes et diverses manœuvres aéroportées (notes de la Caserne Bernadotte – Pau, etc..)
a) « Typhon » - 20ème brigade => 19 au 23/3/67 (à la Courtine)
b) « Harmonie »- 9ème brigade 11ème division => 7 au 9/5/67 (à la Courtine)
c) « Epervier » - 1ère brigade parachutiste => 12 au 18/5/72 (?), oblitération « confidentiel défense ».
13ème Régiment de Dragons parachutistes «manœuvres Eugénie » de 1964 à 1967. Pour l’année 1967, du 4 au 13 avril : « Eugénie VIII » (inscription « 3ème bureau » sur la chemise). La manœuvre avait eu lieu en Alsace.
Exercice « Rapace » le 16/12/63 (inscription 3ème bureau sur la chemise)
11ème division (Pau), exercice cadres « Midi Pyrénées » le 10 mai 1966
11ème division (Pau), conduite de l’exercice cadres « Ares » du 21 au 23/2/1967
Ma seconde visite eut lieu le 31 octobre. Je comptais cette fois-ci sur le J.M.O. pour obtenir le maximum d’informations. J’avoue avoir été très déçu. La 35e Cie de la Courtine dépendait de la 43e division militaire (Limoges-Haute Vienne). Le carton contenait plusieurs J.M.O. du 1er janvier 1965 au 30 juin 1979. Je mis moins d’une minute pour consulter les informations concernant l’année 1967. Elles se résumaient à « Néant ». En comparant avec d’autres années, je pus tout juste déduire qu’il n’y avait eu aucune visite officielle (exemple : intendant militaire, etc.). J’avais heureusement réservé deux autres cotes (13T 259 et 13T 275) qui allaient sauver la journée. Concernant l’aérodrome le plus proche du camp, Ussel-Thalamy (Corrèze), je pus trouver plusieurs courriers qui apportèrent quelques éléments de réponse sur son utilisation militaire (extraits) :
« Les appareils militaires n’utilisent cet aérodrome qu’en période de manœuvres… » (Général de Brigade le M, Commandant l’A.L.A.T. – Le 1er août 1960) « Pour l’Armée de Terre, les unités ont reçu l’ordre d’utiliser la plate-forme des Fargettes, située à l’intérieur du camp de la Courtine. Seuls subsistent sur Ussel-Thalamy (Corrèze) des vols de liaison en avion du type MH 1521 Broussard, à une fréquence qui n’excède pas un atterrissage par mois… l’Armée de l’Air borne son utilisation à des vols d’hélicoptères (voir chapitre suivant), pour la satisfaction des besoins de support et de liaison de l’Armée de Terre ... » (La division logistique – le 3 Mars 1965)
Les Fagettes étaient situées dans le champ de tir au Puy-des-Fagettes. Une notice plus récente (date indéterminée) m’apprit que l’aviation disposa plus tard d’un autre terrain : Feniers-Clairavaux. Il était situé à 1 500m à l’est du village des Feniers. Ces deux terrains furent fermés pendant plusieurs années à la circulation aérienne publique par arrêté ministériel (travaux publics) du 6 février 1947. Je mis finalement la main sur deux notes (voir l’une d’elles ci-contre) de l’Etat-Major de l’Armée de Terre qui me révélèrent que le camp ne devait pas être occupé au mois d’août 1967. Un autre document plus ancien (1969) intitulé « projet d’exposé sur le problème des grands camps » m’apprit que l’on espérait que des améliorations budgétaires permettraient peut-être un jour d’utiliser davantage le camp de la Courtine. Ce dernier était très clairement sous-exploité. Il avait été retenu de transférer progressivement les Ecoles et Centres d’Instructions dans le Sud de la France. L’Ecole d’Application de l’Infanterie était déjà implantée à Montpellier. L’avenir (à l’époque), c’était le camp des Garrigues ou le Larzac. Il était donc inutile de faire des expérimentations (ou manœuvres) d’Alouette à la Courtine. Un tableau de servitudes indiquait d’ailleurs que le camp ne réservait que 15 jours par an pour des « expérimentations diverses ». Les tirs air-sol étaient réservés au camp de Sissonne (1 semaine par mois) et au camp de Suippes (40 semaines par an). D’autres expérimentations étaient réservées à Nord-Aviation ( ?) à Mailly (20 jours par an). Tout ceci, bien loin de Cussac. En résumé, un hélicoptère militaire pouvait (peut-être) se ravitailler près (ou à ) la Courtine mais aucune manœuvre (ou visite) n’y ayant étant signalée, il semble qu’il faille écarter cette piste. Quelques années plus tard, le C.N.E.S. organisa à la Courtine des campagnes de lancements de fusées expérimentales pour les néophytes.
. Le J.M.O. du 8ème G.A.L.A.T. (consulté le 7 novembre 2007)
A la journée du 29 août 1967 : « Une AL.II, Mdl/ chef P au profit du Commandement du Génie. Région Vallée de la Maurienne. 3h 25. Un L 19, Capitaine S, Adjt. S au profit du C.E.C. de Modane. Région Modane. 4h00. Arrivée sur la base venant du C.I.S.A.L.A.T. de Nancy du contingent 1967 2/A. ». Rien à signaler du côté de Cussac…
. J.M.O. du 9ème groupe de l’A.L.A.T.
Créé le 1er janvier 1964, il était stationné à Aix-les-Milles. Passé en 7ème région militaire le 1er janvier 1967, il deviendra le 7ème G.A.L.A.T. le 1er juillet 1968. Je ne trouvai rien de particulier entre le 21 août et le 1er septembre 1967. Aucune visite ou inspection.
. J.M.O. de la 27ème brigade Alpine
L’unité semblait avoir eu un planning très chargé. Du 21 au 26 août manœuvres d’été dans le Pelvoux puis dans le Drac. Le 22, visite du colonel divisionnaire Suisse Roch de Diesbach accompagné de l’attaché militaire à l’Ambassade de France à Berne. Du 22 au 24 août, visite de M. Tidemand, Ministre Norvégien de la Défense accompagné du colonel K et du colonel H. Le colonel divisionnaire assista aux manœuvres Gentiane VIII (à St Sébastien - Isère) et à la prise d’armes de clôture à Pierre Chatel (Isère) le 26. Le 28, prise d’armes pour les adieux du général
D qui quitte la 5ème région militaire pour prendre le commandement de l’A.L.A.T. Le 29, il semble que la 27ème brigade profite d’un repos bien mérité. Le colonel L part d’ailleurs en permission et laisse le commandement de la brigade au colonel M. On peut penser que les hélicoptères n’ont pas manqué de servir entre le 21 et le 28 août pour assurer la visite de ces différentes personnalités mais le 29, le calme semble revenu. Aucune mission prévue dans le Cantal…
. J.M.O. de l’Ecole d’Application du Train de Tours
Située dans la direction de disparition de la « machine », cette école (EALAT EAT) aurait pu être la destination finale d’une Alouette. Je n’y trouvai, après contrôle, aucune visite, stage ou affectation de personnel à la date du 29 août 1967. On peut penser que l’école était en train de faire les ultimes répétitions pour la cérémonie du 23ème anniversaire de la libération de la ville de Tours à laquelle elle devait participer le 1er septembre.
. J.M.O. de l’Ecole d’Application de l’ABC (Arme Blindée & de la Cavalerie) de Saumur
Comme précédemment, la direction de disparition pouvait expliquer qu’un hélicoptère se pose à cette école (EALAT. EAABC). Là encore, après avoir consulté divers documents (et notamment le « relevé des mutations ») je ne pus trouver ni visites, ni stages ni affectations au 29 août 1967.
. J.M.O. de l’Ecole d’Application de l’A.L.A.T. du Cannet-des-Maures (Var)
Je me trouvais cette fois-ci dans la situation inverse. Un hélicoptère aurait pu décoller de cette base et traverser le Cantal. Le 4 août, une Alouette II est mise à disposition du Général Commandant de la 71ème division militaire pour inspecter les garnisons de Barcelonnette et Gap. Le 22, c’est une Alouette III qui est mise à disposition du Général de Corps d’Armée M, commandant la 7ème région militaire afin qu’il se rende en liaison à Gap (carton référencé 13T 220). Retour de mission le jour même. Le 29, visite de courtoisie du lieutenant-colonel P qui vient prendre le commandement du 19ème régiment d’artillerie de Draguignan. A noter aussi l’arrivée des personnels appelés, en provenance du C.I.S.A.L.A.T. de Nancy, affectés à compter du 1er septembre. Au total 25 hommes du rang. Le 31, au cours d’une séance d’instruction VSV ( ?), l’hélicoptère H19 n°865.FM.AXI perd une ailette du ventilateur d’embrayage qui est projetée contre le carter moteur. L’appareil piloté par l’adjudant F, moniteur, se pose en autorotation dans un champ. Aucun blessé. On notera une nouvelle fois la précision des informations. La moindre panne y est signalée. Pour anecdote, on m’avait mis de côté ce carton d’archives avec l’intitulé Cannet des « morts » et mon voisin de table jouait aux cartes sur son portable. Une journée « étrange » à Vincennes.
. J.M.O. de l’Etablissement de réserve générale du matériel de Montauban
Nous avions déjà parlé brièvement (voir « avis de pilotes.. ») du convoyage des hélicoptères au départ de Marignane. J’eus l’occasion d’approfondir cette hypothèse en consultant les archives de Vincennes. Aucune visite ou inspection, aucun cours ou stage d’instruction dans la période qui nous intéresse. Je ne pus trouver que l’indication d’une mise en peinture de 4 salles dans la section Aéro et divers comptes-rendus sur le moral et les activités de relations publiques (dont coupures de journaux). Aucun document parlant des convoyages. Le document n’était peut-être pas accessible ou figurait sous une cote inconnue. Les archives de l’armée étant gigantesques, il faut s’attendre à ce genre de désagrément. Pour anecdote, l’un de mes voisins de table trouva - à sa grande surprise - dans une boite d’archives (fond privé) sur la 2nde Guerre Mondiale un lot de boîtes de maquereaux ( ?). Je précise qu’elles étaient vides…
Cette visite qui s’était déroulée pendant la période des grèves des transports n’avait pas été très productive. M. S, ancien pilote A.L.A.T. et contrôleur technique du Matériel, put fort heureusement me communiquer des informations intéressantes : « Pour la perception des Alouette, une antenne ALAT à Marignane percevait les appareils pour le compte de la Direction Centrale du Matériel de l'Armée de Terre, gestionnaire. Ceux-ci étaient convoyés à Montauban par les pilotes de la section de convoyage de l'établissement de réserve général du matériel ALAT de Montauban. Lors de leurs affectations par l'Etat Major de l'Armée de Terre (E.M.AT.), la section de convoyage convoyait les appareils par voie aérienne vers les bases affectataires. Les hélicoptères étant limités en masse, le carburant emporté est tributaire de la charge transportée, ce qui affecte l'autonomie. Une Alouette peut prendre au maximum 550 litres de kérosène ce qui l'amène à une distance d'environ 450 km, mais souvent ces convoyages étaient mis à profit pour transporter des pièces urgentes et leur autonomie était plutôt de 300 km ou moins. Les pilotes devaient prévoir leur itinéraire en fonction des ravitaillements de kérosène sur des bases ALAT ou Air ou des aérodromes distributeurs de ce carburant. Par ailleurs ces appareils étaient dépourvus d'instrumentation pour vol aux instruments et d'aide de radionavigation, les pilotes étaient souvent confrontés à des conditions de mauvaise visibilité qui les contraignaient à voler bas, ralentir, ou se dérouter ce qui réduisait leur autonomie, voire à se poser en campagne lorsqu'ils n'avaient plus les minimas, le plus grand risque étant de se perdre ou pire de percuter. Vous citez le Cantal, c'est le genre de coin qui a dû faire transpirer plus d'un par mauvais temps. En principe, il était rare d'avoir 4 personnes à bord, en liaison pour une raison de faible autonomie et aussi en manœuvre pour les limitations d'évolution, l'appareil étant lourd et centré avant dans cette configuration … Je croyais au départ situer l'événement en 1960, mais en 1967, nous avions des Alouette plus performantes avec une turbine Astazou qui ne consommait que 150 l/h au lieu des 180l/h de l'Artouste et qui permettait une vitesse de croisière de 180km/h au lieu de 150km/h avec une charge marchande augmentée de 50kg, la conséquence est que l'autonomie était considérablement augmentée … les pilotes de la section de convoyage de Montauban rayonnaient dans toutes les directions, mais en général, seuls à bord…Les convoyages d'appareils neufs ou sortant de révision générale de Marignane étaient rarement convoyés directement de Marignane vers les unités. La règle était de les convoyer sur Montauban qui vérifiait la conformité de l'appareil et de la documentation technique. Ils étaient ensuite convoyés de Montauban vers les unités. » M. Subra est aussi le « webmaster » du site UNA-ALAT (Union Nationale des Anciens de l’A.L.A.T.).
. Les carnets de bord
Je pensais au début de mes recherches que les carnets de bord étaient peut-être conservés par l’Armée mais M. J qui tient le forum A.L.A.T. me déclara : « Tous les personnels ayant volé gardent leurs carnets de vol ( il peut y en avoir plusieurs, j'en ai moi même 3, mais trop récents (1976-1991) même après leur départ de l'Armée, ne serait-ce que pour se rappeler le "bon vieux temps". Un recensement du contenu de tous les carnets de vol dans le but de suivre la vie des machines dans l'Alat, a été mis en oeuvre. Le problème 1er est le manque d'enthousiasme de beaucoup d' Anciens ». Je l’ai effectivement remarqué vu le peu de réponses à mon sondage sur son site.
. Le site internet de l’ALAT (extraits)
« 1960 : L'ALAT aligne 687 avions et 394 hélicoptères, servis par 442 officiers et 1850 sous officiers. En Algérie, le GH2 est la seule unité d'hélicoptères de manœuvre de l'Armée de Terre opérationnelle. Il s'y ajoute 17 pelotons avions et 15 pelotons mixtes avions hélicos légers. Toutes ces unités dépendent d'un point de vue technique des Groupements ALAT (ex GAOA) des Corps d'Armée. En métropole, 3 groupements ALAT assurent le commandement technique des Groupes Alat: Versailles, (GALAT de Nancy, Satory et Dinan), Toulouse (GALAT de Tarbes et Valence) et Baden-Oos (GALAT de Baden).Les écoles de l'Armée de Terre de Saumur, Montpellier et St Maixent accueillent des pelotons mixtes avions hélicos. Le Commandement de l'ALAT est fixé à Issy les Moulineaux. L'Ecole de Spécialisation de l'ALAT, située à Dax, est chargée de la formation initiale des pilotes et observateurs. L'Ecole d'Application (EA.ALAT) implantée à Sidi Bel Abbès, forme les pilotes au combat et les transforme sur hélicoptère moyen.
1961 : Création du 3ème Groupe d'Aviation Légère Divisionnaire (GALDIV) à Baden. Un deuxième sera créé à la fin de la même année à Trèves (GALDIV 1). En septembre, la première unité ALAT d'Algérie rentre en métropole. C'est le PMAH 25ème DP qui devient PMAH 11 DLI (plus tard GALDIV 11).
1962 : Au mois de mars, une décision ministérielle rend l’ALAT responsable du matériel qu’elle utilise et de la formation de ses pilotes. Les unités rentrant d'Algérie renforcent les GALAT; d'autres constituent les noyaux des nouveaux GALDIV (GALDIV 7 à Mulhouse, GALDIV 8 à Compiègne). Ces groupes comprenant 20 avions et 20 hélicoptères sont divisés en peloton d’observation, de reco (reconnaissance ?) et de manœuvre. Une escadrille Reco, une escadrille Anti chars et une escadrille de Manœuvre, soient quarante appareils. La suppression progressive des avions impose une nouvelle organisation : deux EHL soit 20 Alouette II, une EHA à 10 Alouette III et une EHM à 10 Pumas. Une escadrille de Soutien et de Ravitaillement et une escadrille de Commandement et de Service complètent le dispositif. Les Groupes d’Aviation de Région (GALREG) constitués de deux escadrilles avions et hélicoptères assurent les missions d’aide au commandement au niveau de la Région Militaire. Les écoles d’Arme (Artillerie, Infanterie, Train et Blindés) accueillent une escadrille pour la formation aéronautique des cadres de ces Armes.
Les sept ans de la guerre d'Algérie ont permis de définir les concepts qui font l'ALAT d'aujourd'hui. Les opérations aéromobiles, associant les hélicoptères transportant des fantassins, les hélicoptères de reconnaissance, les hélicoptères armés chargés de leur protection, les hélicoptères sanitaires, les hélicoptères de commandement, avaient fini par démontrer toute leur efficacité. La preuve était faite que l'Armée de Terre pouvait déployer des aéronefs sans l'intervention de l'Armée de l'Air. Après la guerre d'Algérie, la Marine recentrera les missions de ses hélicos sur la Search and Rescue et la lutte Anti sous-marine et l'Armée de l'Air sur le secours et la reconnaissance (elle employa toutefois des Pumas "Pirate" au Tchad). L’EA. ALAT quitte Sidi Bel Abbès et se replie sur le Cannet-des-Maures (base du Luc) le 19 mars 1963.
J’ai pu contacter M. B, membre de l’Association de amis du musée de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT) et de l’Hélicoptère (précision : M. B a appartenu à l’ALAT pendant une période postérieure à 1967) :
Question : « La réglementation a-t-elle beaucoup changé depuis 1967 ? »
Réponse : « Oui. En 1967, il y a peu d’utilisation de l’hélicoptère malgré de nombreuses tentatives d’exploitation commerciale menées par quelques pionniers (souvent d’anciens militaires). L’emploi de l’hélicoptère à des fins autres que militaires n’a véritablement commencé à se généraliser sur le territoire national qu’au début des années 1970. Pour ce qui concerne la réglementation des appareils d’état, il existait alors les règlements opérationnels militaires qui s’étaient pendant longtemps directement inspirés des textes en vigueur pour les avions ainsi que de l’expérience des différents théâtres d’opération de l’après-guerre. »
Question : « Les vols à 4 personnes étaient-ils rares ou fréquents et dans quel but (quelle missions, quelle tenue ?) »
Réponse : « Pour ce qui concerne les vols militaires, ces vols étaient fréquents et en général en tenue militaire adaptée à la mission pour les personnels militaires. Je ne connais malheureusement rien des vols effectués par des opérateurs civils. »
Question : « Un hélicoptère pouvait-il faire escale en cours de route (si risque d’être à cours de carburant) sur un aérodrome non militaire ? »
Réponse : « Oui »
Question : « Quelles étaient les consignes pour des atterrissages en pleine campagne sur des terrains civils non équipés (fallait-il informer le maire auparavant ; en cas de force majeure, y avait-il des consignes pour en informer à posteriori les autorités civiles ?…) »
Réponse : « Non. Le commandant de bord devait (et doit toujours) informer la Gendarmerie la plus proche du point de poser.»
=> Cette affirmation est confirmée par un événement survenu le 6 septembre 1967 dans le Cantal. Je l’ai trouvé dans La Voix du Cantal du 9 septembre alors que je voulais vérifier un article mentionné par Eric Maillot dans Les Mystères de l’Est n°2 (page 7/24). Il indiquait très succinctement que des employés à la surveillance des lignes électriques d’E.D.F. auraient pu être actifs à cette époque dans le Cantal. L’article qui portait sur le canton de Laroquebrou était plus intéressant. L’article (en page 2) racontait que mercredi (6 septembre) vers 9h30, par temps brumeux, un bruit inaccoutumé mit en alerte les gens du bourg. On crut au passage de l’hélicoptère assurant la surveillance de la ligne à haute tension en direction de Laval-de-Cère II (d’où la remarque d’E.Maillot). Il s’agissait en fait d’un appareil militaire puissant de couleur kaki, dit « banane » H 21 E. M.A.E.Q. – F.R.83. 40° Galat de la base de Tarbes. L’unité dépendait de la 4ème région militaire. Durant la période du 1/7 au 31/12/67, la formation effectua 1 074 missions en hélicoptères et 457 missions en avions. Un total de 1 690 heures de vol. L’aviation légère de l’Armée de Terre avait acquis 98 hélicoptères de type Vertol-Sikorsky H-21 Flying banana auprès du constructeur américain dans la seconde moitié des années 50.

L’appareil se dirigeait vers Nancy pour des expériences de parachutage. Il s’était posé dans le « champ GRAND » en bordure de la Nationale 653. L’équipage était composé de 3 adjudants (2 pilotes et un mécanicien). Le propriétaire du terrain les accompagna à la poste pour téléphoner à la brigade de gendarmerie de Laroquebrou (près du barrage de St Etienne-Cantalès). Le ravitaillement en essence était prévu à Aulnat (Clermont-Ferrand), mais ils décidèrent de se rendre plutôt au terrain d’aviation d’Aurillac situé à une vingtaine de kilomètres de là. Cela explique peut-être pourquoi ils semblent avoir dévié de leur route, à moins que cela ne soit dû au temps brumeux qui les aurait égarés. Ils repartirent vers 12h15 après avoir rassemblé toute la population enfantine. La forme de l’appareil ne ressemblait pas à celle observée à Cussac mais l’article complet méritait d’être connu. Pourquoi Eric Maillot ne l’a-t-il pas cité entièrement ? Est-ce parce que l’article nous apprend que 3 hommes suffisent pour un trajet militaire de longue distance, même pour un hélicoptère beaucoup plus grand qu’une Alouette ? Est-ce parce que le pilote a immédiatement cherché à prévenir les autorités (comme le dira aussi plus tard C. Poher) comme l’aurait fait un pilote d’hélicoptère à Cussac ? Est-ce parce que les DH auraient pu avoir lu cet article, d’autant plus qu’il parlait d’enfants, et comprendre leur méprise (ce qu’ils ne firent pas) ? Un journal qui ne manquait pas de montrer des photos d’appareils volants comme le « Jaguar » (page 4 du 20 mai 1967) ou le « Concorde » (le 2 septembre 1967) ? Le même incident pouvait-il se produire deux fois sur une aussi courte période dans la même région ?
Question : « J'aimerais savoir si un exercice d'atterrissage en campagne ou d'autorotation doit être effectué régulièrement par tout pilote d'hélico et obligatoirement par tout élève pilote en formation? Ces manœuvres doivent-elles être obligatoirement faites en campagne ?
Réponse : Concernant
l'exercice d'autorotation, il est bien effectué de manière
régulière par les pilotes car il fait partie des
procédures d'urgence. Chaque pilote en unité doit
réaliser l'exercice sous la conduite d'un instructeur lors
d'un contrôle annuel mais il
n'y a pas de réduction du régime moteur de la
turbine au ralenti.
On dit alors que cet exercice s'effectue avec"reprise
moteur". Il s'effectue en principe jusqu'au "flare"
(remarque :
un changement brusque d'assiette vers l'arrière dans le
but
de "casser la vitesse" de translation pour
effectuer, ensuite, un poser vertical.),
ce qui permet de constater que l'appareil aurait pu (ou non) se
poser en sécurité. Concernant les instructeurs en
école, cet exercice est régulièrement
exécuté car il fait partie de la formation des
élèves-pilotes. Il est réalisé sur un
terrain en herbe, homologué pour ce type d'exercice.
Les instructeurs en unité ont un stage de recyclage annuel
dans les écoles de l'ALAT.
=> Je ne pense pas que le pré où a eu lieu l’observation ait été homologué pour être utilisé par un instructeur, et cela d’autant plus que les enfants auraient souvent (ou au moins une fois) eu l’occasion de voir, ou entendu dire, qu’un hélicoptère venait fréquemment y faire ce type d’exercice. Cette réponse réfute aussi l’hypothèse de Didier Gomez (de UFOmania magazine) avançant que des pilotes de l’armée camerounaise se trouvaient peut-être en formation dans le Cantal. J’appris par la suite que la formation s’était faite en partie au DERH de l’Aérospatiale (Marignane) puis au CIEH 141 à Toulouse (donc pas dans le Cantal) en 1968. L’information a été transmise aussitôt à Didier Gomez. De même, il est bon de rappeler que même s’il y a eu auto-rotation, lors de son arrivée sur place, l’hélicoptère n’est pas silencieux (et surtout pas lors de son approche…).
Question : « La queue tubulaire est-elle toujours peu visible? Je veux dire, existe-t-il des modèles où il n'y a pas cette sorte de "grille" de support ? Il me semble que dans la marine c'est couvert entièrement (sorte de cône derrière la cabine, désolé je ne connais pas le terme précis) ?
Réponse : Pour ce qui est de la "poutre de queue", l'Alouette II est en tubes et l'Alouette III comme un fuselage d'avion »
=> Si la « bulle » est visible des enfants, l’hélicoptère (présumé) est donc de face ou légèrement de côté. Il disparaît au décollage dans le sens opposé, l’appareil a donc dû tourner, il a forcément montré sa queue tubulaire. Or, les enfants n’en parlent à aucun moment. L’hypothèse Alouette III me semble donc à écarter. On pourrait penser que si la queue de l’appareil est faite simplement de tubes, elle est plus difficilement perceptible à distance. Il y a néanmoins une contradiction que signale d’ailleurs Alain Delmon : « … les montants verticaux soutenant les patins d’atterrissage d’un hélicoptère sont à peu près de même diamètre, mais bien plus courts, que toute la superstructure arrière. Pourquoi donc eux, et eux seuls, ont-ils été vus par la fille ? » (Notamment lorsque l’appareil est en vol…).
J’ai pu recueillir des informations sur les marquages des appareils de l’A.L.A.T. sur le site non officiel de Christian Malcros (http://www.alat.fr): « Le 6 avril 1965, une fiche du Service du Matériel précise le marquage et la peinture des appareils de l'ALAT. Tous les aéronefs ont pour teinte de fond, sur les extérieurs des cellules, le vert armée P.50 teinte 2420 à haute réflexion infra-rouge (voir aussi en annexe 11 - cela me semblait assez curieux* d’autant plus que, bien des années plus tard, fut recommandée l’utilisation d’une peinture à faible émissivité infrarouge pour l’hélicoptère Tigre). Seuls les avions école N3202 restent peints en jaune. Les marques de nationalité sont uniquement constituées par des cocardes bleu, blanc, rouge entourées d'une bande jaune. Seuls, les SO1221 conservent les bandes verticales tricolores sur les empennages. L'indicatif d'appel comprend un groupe de trois lettres de couleur blanche (noire, pour les N3202), correspondant aux trois dernières lettres de son immatriculation. Exemple: F-MABC . Leur hauteur est de 220 mm, leur empattement de 40 mm, la largeur ne pouvant dépasser 145 mm et l'espace interlettres est de 40 mm. Le numéro de cellule est peint en noir. Toute autre inscription est prohibée (ALAT, grande unité, constructeur, type d'aéronef, insigne, etc). L'intérieur des cellules est peint en P.50 bleu nuit mat. A partir du 1er mai 1981, les aéronefs de l'ALAT et du Service du Matériel portent l'inscription "armée de TERRE" en blanc sur la cellule. Le sigle a une longueur de 1,15 m pour les Alouette II et de 2,30 m pour les autres appareils. Dans le premier cas, les lettres minuscules tiennent dans un quadrilatère de 10 sur 16 cm et les majuscules de 16 sur 18; pour les autres, les lettres minuscules tiennent dans un carré de 14 cm et les majuscules, dans un quadrilatère de 22 sur 15 cm »
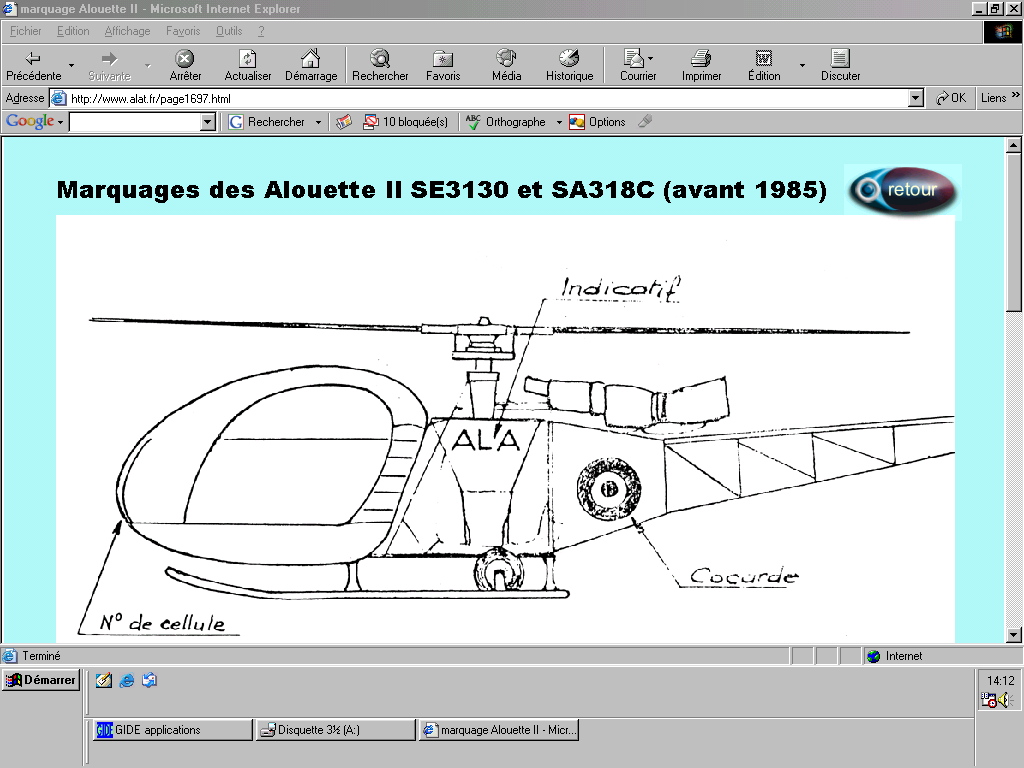

Il est bon de rappeler que les enfants de Cussac ne signalèrent aucun marquage ni aucune couleur verte! Les seuls éléments que l’on pourrait rapprocher sont la mention par Anne-Marie d’une couleur d’« argent bleuté », et l'intérieur des cellules qui était peint apparemment en « P.50 bleu nuit mat »
* A moins que cela ne soit purement pratique à l’origine. En effet, le séchage aux infrarouges permet d’atteindre les couches les plus profondes de la peinture ce qui a pour effet de mieux stabiliser l’application de le teinte sur son support.
J/ L’armée de l’air
CoTAM
Je pus enfin trouver un peu de temps en juin 2007 pour consulter les archives du Département de l’Armée de l’Air (DAA) à Vincennes. L’accès aux informations semblait y être plus facile (et plus rapide) que pour la Gendarmerie et l’Armée de Terre. On pouvait réserver 3 cotes par demi-journée. Il y avait très peu de guides sur les hélicoptères et les informations variaient très facilement dans le temps. Un escadron pouvait très bien exister en juin sous un nom X, être dissous en août et être recréé l’année suivante dans un autre département. Pendant ce temps, un autre escadron reprenait le nom X. Un vrai casse-tête chinois. Je réussis néanmoins en fonction des éléments que j’avais pu obtenir par d’autres sources à établir un tableau pour les hélicoptères du Commandement du Transport Aérien Militaire (CoTAM) entre août 1967 et août 1968 (Commandement de la Force Aérienne de Projection - CFAP - depuis 1994).
|
Escadres |
Escadrons |
Appareils |
Lieux |
|
|
EH 2/67 Valmy |
|
St Dizier (52) |
|
67° EH |
EH 3/67 Parisis |
Divers hélicoptères |
Villacoublay (78) |
|
|
EH 1/68 Pyrénées |
|
Pau (64) |
|
68° EH |
EH 2/68 Maurienne |
Divers hélicoptères |
Chambéry (73) |
|
|
DPH 4/68 |
|
Apt (84) |
|
|
DPH 5/68 |
|
Istres (13) |
On constate que les escadrons sont situés majoritairement près des frontières (maritimes ou terrestres). L’E.H. 3/67 (Villacoublay) était chargé des transports, des héliportages et du soutien logistique des états-majors de la région parisienne. La DPH 4/68 d’Apt n’existait pas encore en août 1967 mais j’ai tenu néanmoins à l’insérer dans l’ensemble au vu de la tâche qu’elle eut à remplir par la suite. La base d’Istres était idéalement placée pour utiliser (ou sécuriser en cas de besoin) les usines de Sud Aviation. Je n’ai pas inclus dans le tableau l’EH 1/67 car il était installé à Bremgarten (RFA).
Aucun de ces escadrons n’était très proche du Cantal. La carte de la page suivante montre l’implantation des bases aériennes en France métropolitaine. J’ai tracé des lignes entre certaines afin de simuler des déplacements qui pourraient éventuellement passer à proximité du Cantal.
Les Bases Aériennes
BA = Base aérienne / BE = Base école
. BA 107 Villacoublay
Le registre journal (CLA) du 29 août indiquait 8 décollages et 8 atterrissages militaires en provenance d’autres bases françaises sans plus de précisions.
. BA 114 Aix-Les-Milles « Général Andries »
L’A.L.A.T. installa aux Milles en octobre 1963 le 9e GALAT (futur 7e GALAT). C’est son grand hangar moderne qui accueillera plus tard les hélicoptères de l’E.H. « Alpilles ». En 1967, il fut décidé de regrouper tous les éléments de la BA 114 aux Milles où de nombreux travaux d’infrastructures sont entrepris dans ce but. Le terrain des Milles servit aussi d’aérodrome de dégagement pour l’Aviation Légère de Marignane dont la plate forme était souvent saturée. Je n’ai malheureusement pas retrouvé de dates précises. Le journal des marches et opérations indique un exercice « SAR becqueril » le 21 août 1967 et la visite du Général B le 6 septembre. Rien le 29 août. En octobre, accueil du détachement d’hélicoptères Istres/ Chamberry (+ Germas) pour l’exercice Fatex. Le registre journal (CLA) du 29 août indiquait 18 décollages (de jour) militaires de la base et 4 d’autres bases. Pour les atterrissages : 17 militaires de la base et 4 d’autres bases. Côté civil (français) : 2 décollages et 2 atterrissages. Pas plus de précisions.
. BA 115 Orange-Caritat (Vaucluse) “Capitaine de Seynes”
La base d’Orange assurait essentiellement le soutien des escadrons de chasse 1/5 « Vendée » et 2/5 « Ile-de-France ». Le registre journal (CLA) du 29 août indiquait 16 décollages militaires de la base et 18 d’autres bases. Pour les atterrissages : 18 militaires de la base et 16 d’autres bases. Pas plus de précisions.
. BA 120 Cazeaux (Gironde) « Commandant Marzac »
Base de chasse à vocation d’instruction, elle était aussi chargée du support d’essais d’armement et d’expérimentation aérienne militaires. L’ E.H. « Pyréenées» y était stationné en permanence, chargé de diverses missions dont le transport et l’instruction des équipages et des sauveteurs-plongeurs (j’en avais trouvé mention pour l’année 1972) formés à Cazeaux. Le COTA du DPH Cazeaux précisait qu’il y avait eu deux décollages le 29 dont une Alouette (n°194) avec 4 hommes à bord. Le décollage avait eu lieu à 15h40 (trop tard) et il avait duré 30 mn. Le registre indiquait « liaison PC Maouas – C106 » (?). Je remarquai un autre vol d’Alouette le 25 août (trop tôt) qui avait duré 2 h30. Rien vers le Cantal…
. BA 128 Metz - 02.067 « Valmy »
Le COTA du détachement de Nancy - pourvu en SE 3130 - indiquait que l’Alouette II n°116 avait décollé le 29 à 10h15 avec 3 hommes à bord. La mission (locale) devait durer 1h . Chargement : 400 litres. Le COTA du détachement de Colmar précisait qu’une Alouette (chargement 500 litres) avait décollé avec 3 hommes à bord pour une mission qui devait durer 3 heures. Il était noté : « A 906/LI/Colmar/Munsingen/Colmar). Deux autres vols d’Alouette avaient eu lieu dans l’après midi mais ils n’avaient pas dépassés 1h30. Les deux localités ne se trouvaient de toute façon pas dans la direction de disparition de la « machine ».
. BA 200 Apt => Rien sur l’année 1967
. BA 265 Rocamadour (Lot)
Je n’ai pas trouvé de cahier de mouvements aux archives de Vincennes. Probablement parce que cette base était chargée du ravitaillement en munitions (ancien dépôt).
. BA 274 Limoges-Romanet « Commandant Leclerc »(Haute Vienne)
La base comprend une unité territoriale et un entrepôt (n°603) dont la mission est de réapprovisionner, gérer et distribuer du matériel technique, principalement aérien. Le journal des marches et opérations indique pour le 26 juillet 1967 une cérémonie de remise de drapeau de la 22e escadre aérienne à la base n°274 à Limoges. Présence du général d’armée aérienne M V. Aucune visite ou cérémonie particulière au mois d’août. Le terrain de Feytiat cessera toute activité 5 ans plus tard en raison de l’existence du nouvel aérodrome moderne de Limoges-Bellegarde. Les activités militaires seront regroupées à Romanet.
. BA 275 Le Blanc (Indre)
Aucun registre journal (CLA) n’a été versé aux archives. La base était chargée de ravitailler les unités de l’Armée de l’Air en matériel de transmission. A partir de 1966, elle fut progressivement transférée sur Romorantin (direction opposée au Cantal) puis dissoute en mai 1969. La Gendarmerie nationale stockera à Le Blanc ses Alouette III peu de temps avant de les remplacer par des EC-145, mais cela, bien après 1967…
. BA 276 St Astier (Dordogne)
Aucun registre journal (CLA) n’avait été versé aux archives car il n’y avait pas de piste. La base qui était installée dans une ancienne carrière (45m sous terre) servait d’entrepôt d’armement pour l’Armée de l’Air. L’insigne de la base représentait un homme préhistorique. « En 1966, la France quittant le système de défense intégré de l’O.T.A.N., l’Armée de l’Air restitua le matériel (principalement américain) et se replia sur la base de Romanet, près de Limoges » (Source internet).
. BA 745 Aulnat « Commandant Fayolle »
Le terrain avait été mis en gardiennage le 31 juillet 1958 suite à la dissolution de la BA 288. La BE 745 avait été recréée le 1er décembre 1960 pour accueillir les T6 de la division des moniteurs de pilotage repliée de Marrakech. Cet appareil de combat (bruyant) était le plus répandu de toute l’histoire de l’aviation (17 000 exemplaires construits). Les premiers exemplaires furent livrés à la France dès 1939. Trois EIV (Escadron d’Instruction en Vol) avaient ensuite été créés pour constituer le GE (Groupement école) 313. Elle devint base aérienne le 1er juillet 1964. La BA 745 était mobilisatrice pour 3 départements : Puy de Dôme, Cantal et Haute Loire. Il était noté qu’elle mettait en cause et entraînait les SAD (?). Etaient stationnées sur la base les unités de la 4e région aérienne, des unités des écoles de l’Armée de l’Air (dont le Germas 15/313 et le Germac 10/745) et une unité de la DTCA. Certaines abréviations m’échappaient. La gendarmerie de l’Air comptait un chef de brigade et quatre gendarmes. Pour la journée du mardi 29 août 1967, le registre du contrôleur d’aérodrome avait été ouvert à 6h30 T.U. (Correction au temps universel de + 1h toute l’année en 1967). La température avait varié entre 19 et 25° soit un degré de plus que la veille. Légère brume en matinée sinon beau fixe tout le reste de la journée (comme la veille). Les différents cahiers d’ordre et de travail aérien (COTA) n’indiquaient que des mouvements de CM-170. Le Fouga CM-170 Magister était le premier avion d’entraînement de l’Armée de l’Air. La dotation de la base comptait 38 Fouga (36 existants), un Marcel Dassault 312 (monoplan) et un Max Holste 1521 « Broussard » (monomoteur de liaison). Aucun hélicoptère. Le même jour, le 1er escadron de formation des moniteurs changeait officiellement de commandant. Le Capitaine M remplaçait Le B qui était affecté au CEAA Villacoublay (Etat-Major). En vérifiant le registre des personnels mutés, je pus vérifier que le nouveau capitaine était arrivé le 23 août. Le Journal des marches et opérations indiquait pour le mois d’août : « Incidents : 3 concernant des CM 170 - Accidents : Néant ». La campagne de tir s’était arrêtée le 10 août et avait repris le 12 septembre. Les manœuvres s’étaient déroulées en octobre (« Alpes67 » du 2 au 6, et « Fatex » à partir du 10). Le retour des D.O. (détachement opérationnel) s’était effectué le jeudi 19 octobre. D’autre part, un GAM (Groupement Aérien de Marche) avait été constitué des appareils de différentes bases et notamment des Alouette II de Chambéry. Les sorties des différentes machines s’effectuèrent sur les terrains d’Aulnat et Marigny. Tout ceci s’était produit en octobre et non au mois d’août. Le 1er août 1985, la BA serait fermée, seul subsisterait l’atelier industriel de l’Air…


T6 CM-170
.2/67 « Valmy» - BA 113 St Dizier-Robinson
L’escadron 2/67 a été créé le 1er octobre 1964. En 1967, il disposait de 32 hélicoptères lourds Sikorski H.34 A et de 13 hélicoptères légers SE 3130 Alouette II équipés d’un turboréacteur Artouste II de 360 CV. Le journal des marches et opérations indiquait - parmi les événements marquants - la présentation du « Super Frelon » par Sud Aviation le 28 juillet et une prise d’arme en présence du général de corps aérien Gauthier quelques jours plus tard. On trouvait aussi un exercice « Latude » du 14 au 18 septembre et une manœuvre « Fatex » du 10 au 20 octobre. Dans ce dernier cas, les Alouette mises en place à Dijon-Metz et Nancy restèrent à la disposition de ces bases. Le 20 septembre, l’escadron recevait son nom de « Valmy ». Sur la période comprise entre le 18 juin et le 11 décembre, il était signalé, concernant les Alouette, des « vibrations cellule » sur un SE 3130 à la date du 29 novembre et une panne turbine sur un autre appareil le 7 décembre. Rien de particulier n’était indiqué à la journée du 29 août 1967. Pour l’anecdote, dans les années 60, la base accueillit régulièrement un hôte de marque : le général de Gaulle. Il s’y rendait en hélicoptère, avant de gagner Colombey-les-deux-Eglises en voiture. Le 29 mai 1968, il se posa sur la base au plus fort de la crise : il repartit incognito rencontrer en Allemagne le général Massu. Le 1er septembre 1972, le 2/67 part s’installer sur la base de Metz-Frescaty, laissant encore pour 2 ans ses H.34 A à St Dizier…
.3/67 « Parisis» - BA 107 Villacoublay
Les 22ème et 23ème escadres d'hélicoptères sont rapatriées le 29 juillet 1962. Un détachement permanent de la 23ème EH s'installe à Villacoublay. Dissoutes, les deux escadres laissent place à cinq escadrons. L'EH 3/67 voit le jour à Villacoublay le 1er octobre 1964. Il reprend le nom de "PARISIS" de l'EC 1/10 et l'insigne "PEGASE" de la SPA 99 (née le 6 novembre 1917). Sa première flotte est constituée de 4 Sikorsky H-34 et 4 Alouette II.
J’estime - d’après les archives (classées à l’époque « confidentiel défense ») que j’ai pu consulter - que la dotation se montait autour de 8 Alouette II et 12 H-34. Le Germas chargé du suivi des appareils était installé sur la BA 113 (voir précédemment). Pour anecdote, je signale un détachement au Tchad où 2 Alouette furent transportées dans un C 160. Le 23 août 1967, un hélicoptère eut un problème 20 minutes après le décollage. Le moteur fit deux « ploufs » entraînant une désynchronisation rotor-moteur. L’appareil passa en auto-rotation et se posa dans un champ. La température était proche du maximum admissible. Après une inspection visuelle par le mécanicien, l’appareil stationna jusqu’au retour à la normale. Le fait que cet incident ait été noté montre très bien que tout était consigné scrupuleusement par les militaires. Le 29 août 1967 : RAS. L’E.H. reçut sa première Alouette III en novembre 1973.
.1/68 « Pyrénées» - BA 119 Pau (Basses Pyrénées)
Issue de la 22ème escadre d'hélicoptères, l'EH 1/67 "Pyrénées" puise ses origines dans la guerre d'Algérie. Dès la fin des opérations en 1962, les deux escadrons qui composent la 22ème escadre s'installent à Chambéry. Le premier escadron, le 2/22, a un détachement permanent à Istres. Le deuxième escadron, le 3/22, a un détachement à Pau. Il y a également Cazaux, cédé par la 23ème escadre de Saint-Dizier. En 1964, la 22ème escadre est dissoute et se scinde en deux escadrons autonomes : le 1/68 à Pau et le 2/68 à Chambéry. L'EH 1/68 obtient en 1966 le nom de tradition "Pyrénées". Le journal des marches et opérations indique que durant le mois d’août, un H-34 était détaché à Istres pour lutter contre les incendies de forêt du Sud-Est. Le DPH Cazeaux était stationné sur la BA 120 de Cazaux. La maintenance 2ème échelon était assurée par le Germas 15/068 de Chambéry. Cela devait probablement entraîner des déplacements entre les deux unités. Le Groupe d’Entretien et de Réparation des Matériels Spécialisés (Germas) avait été créé en 1964. Il entretenait tous types d'appareils de son arme et notamment les hélicoptères. Le site internet du Ministère de la Défense indique que le 1/68 reçut ses premières Alouette en 1974. J’ai pourtant trouvé des informations différentes dans le journal de marches (?).
Pau => 11 Sikorsky S.58 – H.34 A et 2 SE3130 DPH Cazaux => 4 H-34 et 4 Alouette
Le journal détaillait les caractéristiques du SE 3130 : « 3h15, rayon d’action : 250 Km, équipage : 1 pilote (place droite), poids à vide : 900 Kg environ, maxi : 1 600 Kg, 4 passagers maximum… chauffage prévu ».
Le 19 août 1967, une Alouette avait transporté le ministre des anciens combattants de Tarbes à Luchon. Le 21, c’étaient deux H-34 qui étaient chargés de transporter 43 tonnes de matériaux destinés à la construction d’une cabane de bergers au profit de la commune d’Arudy. Le 29 août, il était noté « evasan Cazaux – Magescq – Hopital Pellegrin 1 crânien ». « evasan » devait vouloir dire « évacuation sanitaire ». Apparemment 6 militaires y avaient participé. Probablement dans un H-34. Cet hélicoptère devait pouvoir transporter plus de 12 hommes. Par la suite, plus rien avant le 1er septembre. Une seule sortie, à 10h30 (durée 1h) était noté dans le COTA de Cazaux. Un H.34 avec 3 personnes à bord. La sortie pour le « crânien » avait dû avoir lieu dans l’après midi.
Le CRMSA (Compte Rendu Mensuel de Situation et d’Activité aérienne) signalait un H.34 et une Alouette I supplémentaire par rapport à l’effectif normal. Le n°194 en remplacement du n°343 accidenté (bien avant le mois d’août). Côté panne répétitive il était noté : « RAS ».
Un COTA de Pau précisait qu’un SE3130 (n°152) - avec 3 hommes à bord - avait décollé le 29 août 1967 à 12h20 pour se rendre de Pau à Cognac. Durée du vol : 1h55. Il était rentré vers 16h. Durée totale du vol : 3h40. Rien d’autre à signaler en dehors d’un H34 en entraînement dans le secteur Sud. Le 30 août un H34 avec 4 passagers s’était posé (lieu indéterminé) suite à un bruit anormal.
.2/68 « Maurienne »
Le détachement d'instruction en vol (DIH) sur hélicoptères a été créé sur la base école 721, à Rochefort, en juin 1954 et dissous en décembre 1955. La division d'instruction hélicoptères est alors créée sur la base école 725 à Chambéry en janvier 1956. Les 150 pilotes d'hélicoptère de l'Armée de l'Air en service au 31 janvier 1956 avaient été formés par 13 organismes différents, allant des sociétés d'outre-Atlantique à une école de l'Armée de Terre, en passant par la formation sur le tas en Indochine et en Algérie. Il en résultait un manque d'homogénéité dans les conditions d'utilisation des hélicoptères et il fallait compléter l'instruction technique par une instruction tactique. Comme pour toute école de pilotage, il y a lieu de rechercher un site offrant de bonnes conditions météorologiques, hors des grandes voies de circulation aérienne et de l'activité normale des avions. Pour les hélicoptères, il était indispensable de disposer d'une région montagneuse, d'un plan d'eau et des installations propres à assurer leur fonctionnement. La base aérienne de Chambéry réunissait à elle seule toutes ces conditions. La DIH est dissoute le 30 septembre 1964 après avoir formé ou transformé sur hélicoptère plus de 1 500 pilotes. La 2e escadre d'hélicoptères créée le 1er novembre 1956 devient, en juillet 1961, la 22e escadre d'hélicoptères, gardant le drapeau de la 2ème EH ainsi que les fanions des escadrons dissous. Ayant quitté l'Algérie en novembre 1962 pour s'implanter sur la base aérienne 275 de Chambéry, la 22e EH est dissoute le 30 septembre 1964.
L'escadron d'hélicoptères 02.068 est créé le 1er octobre 1964. Rattaché au Commandement du Transport Aérien Militaire (CoTAM), il assure désormais les missions opérationnelles de la 22ème EH et les missions d'instruction de la DIH. L'EH 2/68 a repris l'insigne et les traditions de la 22ème EH tandis que le nom de tradition « Maurienne » lui était attribué… Le Germas 15/068 assurait le 2e échelon pour les H.34 et les Alouette.
J’ai consulté le journal de marches et opérations (estampillé « classé confidentiel » à l’époque). Il était agrémenté de nombreuses photos, d’articles de presse illustrant diverses interventions (aucune le 29/8) et d’anecdotes. Le 18 juillet un H34 était envoyé en exposition statique « au milieu des vignes » à la grande joie des enfants de la colonie de vacances de Champagneux (73240) sur demande de son directeur. La météo du mois d’août 1967 était notée « favorable ». Le nombre d’heures de vol effectuées s’élevait à 132h10. De nombreux incendies avaient ravagé les forêts de Provence. L’Alouette avec l’adjudant Dumont et le sergent B (mécanicien) avait dû guider à maintes reprises les trois H-34 de l’escadrille des Landes, transportant pompiers, fret et eau. Le 17, un hélicoptère (modèle inconnu) était chargé de prendre des photos dans le secteur du lac du Bourget en vue d’une étude statistique de la circulation routière. Le 26, après une mise en place à Dole (39100), le ministre de l’agriculture Edgar Faure était transporté par les soins du capitaine J jusqu’à Pontarlier (25300) : un aller-retour entre le Jura et le Doubs. Le capitaine J avait pris le commandement de la 1ère escadrille en juillet ; il avait été entraîné pour l’attribution des fonctions de moniteur et leader pilote. Le 7 septembre, il dut se rendre à Aulnat (63510 – Puy-de-Dôme) accompagné d’un mécanicien, le sergent-chef P. Il effectua plusieurs rotations de passagers entre Aulnat base et la Courtine (23100 – Creuse), en vue de l’exercice Fatex prévu au mois d’octobre. Un vol intéressant mais qui malheureusement ne passait pas par le Cantal.
Le 17 août, l’envoi de 3 pilotes et 2 mécaniciens à St Mandrier (Var) pour un exercice « gloutte » aurait pu nous intéresser si sa route était passée par l’Auvergne. Cet exercice consistait à immerger une cabine de H-34 et son équipage en vue de les préparer à un amerrissage forcé. Il avait lieu, en général, une fois de jour puis une fois de nuit. Le 28, le sergent-chef Bourdillon, reçu aux E.O.A., était affecté à l’Ecole Militaire de l’Air de Salon-de-Provence. Remarque: il s’agit de la BA 701. J’ignore s’il s’y est rendu en hélicoptère mais de toute façon, le chemin le plus direct ne passe pas par le Cantal.
Moyens opérationnels
05/725

E.H. 2/68
« Maurienne » Chambéry

M.O. 05/125 ISTRES
- secrétariat
- opérations
 - O.A.T.
- O.A.T.
- S.E.

 - section vols de contrôle
- section vols de contrôle
1ère
escadrille 6 Alouette E.I.H –
C.I.E.H. 4 H.34 (Escadrille
d’instruction hélicoptères) 2e
escadrille 18 H.34
D.P.H.
Istres 6 H.34 - 4
Alouette B.A. 725
L’Alouette III est utilisée au
C.I.E.H. à partir de 1972
(source CRMSA)
Le 29 août, un H-34 est envoyé dans la région du Mont Thabor (Hautes Alpes) suite au crash d’un stamp belge (le COTA en signale un second, les 2 vers 17h, rien en matinée). Le dernier accident d’Alouette - sur le territoire français - remonte au 12 août dans l’Yonne (à St Père). Il mettait en cause un SE3130 de la gendarmerie.
Le 29 août, à 11h30, une Alouette (n°149) décolle de Chambéry pour effectuer un vol d’orientation (1 pilote et 3 mécaniciens). Le vol ne dure que 25mn : beaucoup trop court pour se rendre dans le Cantal. Un stage (S.T.H. 7) qui s’était déroulé du 8 au 29 août attira davantage mon attention. Le lieutenant C de l’E.H. 1/68 Cazeaux et le sous-lieutenant D, de l’E.H. 3/67 Villacoublay y participaient. Si on trace une ligne droite entre Cazeaux et Chambéry, le vol traverse l’Auvergne. Il semblait néanmoins plus prudent de se poser à Aulnat pour se ravitailler, d’autant plus que le lieutenant C sortait juste d’une formation sur H-34 au C.I.E.H. (Centre d’Instructions des Equipages d’Hélicoptères). Elle s’était terminée le 29 août. Mais à quelle heure ? Le premier décollage (un H-34) qui était noté sur le cahier du C.I.E.H. avait eu lieu à 13h45 car celui de 10h45 avait été annulé. Je pus trouver - sur le cahier de la 1ère escadrille - une Alouette qui avait décollé à 10h50. Le vol aller-retour avait duré 45mn. La durée du vol était trop courte pour se rendre jusqu’à Cazeaux (ou Cussac). L’indication « terrain » dans la colonne mission devait signifier qu’elle s’était déroulée près de la base. Dans les autres cas, une localité de destination était toujours indiquée. Je remarquai qu’un autre vol de H-34 avait eu une panne au décollage. Les pannes les plus courantes semblaient toucher le rotor de queue. Deux appareils avaient eu ce type d’incident le 23 août. Une fois de plus, le moindre petit incident était scrupuleusement noté. Le lieutenant C semblait finalement ne pas être reparti en matinée. En tout cas, rien ne semblait l’indiquer et, de toute façon, la machine observée à Cussac ne se dirigeait pas en direction de Cazeaux. Cette piste ne me semblait pas assez solide. Le lendemain une Alouette (n°342) se rendait à St Dizier (source CRMSA). Lors des manœuvres « Fatex » une autre Alouette dut se rendre à Aulnat (Clermont Ferrand) mais c’était en octobre 1967…


Sikorsky H.34
Concernant le détachement d’Istres, un article du Midi libre du 23 août indiquait qu’une brûlée de Bizanet avait été transportée à l’hôpital St Luc (Lyon) par hélicoptère. Une autre intervention le 25 août pour lutter contre un incendie de forêt dans le secteur des Bonfillons (Bouches-du-Rhône) avait été écourtée par la tombée de la nuit. Trois hélicoptères et deux Alouette apparaissent sur le COTA du 29 août. Une seule Alouette II (n°10) avait décollé en matinée (à 9h15). L’équipage était composé de deux militaires. La mission d’entraînement avait duré 1h30. La journée s’était achevée avec le pot (un « punch martiniquais ») de départ du capitaine Bican. Là encore, rien de très concret à mettre en rapport avec l’observation de Cussac.
.DPH 4/68 – BA 200 Apt-St Christol
Ce détachement permanent d’hélicoptère ne fait son apparition que le 1er juillet 1968 avec 2 Alouette II en provenance de Chambéry. Son rôle était d’assurer la protection (par des rondes) de la base support du 1er Groupement de Missiles Stratégiques (GMS) sur le plateau d’Albion. Le cahier d’ordres et d’entretien ne commence effectivement que le 28 août 1968. Le 1er mai 1975 sera créé le EH 4/67…
.DPH 5/68
Le
29 juillet 1962, les premiers appareils de l'escadron
d'hélicoptères 2/23, rentrant d'Algérie,
apparaissent dans le ciel de Provence. Un détachement est
implanté sur la base aérienne 125 d'Istres et
l'escadron 2/22, basé à Chambéry. En 1964,
les escadres d'hélicoptères sont dissoutes et les
nouveaux escadrons constitués sont rattachés au
commandement du transport aérien militaire.
Le
détachement d'Istres devient permanent et prend
l'appellation DPH 2/68 (voir précédemment). En
1969, nouvelle restructuration des unités d'hélicoptères
et nouveau sigle : DPH 5/68. Le détachement dépend
toujours de l'escadron de Chambéry. Il est toujours équipé
d'Alouette II et de Sikorsky H-34 et renforcé, en 1972,
par des Alouette III. Le détachement 5/68 est dissous en
1975 et remplacé par l'escadron d'hélicoptères
5/67. Les H-34 sont remplacés par des SA-330 Puma. L'unité
reprend l'insigne et les traditions de l'EH 1/67, formé à
Bremgarten en RFA en 1964 et dissous en 1966. Il reçoit le
nom de tradition "ALPILLES"…
Groupe de Liaisons Aériennes Ministérielles (G.L.A.M)
En 1961, le G .L.A.M. remplace ses Alouette II par des Alouette III. Il en possédera 3 (1963 à 1981 - 1075,1076 et 1115). Ses déplacements doivent être secret défense pendant 90 ans. Le 5 mars 1967, Georges Pompidou (né le 5 juillet 1911 à Montboudif ) est élu député du Cantal avec 62,3 % des suffrages. Le 6 avril, il est nommé une nouvelle fois Premier ministre par le Général de Gaulle. De 1964 à 1971, il effectue huit voyages dans le Cantal. Pour 1967 : du 10 au 11 juin (Saint-Flour, Lioran) et le 13 octobre (Saint-Flour, Aurillac). (Source : Association Georges Pompidou). Eté 1967, le Général de Gaulle vient de rentrer de son voyage au Québec et prépare un déplacement en Pologne. Il ne se serait pas rendu en Auvergne sans Georges Pompidou (qui en était originaire). La presse que j’ai pu consulter ne signale aucun déplacement d’autorités gouvernementales dans le Cantal. Le G .L.A.M., qui était basé à Villacoublay, n’a aucune raison de se trouver dans cette région le 29 août 1967. L’unité est dissoute le 19 juillet 1995 par le président Jacques Chirac. Depuis, les liaisons interministérielles sont du ressort de l’ETEC (GAEL) Villacoublay ou l’ET 3/60 Estérel Creil. Pour anecdote, le 1er mai 1993, Pierre Bérégovoy se suicide au bord d’un canal de Nevers. A 20h20, une Alouette III de la Sécurité civile avec son équipage - un pilote et un mécanicien - décolle de Clermont-Ferrand avec le plein de carburant. L’hélicoptère se pose à Nevers à 21h05 pour emmener le Premier Ministre. Le pilote ne refait pas le plein et décolle à 21h32. P. Bérégovoy décède à la verticale de la balise de Pithiviers à 22h15 (Les liaisons dangereuses de Pierre Bérégovoy - Charle Villeneuve).
K / Service Historique de la Défense (S.H.D.), département « Marine »
Ma dernière visite à Vincennes a eu lieu au mois de mars 2008. En pratique, la réservation des documents se faisait de la même façon que pour l’Armée de l’Air. Je commençai par consulter quelques revues d’époques en accès libre puis je réservai deux ouvrages à la salle de lecture du pavillon de la Reine. L’hélicoptère avait fait son apparition dans la Marine Française le 3 octobre 1951 avec l’arrivée à Saint-Mandrier d’un Bell 47 D acheté d’occasion. Je décidai de demander à consulter les archives de la base aéronautique de Hyères et là, à ma grande surprise, on me répondit qu’il n’y avait quasiment rien à Vincennes avant les années 70. On y trouvait principalement des documents (2 DD7 et 3 DD7) de l’Administration centrale. Le reste se trouvait dans les flottilles. J’entamai la discussion avec un fonctionnaire qui me précisa que les archives d’un accident d’hélicoptère (en Auvergne !) venaient d’être versées à Vincennes. Encore sous le coup de la surprise, je rentrai chez moi et découvris que l’accident avait eu lieu le 9 avril 1991. Un Lynx de la 24F (L’humanité parlait d’un Puma ?) était entré en collision avec un Mirage 2000N de l’Armée de l’Air (basé à Istres) près de Cros (sud du Puy-de-Dôme). Aucun survivant. Les deux appareils participaient à des manœuvres inter-armes ce qui relativisait l’impact sur mon enquête. En effet, comme on a pu le voir précédemment, il n’y avait pas de manœuvre dans le secteur de Cussac en 1967. De plus, la circulation des hélicoptères de la Marine s’était beaucoup développée suite aux grandes marées noires française (18 mars 1967, le Torrey Canyon touche l’Angleterre, 11 ans plus tard c’est l’Amoco-Cadiz qui défigure les côtes bretonnes…). Un autre accident mortel avait eu lieu le 2 juin 1967. Le HSS-1 58681 de la 33F, en transit de Toulouse vers Saint-Mandrier avait percuté le sol près de Servian (Hérault). Ce Sikorsky venait peut-être d’une base située sur la cote Atlantique. La route la plus courte ne passait pas par le Cantal. L’Ardhan (Association pour la recherche de documentation sur l’histoire de l’aéronautique navale www.aeronavale.org) m’indiqua - pour l’Auvergne - que l’on avait tendance à contourner les massifs que l’on pouvait éviter et, par exemple, passer par la vallée du Rhône. Je concentrai mes recherches sur 3 escadrilles. Le 15 avril, le S.H.D. de Brest m’informa que les recherches concernant l’escadrille 22 S s’étaient révélées négatives. Une semaine plus tard, le S.H.D. de Toulon m’apprit que les recherches sur la 20 S s’étaient révélées infructueuses. Les cahiers d’ordres de vols de la 23 S étaient par contre disponibles. Je pris contact aussitôt par téléphone avec le conservateur qui me suggéra de demander à une personne de la salle de lecture de faire la recherche pour moi. Cette personne me fit parvenir une photocopie extraite du document qui ne révéla que des déplacements dans le secteur proche de la base.
Alouette II (SE 3130/SA 313)
Nombre d’exemplaires utilisés : 32 livrés et 3 prêtés par l’Armée de l’Air
Unités utilisatrices (1956 à 97) : 6 1967 : 3 (20S, 22S et 23S), 1 Super-Frelon livré en juillet à la 20S
Alouette III (SA 316B – SA 316VSV – SA 319B) => SA 319B construction 1967 mais fabrication en série 1973.
Nombre d’exemplaires utilisés : 27 SA316B ; 5 SA 316B VSV ; 17 SA 319
Unités utilisatrices (1962 à 99) : 8 1967 : 3 (20S, 22S et 23S)
(D’après Histoire des hélicoptères de l’Aéronautique Navale - ARDHAN 2007 - 13 €)
L/ Les douanes
Alain Delmon m’a communiqué l’adresse d’un site internet dont j’ai extrait ce passage : « En 1955, un évènement bouleversait le monde de l'hélicoptère : la motorisation par une turbine à gaz apportée par le génie de TURBOMECA et le constructeur national SNCASE. Celles-ci avaient développé le SE 3130 Alouette II, appareil polyvalent, pour lui confirmer une place importante dans le parc aérien des trois armées françaises mais également dans les différents services publics. Les Douanes ne pouvaient pas y rester indifférentes, ayant acquis les moyens nécessaires à la création du service espéré depuis dix années. Disposant des personnels et des fonds, l'embryon de toujours allait prendre forme en 1960. Le premier décembre 1960 la Marine Nationale louait aux Douanes un hélicoptère Alouette II (n°1233/137 F-YCWT). L'hélicoptère remplissait toutes les conditions demandées, une commande de deux SE 3130 Alouette II était notifiée à la SNCASE en 1961. Officiellement le 25 juillet 1962 les Douanes réceptionnaient le SE 3130 Alouette II (n°1773 F-ZBBA), remplaçant l'Alouette II de la Marine qui était basé à Saint-Mandrier. La base était définitivement créée le 14 février 1963 avec la dénomination officielle de Groupement Douanier d'Hélicoptères. Le second SE 3130 Alouette II (n°1828 F-ZBBB) épaulait la première machine en juin et déjà plus d'une dizaine d'hommes formaient les équipages. Le succès rencontré sur les côtes méditerranéennes avec l'hélicoptère donnait logiquement, à la Direction Générale, l'adoption du même dispositif sur la côte Atlantique pour la même prestance. Des tests avec les hélicoptères étaient jugés insuffisants et même dangereux pour la sécurité des équipages. Le Groupement Douanier d'Hélicoptères se tournait vers les voilures fixes bimoteurs. Le rapide inventaire des aéronefs de cette catégorie amenait le choix du Dornier DO-28… » Les Alouette II n’étaient donc pas dans le secteur du Cantal.
M/ Les hélicoptères étrangers
En 1966, la France annonça qu’elle n’affecterait plus de forces à l’O.T.A.N. et se retirerait de la structure militaire intégrée, ce qui impliquait le départ des quartiers généraux et des unités alliées, qui devaient avoir quitté le territoire français avant le 1er avril 1967 (Source OTAN Hebdo). Il est donc inutile de chercher un hélicoptère militaire américain en août 1967. On est à plus de 250 km de la frontière, il me semble donc logique d’écarter l’hypothèse d’un hélicoptère d’une puissance étrangère. Je ne vois d’ailleurs rien d’intéressant à espionner dans ce secteur, que ce soit dans le domaine militaire ou civil. Le Merckle SM-67, concurrent et copie allemande du Sud-Aviation SE-3130, ne dépassa jamais le stade de prototype. Le troisième exemplaire (V-3) immatriculé D-9506 et unique survivant est exposé au musée de l’hélicoptère de Bückeburg. Le biturbine Bolkow Bo-105 est un hélicoptère léger allemand, 4/5 places dont le premier vol date de février 1967. Le rotor, de type rigide, a été mis au point en collaboration avec Sud-Aviation. Le premier modèle commercial remonte à 1970, le militaire à 1978 (Science et Vie Aviation 67). En 1967, un essai sur feux de forêts fut effectué du côté de Nice par le Mil Mi 6 russe (bombardier d’eau) après son passage au Bourget. Une photo a d’ailleurs paru dans Le Méridonial du 12 juillet 1967. Il est d’une trop grande envergure.



Merckle SM-67 © Pierre Gillard) Bolkow Bo-105 Mil Mi 6 russe
Durée totale de l’observation
Lors de la reconstitution du G.E.PA.N. en 1978, les enquêteurs ont chronométré - séparément - le temps écoulé entre l’instant où les témoins voient la « machine », le moment où elle décolle et celui où elle disparaît. La durée totale de l’observation tourne entre 21 et 35 secondes.
Le pilote Pierre Gillard que j’ai interrogé à ce sujet m’a répondu : « Le temps complet de mise en route est de l'ordre de 2 minutes. L'Alouette est un des hélicoptères les plus rapides au démarrage.»
J’en ai informé Alain Delmon qui me répond à son tour : « Merci beaucoup. Mais même très rapide (2 minutes), ça reste très supérieur au temps total de l'observation de Cussac (30 sec au sol, 1 min au total). Donc ou bien le moteur n'était pas arrêté, ou bien ce n'était pas un hélicoptère La première hypothèse est évidemment impossible. Les enfants l'auraient signalé (bruit, souffle, impression visuelle). Aucun équipage ne descend AU COMPLET d'un hélico avec le rotor en marche. Les enfants auraient signalé que les 4 êtres revenaient vers la machine COURBES ET TETE EN BAS (réflexe naturel en passant sous un rotor en marche). Etc. Conclusion ... Ce n'était pas un hélico »
André Morel ajoute : « Pour répondre à votre question 2 cas peuvent se poser pour le Bell 47 qui va décoller. 1er cas: si le moteur est froid il faut attendre environ 4 minutes avant qu'il atteigne sa température normale plus une minute pour effectuer les différents contrôles soit environ 5 minutes. 2ème cas: si le moteur est chaud : décollage maximum 2 minutes entre le démarrage du moteur et le décollage. En ce qui concerne l' Alouette II c'est à très peu près la même chose mais il y a tellement longtemps que je n'ai plus piloté d'Alouette II que je ne peux pas être très précis. Certains Bell 47 J étaient équipés de freins rotor mais ils avaient tellement peu d'efficacité qu'on les avait abandonnés et que lorsqu'ils devenaient inefficaces on ne les réparait même plus.». Je précise qu’en l’absence de frein rotor, si le moteur n’est pas arrêté, les pales continuent à tourner.
C. Poher ajoute que si le moteur n’était pas arrêté, il fallait obligatoirement une cinquième personne à bord car le risque de retournement est trop grand lorsqu’une machine est laissée, sans pilote, avec un rotor tournant. Cela élimine une nouvelle fois le Bell 47-j qui était quadriplace.
La réponse est dans l’Hebdo de 1968 : «…Le quatrième (inconnu) a plongé. L’appareil s’est mis en marche : on entendait un faible sifflement… ». La « machine » était donc bien arrêtée…
L’autonomie
A/ L’Alouette
Je laisse la parole à A. Delmon : « J’ajoute à ce sujet qu’on ne peut réduire ce temps en supposant que le moteur était resté en marche. Car cela supposerait qu’une 5ème personne, le pilote, serait restée à bord. Or avec 5 personnes à transporter, à 1000 m d’altitude, une Alouette II verrait son autonomie chuter dramatiquement à 150 km seulement. Les seuls aérodromes civils ou militaires autour de Cussac compatibles avec cette distance sont Aurillac, à 40 km à vol d‘oiseau, soit 80 km aller-retour, et Rodez (base EDF) à 78 km, soit 156 km aller-retour. Or le cap Cussac->Aurillac est de 259° (O-SO), et le cap Cussac->Rodez est de 202° (Sud), alors que l'OVNI a disparu au cap 289 à 297° (O-NO). »
Concernant l’autonomie d’une Alouette il ajoute : « Communication personnelle du Colonel (en retraite) L, chef du service historique de la Base Pétrolière InterArmées ( BPIA ) de Châlon -sur-Saône. Cette autonomie peut néanmoins être confirmée par un calcul simple. Avec un poids à vide de 975 kg les premières Alouette II avaient une capacité maximale d'emport de 525 kg (masse maxi au décollage de 1500 kg). Si on retranche le poids de 5 hommes d'équipage de poids et équipement moyen (5 x 80 = 400 kg), il reste 125 kg pour le kérosène, soit 156 litres (masse volumique du kérosène = 0,8). Or la consommation minimale optimale d'un tel appareil est de l'ordre de 1 litre au kilomètre. La distance maximum franchissable était donc d'environ 156 km. Autre source : revue mensuelle GEND'info, Novembre 2003, page 22 : "En considérant qu'un individu moyen pèse 80 kg, on doit retirer 100 litres de carburant par passager, la masse volumique du kérosène étant de 0,8. C'est de l'autonomie perdue. »

Je décidai de vérifier les calculs afin de voir si j’obtenais les mêmes résultats par d’autres sources, en l’occurrence le site internet Hélimat qui comportait un article sur le cinquantenaire du premier vol en Alouette II, celui d’Aerostories et du Conservatoire de l’Air et de l’Espace d’Aquitaine (C.A.E.A). D’après Hélimat, la capacité du réservoir normal d’une Alouette II (1 500 Kg) était proche de 575 litres. Le turbomoteur et ses accessoires fonctionnaient indifféremment au TRO, TR4, TR5 et dieseline. Il pouvait aussi fonctionner à l’essence éthylée pendant une courte période (25 heures entre révisions). La distance franchissable (en atmosphère standard au niveau de la mer, par vent nul) était de 550 Km. C’était probablement inférieur en montagne mais il n’y avait pas de précision. Il était indiqué que la masse totale variait selon les générations. Elle passa à 1 600 Kg pour les appareils équipés du Turbomoteur Artouste IIC5 et IIC6 et ayant reçu les modifications des bulletins services correspondants. De nouvelles dénominations de types se créèrent en 1968 par des variantes différenciées selon leur masse au décollage.
C. Poher précise sur son site (extraits) : « Au niveau de la mer, le rotor de cet hélicoptère, à pleine puissance, pouvait soulever au maximum 1600 kg tout compris. A l’altitude de Cussac, cette masse maximale de décollage serait réduite de 11% à cause de la densité atmosphérique de l’air à cette altitude. Soit une masse maximum "décollable" de 1424 Kg à Cussac. La masse à vide de cette machine étant de 890 kg, la charge totale embarquable pour un décollage de Cussac est donc égale à :1424 - 890 = 534 kg. Soit 4 hommes, sans équipement, de 80 kg chacun (320 kg) et 214 kg de kérosène ou bien 4 hommes, avec équipement, de 100 kg chacun (400 kg) et 134 kg de kérosène ou bien 5 hommes, sans équipement, de 80 kg chacun (400 kg), dont un pilote restant aux commandes (afin d’assurer le décollage immédiat observé), et 134 kg de kérosène. Au delà, le décollage serait impossible… Un pilote, aux commandes, laissant tourner le rotor, et quatre plongeurs (exemple) équipés, soit au total 480 kg ne laisseraient que 50 kg de kérosène. La consommation du moteur Artouste IIC, à pleine puissance, était de l’ordre de 160 litres par heure (128 kg). Donc l’autonomie d’une Alouette II, décollant de Cussac, serait de : 1 h 40 minutes pour 4 personnes non équipées, de 62 minutes pour 4 personnes équipées et de 25 minutes pour un pilote et 4 plongeurs (exemple) équipés. Soit respectivement 246 km, 160 et 60 km avant la panne sèche totale. Seule la première option serait compatible avec un atterissage sur un aérodrome disposant de kérosène en 1967… ( Le pilote) devrait obligatoirement arrêter le moteur et le rotor avant de pouvoir débarquer. Il y a en effet un risque majeur, quasi systématique, de retournement d’un hélicoptère laissé libre, sans pilote, avec un rotor tournant …(Le pilote) devrait ensuite redémarrer la turbine, l’amener à plein régime, et décoller l’Alouette II, le tout en moins de 10 secondes, ce qui est totalement impossible.»
Je pris contact avec lui début septembre 2007 afin qu’il m’explique son calcul. Voici sa réponse : « La masse totale que peut soulever un rotor d'hélicoptère est approximativement proportionnelle à la densité de l'air qu'il brasse. Donc si l'hélicoptère est en altitude, la densité de l'air diminue et la masse totale en charge ne peut pas être la même qu'au niveau de la mer. La masse à vide étant constante, seule la masse maximale de charge utile peut varier en fonction de l'altitude. Il faut faire la soustraction : masse charge utile = masse totale décollable - masse à vide. Seule la masse totale décollable est proportionnelle à la densité de l'air. Il faut consulter une table d'atmosphère standard. Au niveau de la mer, la densité de l'air est de 1,293 kg / m3. A une altitude de 5 km, la densité a diminué dans le rapport 1,6636, elle est donc de 0,777 kg / m3 à 5000 mètres d'altitude. Vous pouvez interpoler linéairement entre ces valeurs. Idem pour la masse totale décollable. 100 % au niveau de la Mer, et 100 x 0,777 / 1,293 = 60 % à 5000 mètres. Vous perdez 40 % de masse totale décollable pour 5000 mètres donc environ 12 % pour 1000 mètres. La charge utile maximun diminue de 12 % + 12 % de la masse à vide. Si la charge utile est de 1000 kg et la masse à vide de 900 kg au niveau de la mer, elle sera de 880 - 108 = 772 kg à 1000 mètres. Et 772 kg représentent une perte de 22,8 % de charge utile !!! Donc la charge utile maximum décroît beaucoup plus vite que la densité de l'air. C'est très grossier mais à peu près correct. En réalité le taux d'humidité et la température interviennent aussi. Evidemment, le carburant doit être inclus dans la charge utile. Donc vous ne pouvez pas appliquer 11 % sans réfléchir. La masse de 890 kg a été trouvée sur les publications du constructeur de l'époque autant que je me souvienne. (Que ce soit 850 ou 890 ne change rien aux conclusions, car un passager adulte équipé ne pèse pas 40 kg). Cordialement, CP »
Il m’était néanmoins très difficile de trouver le vrai poids à vide de l’Alouette. La masse de l'appareil semblait varier en fonction de l'équipement à bord, que ce soit le lot de bord, les fluides, les équipements, hydrauliques ou non. Les archives de l’A.L.A.T. donnaient 860, l’Armée de l’Air 900 kg environ, Poher parlait de 890, et certains sites donnaient 895 kg (?). Afin de préparer le cinquantenaire du premier vol en Alouette II, Hélimat (site internet) avait pris ses informations dans les premiers manuels de vol édités et proposait 877 Kg, pour un siège pilote, une simple commande, deux portes, l’installation électrique, le démarrage autonome et les trains patins. J’avais aussi essayé d’avoir des informations auprès d’Eurocoptère mais j’avais été très déçu. Le site internet était en anglais et la responsable de la Médiathèque que j’avais eue au téléphone était plus intéressée par la musique qu’elle écoutait que par les questions que je lui posais. J’en fis part à André Morel qui me répondit : « Ce que vous me dites au sujet de l'accueil que vous avez eu à Eurocoptère ne m’étonne absolument pas et même les anciens cadres supérieurs et pilotes d'essai qui travaillaient n'y vont plus jamais… ». Je finis par trouver deux brochures « publicitaires » de Sud Aviation, malheureusement peu précises et plutôt à l’avantage du produit. J’envoyai aussitôt une partie des documents (voir pages suivantes) à C. Poher afin qu’il me donne son avis.
Sa réponse me parvint le lendemain : « Les deux jeux de courbes que vous m'avez envoyés ne sont manifestement pas pour la même machine, car l'un correspond à une masse maximale au décollage de 1500 kg et l'autre de 1600 kg. Autrement dit, il s'agit de rotors différents ou de masse à vide différentes. Mais je vais pouvoir vous expliquer quand même.
1
-- Prenez la courbe de la charge utile (charge marchande) en
fonction de la distance à parcourir, pour la machine de
1600 kg maxi. Vous voyez que pour zéro distance (pas de
carburant) la masse maxi de charge utile est de 625 kg. Par
conséquent la masse à vide de cette machine est
1600 - 625 = 975 Kg
2 -- Un hélicoptère à turbine consomme du kérosène, que l'on ne trouve pas chez les distributeurs de carburant routier. Cela signifie que le plein de kérosène doit obligatoirement se faire sur un aérodrome équipé. Il ne s'agit pas d'un terrain pour aviation de tourisme ou pour des planeurs, mais d'un terrain pour des avions à réaction. Cela vous permet de chercher, autour de Cussac, l'aérodrome le plus proche permettant de faire le plein de kérosène. Il me semble que c'est Limoges (?). Quand cela est fait, vous mesurez la distance en ligne droite entre cet aérodrome et Cussac. Vous multipliez par 2 et vous ajoutez 20 % pour la sécurité. Vous obtenez la distance totale à franchir. Puis, toujours dans le même graphique, vous en déduisez la masse de carburant à embarquer. Par exemple, si l'aérodrome était à 80 km de Cussac, 2 x 80 + 20 % = 200 km. la distance totale à franchir étant de 200 km, vous constatez que la masse de charge utile devient 500 kg au lieu de 625 kg, ce qui signifie que vous devez embarquer au minimum 625 - 500 = 125 kg de kérosène. Mais je doute qu'il y ait du kérosène à 80 km de Cussac, ce n'est qu'un exemple. Vous voyez, sur le diagramme de consommation, qu'à 1000 m d'altitude et avec 1600 kg, il faut environ 0,75 litre de kérosène au km, avec une densité de l'ordre de 0,8 kg / litre. Aller-retour, cela fait environ 1,2 kg de kérosène au km (si on prend la distance entre l'aérodrome et le point d'arrivée en campagne).
3
-- On vérifie qu'il est possible de voler à 1000
mètres d'altitude avec 1600 kg. Sur le diagramme des
plafonds, on constate que 1600 kg est la limite extrême à
ne pas dépasser. Sur l'autre courbe, vous voyez qu'il est
possible de décoller avec l'aide de l'effet de sol, à
1000 mètres d'altitude, et une masse de 1600 kg, jusqu'à
une température de +30°C. Cependant, hors effet de
sol, avec 1600 kg, vous ne pouvez pas dépasser une
altitude de 1200 mètres, soit 200 mètres au-dessus
du sol, ce qui est interdit par les règles de la
navigation aérienne. Afin de respecter ces règles,
il faut pouvoir atteindre au moins une altitude de 1500 mètres
hors effet de sol. La courbe des plafonds vous indique alors que
vous devez avoir une masse maximale totale de l'ordre de 1500 kg.
C'est la raison pour laquelle le
diagramme
d'autonomie est établi pour 1500 kg. Donc, en
pratique, cet hélicoptère est limité à
1500
kg maximum pour se rendre à Cussac. Par conséquent, avec une masse à vide de 975 kg, il reste 1500
-
975 = 525 kg pour des passagers complètement équipés
+ le kérosène.
Si vous avez 200 km à
faire, il reste 400 kg pour les passagers.
Si vous avez 400 km
à faire, il ne reste que 275 kg pour les passagers. etc
...
4 -- L'autre jeu de courbes est établi pour une masse maximale de 1500 kg, et vous n'avez pas le droit de prolonger les courbes pour 1600 kg, comme vous l'avez fait (remarque : c’était en effet une erreur, d’ou le « blanc » sur le document). Le rotor est incapable de soulever 1600 kg sans "décrocher", c'est-à-dire ne plus rien porter du tout. C'est un autre rotor. Ces courbes révèlent qu'à une température de 20 °C, on peut monter au maximum à 1500 mètres. Cela permet tout juste de respecter les règles de la navigation aérienne au-dessus de Cussac. Idem avec ce que nous avons vu. Je pense donc qu'à Cussac, il faut considérer une masse totale maximum de l'ordre de 525 kg pour les passagers et le kérosène. Comptez 1,2 kg de kérosène par km de distance entre Cussac et le point de ravitaillement en kérosène. Un passager équipé complètement = 100 kg en général (80 kg sans rien). La photo qui se trouve au-dessus du diagramme de poids maximum au décollage montre un appareil sans portes, avec un seul siège (pilote) et probablement très peu de kérosène pour soulever une camionnette 2 CV. On peut se demander si la masse à vide de 975 kg calculée avec ces courbes comportait les sièges suffisants et les portes ???? La masse à vide réelle est très importante à connaître (remarque : elle était de 850 kg). La photo n’avait peut-être pas de rapport avec le diagramme) . Les hélicos militaires
ne sont pas forcément de bons exemples (pas de sièges). Cordialement, CP »
J’en profitai pour lui demander ce que l’on entendait par « effet de sol ». Il me répondit : « Quand le rotor est à une altitude inférieure à environ 3 fois son diamètre, l'écoulement de l'air est modifié très fortement par la présence du sol. Loin du sol, l'écoulement est vertical, près du sol, il est horizontal et radial, c'est bien plus complexe et turbulent. Dans ces conditions, la portance du rotor est en général un peu plus grande près du sol qu'en air libre (mais pas toujours, selon la végétation à proximité).En outre la portance d'un rotor est plus grande en translation qu'en vol stationnaire. C'est pourquoi on ne se sort vivant d'une panne de moteur que si l'hélico possède une vitesse horizontale suffisante. C'est la raison pour laquelle on met en translation la machine aussitôt après le décollage. Le pire c'est la descente lente en vol stationnaire, très dangereux si le rotor en vient à re-brasser son propre flux par un vortex, car la portance devient brusquement très faible. C'est la chute irrémédiable. Il arrive qu'en montagne, un hélico peut juste décoller mais pas grimper en vol stationnaire. Il suffit alors de le faire avancer pour pouvoir monter plus facilement. L'aérodynamique d'un rotor d'hélicoptère est très complexe et changeante. Ces phénomènes sont liés à la turbulence, et il y a parfois des surprises quand il y a du vent et des obstacles qui modifient la trajectoire du vent. L'hélicoptère est une machine instable en vol stationnaire. C'est l'engin volant qui a le record absolu d'accidents. Et si en plus vous l'utilisez pour aller pisser derrière une haie .... CP »
Pour André Morel, la distance à laquelle on peut poser un hélicoptère près d’un rideau d’arbre dépend de la dextérité du pilote. Il n’est, pour sa part, pas partisan de la prise de vitesse en spiralant pendant la montée si l'espace disponible est restreint. Il confirme néanmoins que plus la vitesse de translation est élevée moins l'effort demandé au rotor anticouple est important, le fuselage lui même et surtout la dérive qui se trouve pratiquement à l 'arrière des hélico près du rotor de queue ayant son efficacité qui croît avec la vitesse.
Suite à un nouvel envoi à C. Poher (voir document 4 - intitulé charge marchande - distance -consommation ), ce dernier me répond: « Le nouveau diagramme dit plusieurs choses : on n'a pas le droit de voler à 1500 kg avec moins de 100 kg de charge utile, sans doute pour des questions de centrage de la machine. Il n'est pas question de 1600 kg, sauf utilisation de combat, donc il ne faut pas considérer cette option de 1600 kg à Cussac. On était en temps de paix, où la vie a un prix. Masse à vide avec lubrifiant = 860 kg et 940 kg avec un pilote de 80 kg. Vitesse maximale au niveau de la mer = 170 km/h soit distance parcourue en 10 secondes = 470 mètres, sans compter le décollage et l'accélération c'est-à-dire 6 fois la distance des témoins à la sphère au sol. En réalité la vitesse décroît avec l'altitude comme la portance. Je ne comprends pas pourquoi vous vous acharnez sur cette histoire d'hélico qui ne tient pas debout. Par rapport aux 625 kg précédents, on a ici 560 kg pour la distance nulle. Soit 65 kg d'écart. Cela me semble trop faible pour un pilote et son siège, donc je suppose qu'il s'agit de l'équipement ajouté pour pouvoir embarquer 4 passagers et pour naviguer … Quant aux 80 kg par personne, ce sont des gringalets sans équipement et en pantoufles. Il faut compter 100 kg. Le diagramme est établi pour un aller simple. A l'arrivée le réservoir est à sec et vous ne pouvez pas redécoller. »
Finalement, je décidai de prendre comme base (masse à vide) 850 kg et de garder le poids passager à 80 kg. (Sud Aviation prenait plutôt 85 kg).
version civile
Je devais ajouter pour 5 personnes (5 x 80 kg = 400 kg) :
. un siège co-pilote = 6,5 kg
. une banquette arrière repliable, type passagers = 14,5 kg
. l’installation de chauffage = 6 kg (indispensable pour le confort de touristes en altitude)
. une radio = 15 kg (au minimum et naturellement indispensable)
Le poids à vide avec ce nouvel équipement :
850 + 6,5 + 14,5 + 6 + 15 = 892 kg. Arrondissons à 890 kg pour « coller » avec C. Poher
|
|
Altitude |
A Cussac |
|
|
normale |
(- 11 %) |
|
Masse totale au décollage |
1500 |
1335 |
|
Masse à vide (kg) |
890 |
890 |
|
Capacité maximale d'emport (kg) = masse totale - masse à vide |
610 |
445 |
|
K = Poids de kérosène = Capacité max – charge (5 personnes) |
210 |
45 |
|
Distance maximum parcouru = K / 0,8 (arrondis >) |
263 Km |
57 Km |
Je ne trouvais pas les mêmes chiffres qu’Alain Delmon. Une Alouette (1 500 Kg) ne pouvait atteindre qu’Aurillac, pourtant, elle ne semblait pas en prendre la direction…
Mende
L’aérodrome est situé sur un plateau calcaire à 1 017 m (ou 1 025m, les sources divergent) d’altitude, le Causse de Mende. C’est le plus élevé de France, bien qu’il ne soit pas classé altiport (aérodrome de montagne). Compte tenu du relief, le plan d’approche pour un atterrissage est plus important que sur les autres aéroports (7 % au lieu de 5 %). L’aérologie parfois turbulente cesse au niveau de la piste. A noter que la Grande Vadrouille (1966), le chef d’œuvre cinématographique de Gérard Oury avec Louis de Funès et Bourvil a en partie été tourné sur cet aérodrome. La scène finale où les deux héros échappent aux Allemands à bord de planeurs a été tournée à Mende.
J’ai pu avoir quelques informations complémentaire par le Conseiller Études et Projets de C.C.I. de la Lozère. Il me répond : « L’activité de l’aérodrome de Mende - Brenoux
a commencé dans les années 1933 - 1938 par la pratique du vol à voile sur une piste en herbe, où les planeurs prenaient leur envol à l’aide d’un treuil, de fabrication artisanale, dérivé d’un gros moteur d’automobile. Cette activité fut stoppée en 1951, une forte chute de neige ayant provoqué la destruction du hangar qui abritait les planeurs. La couche de neige avait atteint alors plus d’un mètre d’épaisseur, tous les planeurs furent détruits. Ce n’est que vers 1958 que l’activité reprit par la pratique du vol à moteur grâce aux constructeurs amateurs, qui fabriquèrent les premiers Jodels et ensuite créèrent l’Aéro-club de la Lozère
1960
à 1965 : acquisitions foncières et
premiers travaux pour piste engazonnée.
3
janvier 1968 : signature de la
convention d’aménagement et d’exploitation
avec l’Etat.
1965
à 1975
: exécution de travaux lourds, réalisation de
la première piste (1970) qui a été améliorée
en 1974 et 1988.
1976
à 1979 : fonctionnement de la ligne commerciale.
Récupération d’une jeep pour la sécurité
incendie.
1988 : réfection de la piste et du
balisage de jour.
1990 : station météorologique
automatique.
1991 à 1992 : équipement de radionavigation, balisage de nuit et phares de danger; station d’ avitaillement en JET A1. » ( avitailler = ravitailler un avion en carburant)
M. Jean-Louis J, Agent AFIS à l’Aérodrome Mende-Brenoux ajoute : « Nous pouvons en déduire qu'en 1967 il n'était pas possible d'avitailler les hélicoptères, mais le carburant aurait pu être emmené dans des fûts. ». J’ignore si un hélicoptère civil pouvait s’y ravitailler en 1967 mais en raison de l’altitude à Mende, on devait - comme à Cussac - réduire la masse maximale de décollage.
Rentabilité
André Morel précisait dans son ouvrage (page 123) : « Ce qui surprend tout d’abord le pilote qui vient de l’armée lorsqu’il se reconvertit dans l’exploitation civile, c’est qu’il faut se battre en permanence contre le chronomètre ! Le militaire qui se pose en montagne prend son temps, procède à la reconnaissance de la zone d’atterrissage, effectue plusieurs passages pour déterminer la force et la direction du vent, lance éventuellement un fumigène. Dans la pratique, les vols civils, qui sont payés au départ pour un temps de vol très précis et calculé au plus juste, doivent être exécutés dans ce laps de temps, toute durée supplémentaire entraînant un manque à gagner insupportable pour la rentabilité de l’exploitation. »
Ceci explique que par exemple, pour aller de Clermont-Ferrand à Aurillac, le plus court chemin ne passe pas par Cussac (voir tracé pointillé sur graphique précédent). J’ai donc réalisé un tableau établissant les distances entre les différents aérodromes avec un passage à Cussac. J’ai mis en gras les résultats correspondant aux trajets les plus directs. J’ai exclu les directions de disparition (voir carte au chapitre V) ne coïncidant pas avec la déclaration des témoins (exemple : Rodez). L’aller-retour est aussi exclu car - d’après moi - illogique (sauf dans le cas de la Sécurité Civile mais cette hypothèse a été écartée précédemment).
|
Via Cussac |
Aurillac |
Brive-la-gaillarde |
Chaspuzac |
Clermont-Ferrand |
Egletons |
Issoire |
Limoges |
Mende |
Montignac |
Rodez |
St Etienne Bouthéon |
Ussel |
|
Aurillac |
80 |
155 |
107 |
131 |
123 |
105 |
207 |
112 |
185 |
112 |
164 |
113 |
|
Brive-la -gaillarde |
155 |
230 |
182 |
206 |
198 |
180 |
282 |
187 |
260 |
187 |
239 |
188 |
|
Chaspuzac |
107 |
182 |
134 |
158 |
150 |
132 |
234 |
139 |
212 |
139 |
191 |
140 |
|
Clermont-Ferrand |
131 |
206 |
158 |
182 |
174 |
156 |
258 |
163 |
236 |
163 |
215 |
164 |
|
Egletons |
123 |
198 |
150 |
174 |
166 |
148 |
250 |
155 |
228 |
155 |
207 |
156 |
|
Issoire |
105 |
180 |
132 |
156 |
148 |
130 |
232 |
137 |
210 |
137 |
189 |
138 |
|
Limoges |
207 |
282 |
234 |
258 |
250 |
232 |
334 |
239 |
312 |
239 |
291 |
240 |
|
Mende |
112 |
187 |
139 |
163 |
155 |
137 |
239 |
144 |
217 |
144 |
196 |
145 |
|
Montignac |
185 |
260 |
212 |
236 |
228 |
210 |
312 |
217 |
290 |
217 |
269 |
218 |
|
Rodez |
112 |
187 |
139 |
163 |
155 |
137 |
239 |
144 |
217 |
144 |
196 |
145 |
|
St Etienne Bouthéon |
164 |
239 |
191 |
215 |
207 |
189 |
291 |
196 |
269 |
196 |
248 |
197 |
|
Ussel |
113 |
188 |
140 |
164 |
156 |
138 |
240 |
145 |
218 |
145 |
197 |
146 |
Précisions :
=> Chaspuzac : le responsable de la tour de contrôle m’a indiqué que l’aéroport « Le Puy Loudes » existe depuis 1937. La mairie m’a répondu 1928. Probablement sa plus vieille utilisation.
=> Egletons : l’aéroclub (1956) a été créé avant l’aérodrome (1961). Ravitaillement impossible (voir « Gendarmerie »)
=> Saint-Etienne-Montbrison : sa construction s’est étendue sur trois ans, de 1965 à 1968. Pouvait-il déjà accueillir (et ravitailler en carburant) un hélicoptère en 1967 ?
=> Ussel : d’après le président de l’aéroclub, l’aérodrome existe depuis 1930 (et l’aéroclub depuis 1947)
Ces aérodromes pouvaient-ils ravitailler un hélicoptère en carburant en 1967 ?
Version militaire
Il existait une différence des poids maximum autorisés au décollage entre la version civile et la version militaire de l’Alouette. En effet, le règlement de l’Aéronautique Militaire est souvent moins strict que celui de l’Aéronautique Civile. C. Poher avait d’ailleurs parlé de 1 600 kg. Pour ce qui est de la masse volumétrique du kérosène, les archives de l’A.L.A.T. que j’ai consultées parlent de 1,1 litre/ km (0,88). 0,88 / 1,1 = 0,8 => le résultat est identique aux informations données par A. Delmon. La seule différence concernant l’équipement supplémentaire est la banquette arrière repliable. Le « type troupe » pèse 11,5 kg.
Le poids à vide avec ce nouvel équipement => 850 + 6,5 + 11,5 + 6 + 15 = 889 kg. Arrondissons à 890 kg pour correspondre au chiffre de C. Poher
|
|
Altitude |
A Cussac |
|
|
normale |
(- 11 %) |
|
Masse totale au décollage |
1600 |
1424 |
|
Masse à vide (kg) |
890 |
890 |
|
Capacité maximale d'emport (kg) = masse totale - masse à vide |
710 |
534 |
|
K = Poids de kérosène = Capacité max – charge utile (5 personnes) |
310 |
134 |
|
Distance maximum pouvant être parcouru = K / 0,8 (arrondis >) |
388 |
168 |
Je n’ai pas mis toutes les options possibles (armements, etc.). Je n’ai pas non plus équipé le personnel militaires en conséquence. Les archives de l’ALAT précisent par exemple: « 3 hommes avec équipements (300 kg) ». Les militaires auraient donc pris 480 kg au lieu de 425 si le pilote n’avait pas d’équipement. C. Poher avait apparemment raison de dire « Quant aux 80 kg par personne, ce sont des gringalets sans équipement et en pantoufles. Il faut compter 100 kg. ». J’ajoute que de Marignane à Limoges, il y a au moins 410 km…
B/ Le Bell 47 J
C.
Poher précise sur son site internet : « Ainsi,
le Bell 47 type G2, immatriculé F.BUIG, en 1975, possédait
un moteur Lycoming de 265 CV, un rotor de 11m32 de diamètre
et une portance maximale, à pleine puissance, de 10791
Newton au niveau de la mer. Sa vitesse de croisière, au
niveau de la mer, était de 70 nœuds (130 km/h) et sa
Vne était de 87 nœuds (160 km/h). Sa masse à
vide était de 790 kg. Au niveau de la mer, le rotor de cet
hélicoptère, à pleine puissance, pouvait
donc soulever au maximum 1100 kg tout compris. A l’altitude
de Cussac, cette masse maximale de décollage serait
réduite de 11% à cause de la densité
atmosphérique de l’air à cette altitude. Soit
une masse maximum "décollable" de 979 Kg à
Cussac. La masse à vide de cette machine étant de
790 kg, la charge totale embarquable pour un décollage de
Cussac est donc égale à : 979 - 790 = 189 kg.
Soit
2 hommes de 80 kg chacun (160 kg) et 29 kg d’essence. Au
delà, le décollage serait impossible, un fait que
tous les pilotes et tous les ingénieurs de l’aéronautique
savent parfaitement, sans avoir à faire le calcul à
chaque fois. Le pilote dispose d’abaques. La consommation
du moteur Lycoming du Bell 47, à pleine puissance, est de
l’ordre de 75 litres par heure (59 kg), donc l’autonomie
du Bell 47
décollant
de Cussac avec deux hommes à bord ne serait que de 25
minutes, soit 54 km avant la panne sèche. Par conséquent,
un Bell 47 ne saurait embarquer 4 personnes, y compris au niveau
de la mer, et, décollant de Cussac avec seulement deux
personnes à bord, ne saurait aller jusqu’à
Limoges comme le croit naïvement un critique sur internet. »
Malheureusement C. Poher avait oublié le Bell 47-J, une version 4 places. André Morel qui l’a utilisé précise dans son livre Carnets de route (page129) : «…Cet appareil a la même motorisation que le G2 mais, doté d’une cabine à quatre places, il est beaucoup plus lourd et se révèle en montagne comme dangereusement sous-motorisé… » . Il ajoute (page 141) : « Le 11 juillet, je prends livraison, sans grand enthousiasme, à Issy-les-Moulineaux du seul appareil disponible le Bell 47 J F-BGKJ, le Kilo Juliet dont les essais à l’Alpe d’Huez m’avaient révélé les piètres performances en montagne… ». Il essaya quelque temps plus tard (page 180) un autre Bell 47 J qui était cette fois-ci équipé d’un rotor métallique (le précédent était en bois) : « …Il est cependant toujours motorisé avec le Lycoming VO 435 de 260 chevaux du G2 ce qui est nettement insuffisant …». André Morel me précisa : « Le Bell 47 J était un hélicoptère avec lequel j’ai volé en Algérie, au Sahara, en Lybie et beaucoup en France, qui présentait le défaut d’être très nettement sous-motorisé et qui demandait de la part des pilotes une très grande dextérité … Je précise que j’ai beaucoup apprécié le Bell 47 J qui était pour le pilote un appareil d’un grand confort et très agréable à piloter… quand on savait le maîtriser. »
M. Dominique Roosens - pompier de métier - passionné d’hélicoptère me donna la liste (26 pages avec l’historique) des Bell et Agusta Bell 47 sous le registre F. Il me précisa: « En 1967 : la Protection Civile 1(47J2) à Bordeaux, Gyrafrance 2 (47J), Gyrafrique 1 (47J). Actuellement, l’un d’entre eux est à Castellane chez AirVerdon (M. Guichard) et un autre à ex Aéro 34 en cours de restauration. ». C. Malcros précisait : « L’A.L.A.T. a reçu 3 Bell 47D, 43 Bell 47G-1, 53 Bell 47G-2 »
J’ai retrouvé l’un des hélicoptères qu’André Morel avait pilotés (Bell 47J n°série 1427 immatriculation : F-BGKJ). Il était aussi sur la base de la D.G.A.C. Il avait eu 8 propriétaires différents sur 20 ans. Les commentaires d’André Morel semblent confirmer que le Bell 47 J n’était pas très adapté à la montagne (et au franchissement du Plomb du Cantal). La série J n’eu que très peu d’exemplaires (Agusta a construit 123 47 J-2/J-3). Les modèles à 300 CV n’étaient pas encore disponibles en 1967 comme le signale Science et Vie Aviation 67 (page 115) et Jane’s all the World’s
Aircraft 1966-1967 (page 195). Le modèle G2 donné par C. Poher semble même plus puissant de 5 CV. J’ai néanmoins gardé la même consommation pour effectuer les calculs (voir tableau).
Masse à vide : 833 kg ; Masse maxi au décollage : 1 338 kg ; Vitesse Maxi : 169 km/h
|
1 passager = 80 kg (moyenne) |
A Cussac |
< Bell 47-J > |
A Cussac |
|
|
(2 passagers) |
(4 passagers) |
(4 passagers) |
|
|
- les 11% |
|
- les 11% |
|
Poids maxi au décollage |
979 |
1 338 |
1 190,82 |
|
Poids à vide (Kg) |
790 |
833 |
833 |
|
Capacité maximale d'emport (kg) = Poids Max - Poids à vide |
189 |
505 |
357,82 |
|
K = Poids de kérosène = Cap. Max. d'emport - poids passagers |
29 |
185 |
38 |
|
C = Consommation en litres (arrondis) = K / 0,8 |
36 |
231 |
47 |
|
T (arrondis) = Durée du vol (mn) = (C x 60) / 75 |
29 |
185 |
38 |
|
Distance maximum parcourue (km) = (Vitesse max. x T) / 60 |
63 |
521 |
107 |
On note des petites différences (25mn et 54 km) avec C. Poher., peut être dûes aux arrondis de calcul. Le tableau me permet de réduire les possibilités (voir dessin page suivante). J’élimine aussi l’aérodrome de Mende. En effet, il faut lui appliquer les mêmes 11 % qu’à Cussac. Si un hélicoptère prend la direction de Cussac en venant de Mende, il ne peut atteindre aucun aérodrome avec une autonomie limitée à 107 Km. Aucune trajectoire directe, conforme à la direction indiquée par les témoins, n’explique un passage par Cussac. Seule l’hypothèse « tourisme » (trajet indirect) pourrait l’expliquer mais elle est hautement improbable comme nous l’avons vu précédemment. Si l’on décolle des aérodromes restants pour atteindre le Plomb du Cantal, il est inutile de passer par Cussac. Comme l’a signalé André Morel, toute durée supplémentaire entraîne un manque à gagner.

J’ai montré mes tableaux à C. Poher. Il m’a répondu : « Vos calculs me semblent corrects… pour le Bell 47 J, il ne pouvait pas se poser à Cussac, parce que son plafond en vol stationnaire hors effet de sol est de 945 mètres d'altitude en atmosphère standard. C'est écrit dans la notice en anglais (remarque : que je lui avais envoyée) :"Hovering ceiling out of ground effect = 3100 feet (1 foot = 0,305 m). On ne pose pas un hélicoptère en translation. Il est donc inutile de faire des calculs pour cette machine à Cussac. Or, la température à Cussac, ce jour là, était supérieure à celle de l'atmosphère standard, par conséquent la limite de vol stationnaire du Bell 47 J était inférieure à 945 m ce jour là. Mais je n'ai vraiment pas assez de temps pour m'éterniser sur les éventuels hélicoptères de Cussac. Désolé … ».
Il ne semblait pas connaître le 47 J-3B1(270 cv), de chez Agusta (Italie) et non Bell, dont le plafond stationnaire hors effet de sol était de 1 534 m. Je n’en oubliais pas pour autant que la queue tubulaire enveloppée de métal du Bell 47-J était très largement visible lorsqu’il était en vol. Cet hélicoptère faisait même plutôt penser à un « cornet de glace » couché qu’à une sphère.
Je décidai néanmoins de demander quelques précisions à M. Roosens sur le J3 que j’avais repéré dans ses documents. Il me précisa qu’a l’origine c’était un Bell G2 n°1464 F-BHMG utilisé par la Protection Civile. Il avait eu un accident en février 1960. Il fut envoyé par la suite en Italie pour être transformé en 47 J2. Il prit l’immatriculation n°2006/1464 (1464, son n° d’origine et 2006, son n° sur chaîne Agusta). Le 10/10/61, il fut affecté à Quimper. Il changea d’immatriculation en 1962 et devint F-ZBAH. Suite à un mauvais atterrissage le 14 mai, il fut reconstruit. Il changea de base et prit la route de Bordeaux le 23/06/63. Suite à de nouveaux problèmes, il fut convoyé chez Agusta pour transformation le 15/09/1963 et revint le 16/04/64 à Bordeaux en J3. Pendant l’été 1967, suite à une panne (moteur HS) sur la plage de La Canau (Bordeaux), il retourna sur remorque à Issy. Il rentra à sa base de Bordeaux en janvier 1968. Une panne moteur avec posé auto-rotation le 4/02/68 occasionna un retour sur Paris en remorque. Il perdit son affectation à Bordeaux le 24/01/71. Il traîna pendant un temps dans le fond d’un hangar puis retourna sur Paris pour être mis aux Domaines (réforme) en octobre 1972 . Gyrafrance l’acheta l’année suivante (nouvelle immatriculation : F-BTOH). Son propriétaire suivant fut Hélipub (1976). Malheureusement, il fut détruit dans un accident à la Rochelle le 28/03/77 (mécanicien gravement brûlé). Si l’appareil avait été transformé en J3 en 1967, le trajet Italie-Bordeaux passait bien par le Cantal. Malheureusement, c’était en 1964. Par contre, pour se rendre à Issy en partant de Bordeaux, on ne passe pas par le Cantal.
Concernant les différentes versions de J, M. Roosens ajouta : « Effectivement il y a eu un J3 turbo pour les Alpes, mais seuls les services italiens en ont eu. (j’en ai aussi trouvé dans la Marine Italienne et en Autriche…). A ma connaissance il n'y a eu qu'un modèle 47 J3 en France et c'est bien celui de la Protection Civile, tous les autres n'étaient que J, même ceux en Algérie. Gyrafrance l'a utilisé en vol touristique dans les Pyrénées pour monter à 3 000 mètres, autrement ils ont eu des 47 G3 turbo, non certifiés en France…G3B-1 (3 places) et J3B-1 avaient chacun leur fuselage mais le même moteur Lycoming…». Sa déclaration sur le J3 semblait confirmée par le livre d’André Morel. A la page 247 on pouvait lire : « Cette année (1973) c’est un Bell 47 J3 qui m’est affecté … il est équipé d’un moteur lycoming qui développe 300 CV au lieu des 260 CV des autres J et G2. Les 40 CV supplémentaires sont les bienvenus et mes vols en altitude s’en trouvent considérablement facilités ».


4 à 6 tours ?
A. Delmon avait le sentiment qu'en pratique les décollages ne se font jamais de manière hélicoïdale sur 5 ou 6 tours (pour 6 tours voir l’hebdo de Toulouse), mais de manière plus simple et selon certaines procédures. D’après lui, il n’y a que pour un baptême de l'air que le pilote va impressionner ses passagers en faisant 2 ou 3 tours sur lui avant de s'élancer enfin dans une direction donnée. Il me demanda de le mettre en contact avec le pilote André Morel afin de lui poser des questions à ce sujet. Il tenait aussi à lui demander si le "spin", la rotation, se fait "sur l'axe rotor" (auquel cas les témoins n'ont pu voir ni décrire aucun cercle décrit par la "boule", de plus la queue était censée être restée « noyée » dans les reflets du soleil ?), ou bien si elle se fait autour d'un axe vertical fictif, avec des cercles de quelques mètres de diamètre (auquel cas ce serait conforme avec les témoignages ... sauf pour la fréquence de spin, qui ne peut clairement pas être > = 1 Hz, en raison des
forces
centrifuges).
Question d’A. Delmon : « J'ai le sentiment qu'en pratique les décollages ne se font jamais de manière hélicoidale sur 5 ou 6 tours, mais de manière plus simple selon des procédures que j'ai pu trouver sur le web => Références, extraites d’un manuel de pilotage canadien :
Procédure normale : nez contre le vent, montée verticale en vol stationnaire (3 à 5 pieds) puis translation http://www.transportcanada.com/AviationCivile/generale/formation/Avion/Pubs/TP9982/Exercice9.htm
Procédures spécifiques : aucune qui implique une « toupie aérienne » http://www.transportcanada.com/AviationCivile/generale/Formation/Avion/Pubs/TP9982/Exercice24.htm
Il n'y aurait à mon avis que pour un baptême de l'air que le pilote va éventuellement vouloir impressionner ses passagers en faisant 2 ou 3 tours sur lui avant de s'élancer enfin dans une direction donnée. Que pensez vous de cela M. Morel ? Ai-je tort ? Quelle est la procédure normale ? »
Réponse d’André Morel: « En ce qui concerne les décollages des hélicoptères il est certain que si une panne du groupe moto-propulseur, qu’il s’agisse d’un moteur à piston ou d’une turbine, survient pendant que l’appareil est à vitesse sol nulle et à faible hauteur le résultat est catastrophique et le pilote, quelle que soit son expérience, n’a aucune possibilité d’amortir la chute. C’est la raison pour laquelle dès le décollage il faut avant toute autre chose prendre une vitesse de sécurité qui permettra en cas de panne, même près du sol, d’effectuer ce que nous appelons un flair qui arrête la translation horizontale, sans diminuer le régime du rotor qui dans ce cas a même tendance à augmenter légèrement, ce qui, en utilisant l’énergie cinétique de celui-ci, permet de poser l’hélico en douceur. Si le pilote tient à impressionner son passager( ce que je trouve sans intérêt) il lui suffit après avoir effectué un décollage classique, de prendre suffisamment de hauteur pour faire, sans courir aucun risque, une montée verticale en spirale à vitesse nulle ou tout exercice qu’il jugera nécessaire. » (Note perso : le « spin » en absence de cercles de quelques mètres de diamètres est peu probable car il n’y a pas de repères visible à cette distance sur une sphère)
Question : « D'autre part pouvez-vous me dire si cette rotation éventuelle de la cabine (ce "spin", comme dit notre contradicteur), se fait "sur l'axe rotor" de l'hélicoptère, ou bien autour d'un axe vertical fictif, avec des cercles de quelques mètres de diamètre (comme l'affirment les témoins) ? »
Réponse : « Pour répondre à votre deuxième question il est certes très possible de décoller en prenant de la vitesse en spiralant pendant la translation mais dans ce cas on court les mêmes risques que précédemment c'est-à-dire de ne pouvoir intervenir pour limiter les dégâts en cas de panne. Croyez moi, les pilotes expérimentés ne cherchent pas à épater la galerie par des manœuvres ridicules qui en aucun cas ne prouvent la maîtrise de celui qui les exécute. L’hélicoptère offre tellement de possibilité qu’il existe, sans prendre aucun risque , beaucoup de façons d’en montrer quelques unes à son passager…. »
Question : « Il me semble que dans ce dernier cas, la fréquence de spin/rotation ne pourrait clairement pas être >= 1 HZ (1 tour par seconde), en raison des forces centrifuges énormes que cela générerait... Qu'en pensez-vous ? »
Réponse: « Quant à votre 3ème question concernant la rotation verticale de 1 tour par seconde je vous laisse le soin d’essayer vous-même de pivoter sur place à cette vitesse en pensant à ce que le pilote, qui doit en même temps agir sur le cyclique, le collectif et les pédales qui gèrent le pas de l’anti-couple, aurait à faire pendant la rotation… Bien cordialement. André Morel »
Il faut ajouter que si la « machine » est un hélicoptère, il ne présentait qu’épisodiquement sa verrière au soleil.
Le G.E.P.A.N. a estimé le temps écoulé entre l’instant où les témoins observent la machine, l’instant où elle décolle et celui où elle disparaît. La durée d'observation des êtres, qui a précédé l'observation de la boule, n'est donc pas ici prise en compte.
T1 = instant ou la machine décolle T2 = instant ou elle disparaît
|
|
François |
|
|
Anne-Marie |
|
|
T1 |
T2 |
T1-T2 |
T1 |
T2 |
T1-T2 |
|
13 |
21 |
8 |
13 |
25 |
12 |
|
15 |
29 |
14 |
15 |
31 |
16 |
|
|
|
|
17 |
35 |
18 |
A. Delmon précise : « Il y a donc recouvrement sur 5 secondes (25 à 29 s)…»
En prenant la fourchette haute, il s’écoule au plus 18 secondes entre le décollage et la disparition.
Il a donc fallu approximativement 3 ou 5 secondes (18/4 ou 18/6) pour que la machine fasse un tour sur elle-même. Probablement moins puisque je n’ai pas déduit le temps qu’il lui fallait pour s’éloigner. De plus, si les (ou l’un des) témoins sont éblouis, ils peuvent avoir eu la fausse impression que la phase d’éloignement durait plus longuement qu’en réalité. En effet, une tache lumineuse persiste le plus souvent sur la rétine. François indique d’ailleurs une « luminosité au moins égale à celle du soleil à midi ». Imaginons néanmoins que la machine n’est plus observable après s’être élevée dans le ciel. Cela nous fait néanmoins 6 tours en 18 secondes. Si le diamètre s’accroît au fur et à mesure qu’elle s’élève, cela devient encore plus acrobatique. Une véritable prouesse technique pour un hélicoptère, même aujourd’hui. Cela ne me semble pas très sérieux… et à vous ?
Niveau sonore
Lors du projet de loi de finances pour 1999, il a été signalé que l'Alouette III n'était plus conforme à la réglementation sur la multimotorisation et les "niveaux sonores ".Seul son statut d'aéronef d'état lui permettait - à l'époque et peut-être encore maintenant, à vérifier - d'échapper à cette réglementation (25) . En 2006, la question était toujours d’actualité. En effet, le 5 octobre de la même année, la DGAC et l’Union Française de l’Hélicoptère (UFH) organisaient un forum Hélicoptère. En France, le secteur hélicoptère c’est 1 500 machines, dont 650 militaires et 450 en exploitation commerciale. Gérard David, pilote d’hélicoptère et président de l’UFH indiquait qu’« on ne peut pas nier que l’hélicoptère est l’ami de l’homme ! Pour autant, reconnaissait-il, l’hélicoptère reste une machine bruyante. » Dominique Perben, ministre des Transports, ajoutait quant à lui qu’« il reste beaucoup à faire, notamment pour réduire le bruit à la source… Je suis pourtant confiant : le gain de 7 dB – tel que le préconise l’OACI – est un objectif tout à fait réalisable pour la profession. » Ajoutons que l’année 2007 est l’année du centième anniversaire du premier vol en hélicoptère qui eut lieu le 13 novembre 1907, près de Lisieux.
Un document Eurocopter intitulé « Hélicoptères : des progrès significatifs dans la réduction des nuisances sonores » nous rappelle que la puissance sonore émise par les hélicoptères est réduite de plus de moitié (26) par rapport celle de la génération des années 80. Les constructeurs ont intégré la nécessité de diminuer les nuisances sonores et les hélicoptères actuels se trouvent nettement en dessous des normes de l’OACI. L'effort a essentiellement porté sur de nouvelles technologies (pales plus silencieuses, etc.) parfois développées en association avec des organismes de recherche comme l’ONERA en France.
Extraits : « Pour une même dose d'émergence de bruit journalière en zone résidentielle, fixée par la loi à 55 dBA (Leq), un hélicoptère de la génération actuelle pourrait déposer cent fois plus de passagers que son homologue conçu vers 1960 - 1970. Des mesures réalisées au 5ème étage d'un immeuble en zone urbaine montrent la réalité de la "hiérarchie" des bruits dans ce type d'environnement sonore. Les hélicoptères mentionnés dans le graphe suivant étaient en survol horizontal à 300 mètres de hauteur et à 200 km/h. À l'évidence, l'idée que l'hélicoptère est un engin très bruyant a pour origine l'image sonore des appareils trentenaires de type Alouette, dont certains volent encore. » On ne peut donc se baser sur le bruit d’un hélicoptère passant dans le ciel de Cussac en 2004 pour en déduire ce que les témoins auraient pu percevoir en 1967.
« Le fait que l'hélicoptère EC 130 soit le successeur de l'Alouette III montre l'importance des progrès accomplis en matière de réduction de bruit. Aujourd'hui, les hélicoptères récents peuvent générer moins de bruit que d'autres moyens de transport acceptés par la population. Le bruit d'un hélicoptère reste proportionnel à sa masse, une certaine "hiérarchie" entre eux est donc normal. Mais, plus il est gros plus l'hélicoptère transporte de passagers, et le graphe visible ci-dessous démontre que le rapport "quantité de bruit par passager transporté" se révèle aussi excellent pour l'hélicoptère moderne… À ces améliorations s'ajoutent les "procédures à moindre bruit". Comme un véhicule routier émet plus ou moins de bruit en accélération, selon que le conducteur monte plus ou moins en régime moteur, un pilote d'hélicoptère peut être amené à respecter des consignes édictées afin de minimiser le niveau de bruit pour les riverains. Celles-ci concernent essentiellement la pente et la vitesse, au décollage et à l'atterrissage. Ces éléments sont fournis par les constructeurs. La surface des empreintes sonores au sol montre leur bien fondé. »

La remarque la plus intéressante concernant le bruit a été faite par Alain Delmon : « Le bruit d'un hélicoptère comporte deux composantes : le bruit de son moteur (dans la cas d'une turbine il s'agit effectivement d'un sifflement), et le bruit de son rotor dont les pales heurtent violemment l'air. Cette seconde composante n'a rien à voir avec un sifflement, il s'agit plutôt d'un ronflement saccadé très caractéristique, qui est justement typique d'un hélicoptère, et qui surpasse rapidement en intensité la première composante (le bruit du moteur). Anecdotiquement, les onomatopées classiques associées au bruit d’un hélicoptère sont du type « marteau piqueur » : « flap-flap-flap », « tac-tac-tac » Le fait que seul un sifflement soit signalé est donc incompatible avec un hélicoptère ». J’ajoute que c’est aussi pour cela qu’il ne semble pas y avoir d’effets visibles sur l’environnement végétal…


=> Un tracteur :
E. Maillot a émis l’hypothèse qu’un tracteur passant sur la route aurait pu couvrir malgré tout le bruit de l’hélicoptère. J’ai demandé l’avis de M. André Morel (pilote d’hélicoptère en 1967) qui me répond : « Pour ce qui est du bruit du tracteur il n'est possible que s'il est à proximité immédiate des spectateurs dont il peut couvrir le bruit du moteur ou de la turbine quelques secondes tout au plus, d'autant plus que les tracteurs sont tous équipés de silencieux. ».Concernant l’équipement en silencieux des tracteurs en 1967, je crains que M. Morel ne se trompe (mais on ne peut être spécialisé dans toutes les machines). On peut estimer le bruit d’un tracteur passant sur la route aux alentours de 100 dB. Idem pour un hélicoptère atterrissant à 80-90 mètres. N’oublions pas néanmoins que les tracteurs de l’époque étaient aussi moins puissants (donc moins bruyants…). C. Poher signale quant à lui qu’un hélicoptère en descente, à plus de 1 042 m d’altitude, est très bruyant, car la densité plus faible de l’air (- 11%) impose une incidence des pales beaucoup plus importante qu’au niveau de la mer, d’où un flapping considérable. En résumé, un son qui s’entend à des kilomètres à la ronde… et personne, je dis bien personne ne signale avoir vu (ni entendu) passer un hélicoptère (voir La Montagne du 1/9/67: « plusieurs voisins travaillaient dans les champs… ils n’ont rien entendu »).
M. VX, quant à lui, a proposé aux enfants de les emmener au retour, il venait donc du village. Il n’est pas passé près d’eux à l’aller. Mais imaginons que l’on sous-estime le bruit du tracteur. Un pilote d’hélicoptère, peu familier de Cussac, ferait de toute façon un premier passage au-dessus des prés pour repérer l’endroit le plus approprié pour se poser. Il se ferait donc entendre plus longtemps. Le bruit vient du ciel et le muret (à peine 50 cm de haut) ne filtre quasiment rien. Si par contre il connaît le secteur (instructeur…), les habitants (et les enfants) ont l’habitude de le voir. Donc pas d’effet de surprise. Les enfants ne parlent que d’une vingtaine de voitures qui seraient passées dans la matinée. Ils verront même passer un membre de leur famille qui les saluera à 10h. Ils voient (ou entendent) des voitures mais aucune allusion au passage d’un tracteur en dehors de celui croisé sur la route en rentrant après l’observation (?). Des voitures plus rapides et moins bruyantes que des tracteurs. Les enfants ne disent pas non plus: « M. X venait juste de passer… quelques minutes plutôt il aurait pu voir…».
M. Morel a raison sur un point. Il aurait fallu un énorme concours de circonstances pour qu’un tracteur passe juste à ce moment-là. On a souvent l’impression qu’un tracteur est très lent lorsqu’on doit en suivre un - en voiture - sur la route. Mais cela reste une impression. Le passage d’un tracteur sur la route, derrière le muret, n’aurait duré, en tenant compte de son arrivée, qu’un très bref instant. Il n’y a même pas de côte très dure pour le ralentir un peu. Le vacarme d’un hélicoptère aurait duré de toute façon plus longtemps que celui d’un tracteur passant sur la route au même moment. Le bruit émis par la machine n’a rien de comparable à celui du décollage (phase bruyante pour un hélicoptère) et pourtant il ne passe aucun tracteur pouvant en atténuer le bruit. Aucun conducteur de tracteur n’a signalé avoir vu un hélicoptère (une observation peu banale et tout se sait assez vite dans un petit village). Son conducteur ne pouvait pas ne pas l’avoir aperçu du haut de son tracteur…
. L’avis de deux experts sur le rôle du muret
J’ai questionné la société E.C.I.B. qui depuis plus de quinze ans met son savoir au service de la réduction du bruit. Réponse : « Pour répondre à votre question, tout mur dont le matériau constituant a une densité importante (un mur de pierre peut en faire partie) peut être considéré comme écran acoustique. Cependant ce qui caractérise la performance acoustique d’un mur antibruit n’est pas uniquement sa composition, mais plutôt sa hauteur et son implantation par rapport à la source de bruit et par rapport au récepteur. Dans votre cas, un mur antibruit même très performant sur une hauteur de 50 cm peut être considéré comme inefficace. (Un écran acoustique classique de 3 m de hauteur donne des gains de 6 à 10 dB en moyenne pour une implantation correcte). Il est important de dire aussi qu’un mur antibruit (même performant) n’annule pas le bruit mais ne fait que le diminuer. Tout cela pour dire qu’assis derrière un mur de 50 cm de haut, vous entendrez certainement une voiture passer derrière. Et à plus forte raison pour ce qui est de l’hélicoptère, surtout si celui-ci se pose et vient donc du dessus, le bruit se déplaçant en suivant une sphère, le bruit parviendra directement aux oreilles du récepteur sans être aucunement freiné par un éventuel écran. Il n’est pas possible de ne pas entendre un hélicoptère se poser sauf si on est sourd ». Le laboratoire d'acoustique (LABE) du C.S.T.B. (situé à Marne-la-Vallée) ajoute que si l’on veut se servir volontairement d’un tel muret pour ne pas entendre le passage d’un véhicule ou d’un hélicoptère: « Le gain sera quasi nul et de toutes les façons pas audible».
. Les vaches
C. Poher qui a discuté avec des éleveurs indique sur son site internet que les vaches broutent généralement « face au vent ». L’éleveur attribuait ce comportement à l’odorat, et au fait que le vent s’écoule dans le sens du pelage. Elles étaient donc majoritairement tournées vers la haie où a été observée le phénomène. Il est donc parfaitement normal qu’elles soient les premières à voir arriver la « machine ». D’après lui, ce phénomène inhabituel (une sphère silencieuse, et lumineuse) les a affolées. Il s’agit d’un comportement très classique de bovins. Il ajoute : « Les vaches de Cussac n’avaient pas besoin d’un son d’hélicoptère pour manifester un comportement inhabituel… ». E. Maillot répond : «Les vaches ont donc fait demi-tour, se sont rassemblées et sont allées jusqu’au muret sud-est. Combien de temps ont-elles mis avant d’y arriver ? … Il y a ici bien plus de chances que les vaches soient affolées par le bruit que par la vue d’un objet lumineux en plein soleil. Une preuve vérifiée et vérifiable : les vaches ne réagissent pas du tout à un flash, pas plus à des flashs répétés, d’appareils photo dirigés vers elles et à moins d’un mètre d’elles … la nuit ! Je crains que Claude Poher n’ait pas vérifié au préalable son argument - luminosité => peur - sur du bétail. Je l’invite à le faire avec flash ou projecteur… Seul le bruit ou une odeur qui leur rappelle le danger (combustion d’un feu, d’un prédateur,..) pourrait les faire fuir et meugler ».
Concernant l’ouïe des vaches, un vétérinaire (27) du Cantal que j’ai contacté me répond : « Je ne pourrais pas apporter une réponse scientifiquement valide car à ma connaissance peu d'études ont été faites sur ce sujet. Néanmoins la vache a certainement une bonne ouïe car c'est une proie dans la nature comme tous les herbivores et un des sens développés chez ces animaux est l'ouïe qui permet de repérer un danger à l'avance. Quant à dire que son ouïe est supérieure à celle d'un enfant de moins de dix ans il y a un pas que je ne pourrais pas franchir. Dans le cas où un enfant n'est pas en permanence vigilant du monde qui l'entoure on peut supposer qu'une vache entendrait avant un enfant certains bruits susceptibles de représenter un danger ». Sa réponse semble aller dans le sens d’E. Maillot. J’avais néanmoins omis de préciser au vétérinaire que deux enfants (dont l’un de plus de 10 ans) étaient chargés de « surveiller » les vaches. Un travail ennuyeux où le moindre « bruit » inhabituel peut être très vite être perçu comme une bonne distraction. Pourtant ils n’ont pas entendu le phénomène arriver (?). A la fin de l’observation, les vaches ont aussi pu sentir l’odeur inhabituelle qui a été signalée lors de l’enquête. Même si cette odeur n’a aucun rapport avec la « machine », elle a pu s’ajouter au stress du bétail…
. Le chien
Dans une première version (ouvrage ufologique), les vaches réagissent bien avant le chien. On suppose qu’il était près des enfants mais c’est peu probable puisque François se serait levé pour l’appeler. Peut-être longeait-il le muret à quelque distance des enfants. Le chien a normalement une bonne ouïe. Il ne réagira en aboyant que lorsque le phénomène commencera à partir, et à émettre un sifflement « aigu » (Ultrasons ? Une Alouette peut en émettre mais elle est aussi très bruyante) et doux. Dans la seconde version (celle du G.E.P.A.N.), le chien prévient ses maîtres de l’agitation des vaches (est-ce dû à la présence de la machine ?). Il n’aboie donc pas vers la « machine ». Il réagit à un phénomène visuel (le mouvement des vaches) et non auditif.
=> Simulation en 2004…
En 2004, Eric Maillot a eu l’occasion de se rendre sur place. On peut voir le résumé de son expérience sur le site du CNEGU. Il a eu la chance de voir passer un hélicoptère (pas une Alouette) alors qu’il était proche du lieu de l’observation. Il déclare à l’époque : « Dès l’apparition du bruit, je me suis mis à compter. Environ 45 secondes au maximum passent avant que le son devienne absolument inaudible, dans un environnement, à ces instants précis, sans aucun véhicule, ni tracteur (quelle malchance ! ) ni bovins beuglant (ils étaient à plus de 300m de l’autre côté de la route) ni chien aboyant comme en 1967 près des enfants. Il mit 25s maximum pour arriver dans l’axe du site OVNI et 20s environ de là jusqu’à disparition du son.». L’hélicoptère vu en 2004 est pourtant beaucoup plus loin (donc moins bruyant) et beaucoup plus silencieux, comme nous l’avons vu précédemment, qu’il y a 40 ans. L’hélicoptère - éventuel - de 1967 se serait fait entendre beaucoup plus longtemps que 45 secondes. Il faut aussi compter quelques secondes supplémentaires pour que les pales qui brassent l’air s’immobilisent totalement après l’atterrissage. Les agriculteurs du Cantal ne devaient pas changer souvent de tracteur. Malgré cela, si je prends par exemple un tracteur Someca type S.OM 40 (de 1957(28)), je constate qu’il peut faire du 13,5 Km/h. Il faut beaucoup moins de 45 secondes à un tracteur qui roule à cette vitesse pour dépasser une personne immobile près de la route. Si le bruit produit par le passage d’un tracteur - ce qui reste à prouver - avait empêché les enfants de percevoir celui émis par un hélicoptère, pourquoi les animaux l’auraient-ils mieux perçu ? Ceci démontre qu’un tracteur ne pouvait pas être passé au même moment sur la route. Si la réaction des animaux n’était due ni à un son ni à un phénomène visuel (voir, page précédente, les excellents arguments avancés par Eric Maillot), à quoi devons-nous l’imputer ? N’est-ce-pas la preuve que nous avons affaire à un phénomène totalement inconnu ?
X. Le « grand test »
En 2004, Eric Maillot proposa, par message électronique, deux expériences aux membres du C.N.E.G.U. Il leur demanda de se remémorer la dernière fois où ils avaient vu ou entendu passer un hélicoptère à l’extérieur. Mentalement, les yeux fermés, ils devaient compter (ou chronométrer) le temps qu’avait duré le passage de l’hélicoptère. L’expérience devait ensuite être reconduite les yeux ouverts. Par la suite, il conseilla de refaire l’expérience avec d’autres personnes, adultes ou enfants de plus de 8 ans. Il fallait impérativement qu’il n’y ait pas de contact ou échange entre ces personnes. Dans les deux cas, on devait ensuite noter les valeurs (mini-maxi). Eric Maillot paria pour une fourchettes de 10 à 15 secondes + ou – 5 secondes. L’un des membres tenta l’expérience avec 4 autres personnes : il y eut donc 8 résultats au total. Les résultats allaient de 8 secondes à 2 minutes, la moitié d’entre eux étant en dehors de la fourchette. Pour la seconde expérience, il fallait se mettre dans un premier temps à l’extérieur et pointer son doigt à 50-100m au sol devant soi. Ensuite, la personne devait imaginer un engin X décollant de quelques mètres, faire une spirale (ou hélice montante), suivre de son doigt cet engin imaginaire et tracer sa trajectoire avec l’index (bras tendu si possible). Deux essais étaient conseillés. Il fallait noter le nombre de tours, le sens, vérifier si (vu de dessous) les personnes avaient tourné en sens horaire ou anti-horaire. Pour 5 personnes, cela fait donc toujours 10 résultats. Eric Maillot pariait que les testés tourneraient dans le sens horaire (« geste conditionné, appris en écriture, sans voir d’ovni »). Il pariait 4 à 6 tours (à + ou – 2 tours près), de pas spirale, hélicoïdal (« limitation physiologique angulaire du bras, sans voir d’ovni à universons pulsés à 100G »). Le test fut cette fois-ci plus concluant et donna sans ambiguïté : « sens horaire », entre 3 et 8 tours. La première expérience parle clairement d’un hélicoptère. Lors de la seconde expérience, le testé a encore à l’esprit l’hélicoptère qui fut mentionné juste avant. On lui demande en plus de faire une spirale. L’enchaînement est logique. Il aurait été plus intéressant de commencer par la seconde expérience et de ne pas demander de mouvement en spirale pour voir la réaction du testé. A Cussac, les enfants n’ont jamais comparé le phénomène observé à un hélicoptère. S’ils n’avaient jamais vu d’hélicoptère auparavant, ils auraient pu dessiner ses pales ou juste un « trait » au dessus de la machine. Ils auraient pu le signaler aux enquêteurs. Ils n’ont rien fait de tout cela. François s’est rendu au salon aéronautique du Bourget au début des années 70. Il a obligatoirement vu des hélicoptères en vol. Il n’est pourtant jamais revenu sur son témoignage. Il semble donc logique de penser que ce qu’ils ont vu ne ressemblait en rien à un hélicoptère. Ce terme « spirale » nous induit en erreur. On peut regretter que le questionnaire reçu par message électronique induise les résultats attendus avant même de commencer l’expérience. Les participants ont été préalablement conditionnés. On est donc loin d’un véritable test en aveugle. Le but était clairement de trouver un défaut à la démonstration du G.E.P.A.N..
XI L’hypothèse ballon
A/ Ballon sonde
Il est utilisé dans les domaines de la météorologie et de l’astronautique pour faire des mesures locales dans l’atmosphère. Il en existe plusieurs types :
Les ballons ouverts : constitués d'une enveloppe légère, ils sont ouverts par le bas et permettent ainsi à l'hélium de sortir au fur et à mesure de la montée. Ils peuvent atteindre jusqu'à 45 km d'altitude et y rester jusqu'à 4 jours. La majorité des ballons lancés dans un cadre scientifique sont de ce type. Le volume d’un ballon avoisine les 400 000 m3.
Les ballons infrarouges : l'enveloppe est souvent aluminisée et permet l'entrée des rayons infrarouges du soleil, ce qui chauffe l'air contenu dans le ballon de manière continue et ce même à haute altitude. Le jour, le ballon monte à environ 28 km et descend la nuit aux alentours de 20 km d’altitude. Le grand intérêt de ce type de ballon est leur très longue durée de vie ; des vols de plusieurs mois ont ainsi déjà été réalisés et permettent de faire plusieurs fois le tour du monde ! Le volume d’un ballon avoisine les 45 000 m3. Zones d’utilisation : Tropique Sud, Equateur, Arctique et Antarctique.
Pour des raisons de volume (trop élevé), ces deux modèles sont écartés de l’étude.
Les ballons pressurisés gonflés à l'hélium : ceux-ci sont constitués d'une enveloppe rigide les empêchant d'éclater. Ils peuvent réaliser des expériences de longue durée (plusieurs semaines), et survoler des terrains différents.
Le ballon pressurisé stratosphérique (altitude maxi 20 Km)
Compte tenu des vents dans la stratosphère, il vole dans une bande de latitude autour du point de lâcher. Sa durée de vie de plusieurs mois peut lui permettre de faire plusieurs fois le tour de la Terre. Son volume (500 m3) correspond assez bien à ce qui a été observé à Cussac mais sa zone d’utilisation (Arctique, Antarctique, et Equateur entre + 20° et - 20°) m’oblige à l’écarter de l’étude. A noter qu’il vole beaucoup trop haut et ne revient au sol que si l'enveloppe est détériorée.
Le ballon pressurisé troposphérique (altitude maximum 1 à 5 Km)
Il vole trop bas pour faire le tour de la Terre mais peut toucher le sol s’il a été alourdi par la pluie, puis re-décoller après avoir séché si l'enveloppe n'a pas été endommagée. Malheureusement, le jour de l’observation, il n’a pas plu et son volume de 3 à 8 m3 ne correspond pas (trop petit) à ce qui a été observé à Cussac mais je le garde pour l’hypothèse « ballon + oiseau » (voir plus bas).
Les ballons-sondes standard gonflés à l'hélium pouvant emporter des charges importantes en haute altitude. Dans ce cas, le ballon est fermé et fait de composés élastiques, ce qui implique qu'il éclate aux environs de 30 km à cause de la pression très faible régnant à cette altitude. En France, il existe 7 stations de radio-sondage qui lâchent un ballon météo, certaines de manière automatique, à heure fixe (à 0h UTC et 12h UTC). Sa durée de vol est en général de 2h 30. Il existait déjà en 1967 mais le volume d’un tel ballon ne correspond pas vraiment (trop petit) à ce qui a été observé à Cussac. Je le conserve néanmoins pour l’hypothèse « ballon + oiseau » (voir plus bas).
Les enfants disent qu’ils ont entendu un bruit au départ de la « machine ». A cette distance, le bruit d’un ballon (la « machine » ?) de cette taille qui se dégonfle (voir le dessin de R. Robé dans les Mystères de l’Est n° 2 – 1996 - page 108) ne peut être perçu par eux, d’autant plus que des tracteurs - bruyants - se déplacent dans des champs voisins. Des tracteurs assez bruyants à cette distance pour couvrir ce « petit » bruit, mais pas assez pour couvrir celui d’une Alouette.
Un autre problème se pose. Quatre inconnus sont observés près de la machine. Si cette machine est un ballon, qui pourraient être ces inconnus ? La récupération fortuite d'une sonde instrumentation (+ déflecteur + parachute ?) de ballon sonde par 4 (voir 5) personnes en hélicoptère me semble invraisemblable.
Le C.N.E.S. a des archives depuis 1962. Une demande de consultation a été formulée le 26 févier 2007, et est restée sans réponse à ce jour.
Presse ancienne :
En faisant des recherches à la BNF (Bibliothèque Nationale de France), j’ai trouvé quelques allusions à des ballons. Dans La Voix du Cantal du 9 septembre 1967, en bas de page, carré « Aurillac », il est indiqué que vers 18h, lundi (donc le 4), on a signalé un objet brillant qui se balançait légèrement comme une montgolfière, le soleil couchant se reflétant sur ses parois argentées. L’article conclut que c’est probablement un ballon sonde. Le samedi 16, un nouvel article évoque le même ballon-sonde, qui aurait été observé deux soirées consécutives. Un météorologiste de Limoges pense qu’il s’agirait d’un satellite américain nommé « Echo 2 ».
J’avais aussi consulté Le progrès de Lyon car les Mystères de l’est n°2 (page 24 - 1996) donnaient par erreur comme référence au cas de Cussac l’édition du 1er septembre(29). C’est ainsi que je suis tombé par hasard sur l’édition du 6 septembre 1967, où l’on peut lire à la page 5bis : « L’as-tu vu, le ballon stratosphérique ? », et un peu plus loin dans le journal : « Cinq heures de suspense céleste hier au-dessus de Lyon» (+ photo). Soucoupe ou pas soucoupe ? C’est le pilote d’un Mirage III de la base de Dijon envoyé en reconnaissance qui finira par identifier le ballon stratosphérique de très grande dimension en provenance d’Aire-sur-l’Adour. Il devait être à 21 000 m d’altitude.


Le ballon pressurisé stratosphérique (CNES) Ballon stratosphérique ouvert (CNES)
Ballon sonde + corbeaux ?
Dans un article intitulé « Télépathie et phénomène OVNI » paru dans L.D.L.N. N°233-234 (Novembre-Décembre 1983), Fernand Lagarde émettra l’hypothèse d’un « gros oiseau noir» et d’une sphère lumineuse. R. Robé du C.N.E.G.U. aura la même idée beaucoup plus tard (voir référence plus haut) en évoquant des « corbeaux » (qui sont de couleur noire et peuvent avoir 1 mètre d’envergure) et un ballon météo. Il n’est pas impossible qu’un oiseau endommage un ballon. Notons qu’un émetteur permet aux contrôleurs aériens de connaître la position d’un ballon (et de transmettre des données scientifiques). Dans certains cas, on récupère le matériel à la fin du vol. Les plus simples sont équipés d’un réflecteur radar. Le 7 mars 2007, j’ai reçu une réponse de Mme Carmen Favrie de Météo France : « Il est possible qu'un ballon lancé par les stations de Bordeaux ou Lyon ait traversé le Cantal en 1967 mais Météo France ne possède pas d'archives concernant la route des ballons lancés à cette époque ». J’écarte la ville de Lyon en raison de sa position géographique et du sens du vent le jour de l’observation.
L’hypothèse « ballon sonde + corbeaux » ne peut néanmoins être retenue pour au moins six raisons :
Les enfants de la campagne sont familiers de ce type d’oiseau.
Les inconnus (corbeaux) sont observés en premier. Il n’y a donc pas concomitance possible à ce moment-là entre la présence de la machine (ballon) et celle des oiseaux.
Rappel :il n’y a éblouissement qu’à partir du moment où la machine est observée.
Aucune trace de ballon ou même de charge utile (2 à 3kg) n’a été retrouvée.
Un ballon, même endommagé, n’aurait pu repartir contre le vent (O/NO)
Les enfants ne signalent aucun « battement » de bras lorsque les inconnus s’élèvent. Comment un oiseau peut-il s’envoler sans battre des ailes ?
Rappel : vers la fin de l’observation, lorsque l’éblouissement n’est pas maximum, les pieds de l’un des personnage sont observés avant qu’il ne disparaisse dans la machine. Il n’y a donc rien qui empêche d’observer aussi un éventuel « battement » d’ailes. Rien n’est signalé car les enfants savent qu’ils n’ont pas affaire à des oiseaux. Ils n’utilisent d’ailleurs jamais le terme « voler » dans leurs propos.
6) Il n’a pas plu à Cussac.
Rappel : L’hypothèse de R. Robé reposait notamment sur le fait qu’un ballon-sonde avait été à l’origine de la même mésaventure dans le Var. En effet, E .Maillot avait trouvé un article de presse daté du 19 mars 1979 intitulé « Ovni dans le Var » (voir page 108, Mystères de l’Est n°2 – 1996) racontant qu’un homme avait vu un ballon-sonde apparemment dégonflé, descendre vers sa maison. Soudain, alors qu’il était presque à un mètre, il remonta à une vitesse stupéfiante. L’explication se trouvait pourtant au début de l’article : « …il sortait dans son jardin profitant d’un moment d’accalmie de la pluie… ». Comme dans le cas du ballon pressurisé troposphérique, c’est la pluie - qui alourdit un ballon déjà endommagé - puis le brusque changement de température (apparition du soleil = chaleur = évaporation) qui ont agi sur le ballon. L’observation de Cussac n’a pas eu lieu au mois de mars mais au mois d’août. F. DH précisait à l’époque que le temps n’était pas orageux et ajoutait : « beau temps, soleil »…
B/ Montgolfière
Avantages : absence de bruit en déplacement, possibilité d’embarquer au moins 4 personnes, bruit du brûleur lors du départ
Inconvénient : On n’y rentre pas par le dessus, la nacelle n’est pas signalée et même si elle était mal décrite on devrait néanmoins continuer à voir les passagers après l’embarquement.
Remarque : l’addition « corbeaux » + « montgolfière sans passager » ne fonctionne pas, pour les mêmes raisons que « corbeaux » + « ballon sonde ».
XII. Les hommes grenouilles
Eric Maillot a émis l’hypothèse que des hommes grenouilles (militaires, Sécurité Civile) revenant d'une mission aquatique avec un pilote habillé normalement auraient pu être confondus avec des « extraterrestres ». Il y a en effet, à l'E/S.E de Cussac, une rivière, la Truyère, qui, grâce au barrage EDF de Granval (achevé en 1959), forme un immense lac touristique de 27 km non loin du viaduc de Garrabit.
Il ajoutait : « habillés d'une "combinaison de plongée brillante et noire". Il n'y a pas assez de place pour se changer dans ce type d'appareil et une combinaison de plongée est un bon isolant contre la fraîcheur des vols en altitude (le site est déjà à 1040m !). Nous aurions alors aussi l'explication de l'aspect particulier de la "tête allongée" puisqu' encore couverte de la cagoule caoutchoutée. Cette dernière fait ressortir le nez et le menton (par son arrondi et le placage des cheveux) et peut donner, de loin, l'illusion d'une "barbe". Cette cagoule est parfois tirée à l'arrière sur la nuque et donne, vu de loin, un aspect très étrange d'une tête en forme de haricot. La "finesse des jambes" serait aussi cohérente vu l'absence de largeur que donnerait le port d'un pantalon. Il en serait de même pour la forte largeur du thorax qui ressort visuellement de la silhouette d'hommes-grenouilles qui doivent, vu leur entraînement, être déjà bien bâtis de ce côté-là. Pour peu qu'ils portent un gilet isolant thermique sous la combinaison, on ne s'étonnerait pas de ce détail. »
Il aurait pu ajouter que l’arrivée d’oxygène qui court de chaque côté du cou fait aussi une excellente « barbe » mais peut-être n’a-t-il pas osé... Nous avons néanmoins là une hypothèse intéressante qui mérite d’être vérifiée.
J’ai écrit début 2007 à deux associations (loi 1901) à Aurillac et St Flour afin d’avoir leur avis et de connaître les endroits habituels utilisés par eux. Je n’ai pas reçu de réponse de leur part à ce jour (j’avais pourtant joint un timbre…). J’eus plus de chance en contactant un plongeur dont j’avais eu les coordonnées par une association sportive d’Aurillac. Il m’indiqua que son club devait exister depuis 1974. Il n’avait pas connaissance d’un club en 1967. Dans les années 80, un ancien président du Club d’Aurillac explora un trou situé à proximité de Comblat-le-Château (Vic-sur-Cère) à une vingtaine de kilomètres, à l’ouest de Cussac. Il ajouta que dans la région, les plongeurs vont au lac Pavin et au barrage Saint-Etienne-Cantales (le plus près depuis 1945), sinon c’est Marseille. Une certaine logique s’imposa à moi. La Sécurité Civile de Clermont-Ferrand m’avait répondu qu’elle s’adressait aux plongeurs du Puy-de-Dome (les plus près) ou se rendait près de la mer. Ce plongeur me tenait le même discours. Peut être y avait-il des plongeurs de St Flour qui se rendaient aux alentours du barrage de Grand Val mais ils n’avaient guère besoin d’un hélicoptère. L’aérodrome (opérationnel) le plus proche en 1967 était de toute façon à Aurillac…


© Fondation Cousteau L’Express du 21 août 1967
1967, c’est aussi les débuts de l’odyssée sous-marine de l’équipe Cousteau. La Calypso, ses hommes-grenouilles, son hélicoptère, sa montgolfière et sa «soucoupe plongeante ». Le 10 décembre, premier essai de plongée de la « puce de mer » dans l’océan indien, non loin de Madagascar. La presse s’en fait naturellement l’écho… Ses aventures seront très appréciées par la jeunesse…
La photo suivante montre Ivan Giacoletto, un professionnel de la plongée de l’équipe Cousteau, prêt à s’enfoncer sous les glaces de l’Antarctique. On distingue la tenue de protection sous son costume de plongée.

© Fondation Cousteau
Pour
ce qui est de l'Armée de Terre (30),
il existe 3 types de plongeurs:
- les spécialistes
d'aide au franchissement (SAF) dont la mission est la
reconnaissance et le déblaiement de berges pour le
passage de blindés.
-
les nageurs d'intervention offensive (NIO) qui assurent des
missions comparable aux NC de la Marine nationale, mais en eau
douce (fleuves, rivières, lacs, et... égouts) et
saumâtre (estuaire).
- les nageurs de combat,
qui, bien qu'issus de l'Armée de Terre, appartiennent à
la DGSE.
Par ailleurs, l'Ecole de plongée qui est situé à Saint Mandrier (Var) - donc loin de Cussac - assure la formation des plongeurs de bord de la Gendarmerie Maritime et de l'Armée de l'Air et la formation des nageurs de combat de l'Armée de Terre. Elle accueille également une dizaine de stagiaires étrangers chaque année. L'Ecole a formé depuis sa création 10 000 plongeurs de diverses catégories, dont 1800 actuellement en service dans la Marine. Chaque année, elle forme 450 stagiaires. L’intégralité de la maintenance des Alouette III de la 35 F (flottille de la Marine) est aussi effectuée à Saint Mandrier.


Binôme du 17ème RGP (sortant d’un plan d’eau)
. Hélicoptère + hommes grenouilles ?
Les photos de la page précédente ne reflètent pas exactement l’équipement de 1967 mais on a déjà une petite idée d’ensemble. A distance d’un plan d’eau, impossible d’identifier ici des plongeurs ! Pour des missions « aquatiques », les portes latérales vitrées de l’Alouette sont généralement ôtées afin de faciliter la manœuvre. Cette configuration diminue la surface vitrée de l’engin, et le rend nettement moins aveuglant lorsqu’il est de côté. Malheureusement, il est écrit que François est aveuglé alors que « l’hélicoptère » est au sol (voir l’article de La Montagne du 1er septembre) et bien avant le décollage. Rappelons que c’est aussi dans cet article que nous trouvons notre hypothèse de départ qui est que l’appareil est posé de côté (cabine + machinerie, queue tubulaire exclue = 4m x 2m). Ces fameuses portes latérales devaient donc être en place et fermées. Si elles sont fermées, lorsque les passagers réintègrent l’appareil, il est très étonnant que l’ouverture/ fermeture des portières n’ait pas été relatée par les enfants. Alain Delmon avait lui aussi remarqué que ce fait aurait dû provoquer une brusque variation de luminosité. De même, si l’hélicoptère est posé de côté, les passagers ne peuvent être très clairement vus se penchant pour pénétrer à bord car ils sont observés de dos. Cette position ne correspond pas vraiment au dessin réalisé - avec les témoins - par le G.E.P.A. en 1968. On m’objectera que - l’éventuel - hélicoptère étant peut-être vu de biais, cela donne encore quelques possibilités de les voir se pencher (mais il aurait fallu néanmoins que nos inconnus pénètrent tous du même côté, pas très pratique). Dans tous les cas, n’oublions pas que le principe d’ergonomie est universel.
Je vais donc aborder le problème différemment. Où peut bien se rendre cet appareil lorsqu’il quitte le pré de Cussac ? Logiquement, il rentre à sa base. Mais où va-t-il atterrir ? Au lieu de se diriger vers l’aérodrome d’Aurillac au SS/W (Il a été créé en décembre 1932, celui de St Flour-Coltines au NE n’a été créé par contre qu’en 1982), il semble se diriger vers le Plomb du Cantal (?). Si sa base se trouve au delà du Plomb du Cantal, on comprend encore plus difficilement ce qu’il est venu faire du côté de la Truyère. Un rapide coup d’œil sur une carte Michelin permet de dénombrer plus d’une dizaine de lacs (d’Aydat, Servières, de Guéry, Chambon, de Bourdouze, de Montcineyre, de la Crégut, etc.) de ce côté-là. On trouve aussi un site intéressant près des Gorges de Montfermy et du viaduc des Fades. Il y a aussi le barrage de Neuvic d’Ussel (achevé en 1945), situé dans un département voisin mais néanmoins beaucoup plus proche que celui de Grand Val. J’exclus le barrage de Lastioulles car il n’existait pas encore. Tous ces sites sont beaucoup plus proches de Clermont Ferrand, base idéale tant au niveau militaire que pour la Sécurité Civile. En résumé, pourquoi venir si loin pour une « mission aquatique » ? Je n’ai trouvé qu’une seule exception dans La Voix du Cantal du 15 juillet 1967 (page 2). Le journal mentionnait qu’il y avait eu une grande fête locale le 23 juillet 1967 à St Etienne-Cantalès (site déjà mentionné par M. Severac, le plongeur). Sous la présidence du préfet et de nombreuses personnalités (peut-être les maires des localités voisines et leurs enfants… de Cussac ?), une démonstration, par la protection civile, d’un sauvetage nautique, effectué par un hélicoptère, avec le concours de la gendarmerie et du corps de Sapeurs-Pompiers. Aucune fête de ce genre n’a eu lieu fin août au barrage de Grand Val. Pourquoi d’ailleurs se poser au retour dans un pré de Cussac ? On comprend mal aussi les raisons pour lesquelles ces - hypothétiques - plongeurs auraient gardé leurs palmes aux pieds, ce qui ne facilite pas la marche dans un pré et leurs « coiffes » qui devaient de toute façon encore les « serrer ». En décollant à proximité du barrage de Grandval, et en se dirigeant vers St Flour (et non vers Cussac) on peut passer par Ferrières-St-Mary et atteindre Clermont-Ferrand. C’est quasiment une ligne droite qui permet de se rendre assez vite du Cantal au Puy-de-Dôme. J’ajoute que l’Alouette II peut être équipée d’une installation de chauffage qui pèse 10 kg, ce qui évite de s’équiper très chaudement. D’ailleurs A. Morel me précisa : « Bien sûr ces appareils disposent tous de chauffage de cabine pour voler l’hiver ». On pouvait donc le mettre en marche l’été si le franchissement d’une montagne ou des températures très basse le nécessitaient. Pour terminer, j’ajouterai que j’avais parlé précédemment du lac Pavin où les plongeurs d’Aurillac aimaient aller. J’avais oublié de préciser que c’est un lac de cratère qui s’est formé à la suite d’une explosion violente produite par la rencontre du magma ascendant et d’une nappe d’eau (Maar ou nappe Phréato-magmatique ). A 1197 m d’altitude, il impressionne toujours ses visiteurs par la sombre nappe circulaire, 1000m de diamètre, dans laquelle se reflète la verdure environnante. Le lac Pavin est aussi le plus profond des lacs auvergnats (92m ). On comprend facilement que lorsque l’on dispose d’un si beau lac pour faire de la plongée dans le Puy-de-Dôme, on ne va pas perdre de temps à aller dans le Cantal…
XIII. D’autres cas exotiques
Cantal et Puy-de-Dôme
Il semble y avoir peu d’observations OVNI dans le Cantal. Je n’ai trouvé qu’une observation recensée dans le volumineux ouvrage de Michel Figuet et J.-L. Ruchon : « 04 1947 8h15 col de Serre près de Falgoux (15380), témoin : Maxime Orliange, Disque de 30 m de diamètre avec une coupole, lumière bleue sortant d’entre la coupole et le disque. Sources. Quincy.- Incat 7. Challenge to science the U.F.O. Enigma (1966) de J. et J. Vallée, page 119 » Une mini-vague locale est signalée le 21 octobre 1982 (L.D.L.N. n°271-272), une observation le 25 août 1993 à Mauriac (L.D.L.N. n°320) et deux autres (dont une expliquée) dans la base G.E.I.P.A.N. mise sur internet en mars 2007. Il existe probablement d’autres cas dont je n’ai pas connaissance. M. Georget (ufologue) signale à L.D.L.N. (93bis et 94bis – mai 1968) une étrange panne de secteur à Clermont-Ferrand le 16 juin 1967 et un objet ovale d’un vert éclatant (date ?). M. C. Ameil (ufologue) est réveillé dans la nuit du 17 au 18 juillet 1967 par une violente explosion d’origine inconnue.
Alpes-de-Haute-Provence
Cinq personnes surprennent un petit être « barbu » dans une pièce vide d’une ferme en réparation. L’étrange apparition leur glisse entre les mains - comme si elle était aidée par des forces invisibles - et se sauve par la fenêtre. Elle disparaît au cours d’une ultime poursuite dans la campagne. L’émotion est considérable dans l’entourage des témoins qui désirent une absolue discrétion. Cet incident a eu lieu fin janvier 1967 sur le plateau de Valensole. La célèbre observation de M. Masse avait eu lieu près de là, le 1er juillet 1965… (Phénomène Spatiaux n°11, mars 1967, p.30)
Doubs
Le cas d’Arc-sous-Cicon du 17 juillet 1967 a souvent été rapproché du cas de Cussac à cause de l’âge des témoins (des enfants) et de la couleur des « personnages » (noirs). Ce jour là, un groupe d’enfants se promène dans les pâturages. Vers 15h, une petite fille voit trois « chinois » tout noirs. Une heure plus tard, deux autres enfants observent à leur tour - à 25 mètres - une créature d’environ 1 mètre 10. Ils la décrivent comme étant vêtue d’une sorte de collant noir, se déplaçant à grandes enjambées souples, ses pieds touchant le terrain d’une manière très légère. Son collant noir la moule sauf aux jambes où il paraît moins adhérer. Sur les fesses, quelque chose comme un pan d’habit très court semble flotter. Son ventre paraît assez gros. Le lendemain, une sorte de rond de 3 à 4 mètres de diamètre où l’herbe est brûlée est découvert. Une odeur indéfinissable s’en dégage. Il est possible que les deux phénomènes ne soient pas liés.
Corrèze
Le 10 septembre 1954, un cultivateur du hameau de Mourieras, Antoine Mazaud (ou Mazeaud), rentrait des champs. Il devait être entre 19 et 21h lorsqu’il vit un individu de taille moyenne marcher vers lui tête « baissée » (détail relevé lors d’une autre observation datant des années 30). M. Mazaud, inquiet, esquiva un geste de défense avec la fourche qu’il portait sur l’épaule. L’individu s’approcha, lui serra la main et retira une sorte de casque. Il semblait d’apparence métallique et était dépourvu de mentonnière. L’individu lui donna l’accolade sans lever la tête. C’est un détail important car M. Mazaud mesure environ 1m80. Certains journaux prétendirent par la suite que l’individu lui avait donné un baiser (« à la russe »), ce qui est faux. Aucune parole ne fut échangée. M. Mazaud, perplexe, laissa tomber sa fourche. L’individu s’éloigna rapidement. M. Mazaud entendit un léger bruissement (un peu comme le bourdonnement d’une ruche). La lune, quoique claire, ne permettait qu’une médiocre visibilité. Il vit néanmoins une forme ressemblant à une corne vue à l’horizontale - d’une longueur n’excédant pas 6 mètres - prendre lentement de l’altitude et brillant faiblement. La « chose » parut passer sous la ligne électrique qui bordait la route. Elle s’éloigna vers l’ouest où on signala (à Limoges) le passage d’un objet rouge (coïncidence ?). La même nuit, Marius Dewilde faisait sa célèbre observation près de Quarouble (Nord). Le cultivateur de Corrèze, quant à lui, ne voulut pas en parler mais sa femme ébruita l’affaire qui parvint aux oreilles des gendarmes. Ces derniers transmirent le dossier aux Renseignements Généraux de Tulle. Une enquête fut menée sans plus de résultats. Aucune trace ne fut découverte. On conclut que le témoin était sincère. Les journalistes s’en mêlèrent et la photographie du pauvre cultivateur fit la une (La Montagne de Clermont-Ferrand, etc.). Avec du recul on pourrait aussi penser à un hélicoptère mais là encore, le bruit trop faible, l’évolution de la machine (sous une ligne électrique ?) et les hélicoptères de l’époque ne semblent pas expliquer l’observation. On notera que l’individu était d’apparence humaine (voir chapitre XX Bilan).
Deux observations en 1972
Nous sommes au mois d’avril, à Sainte Soulle en Charente-Maritime. Un homme qui circule en voiture observe par une belle nuit étoilée un objet discoïdal d’environ 16m de diamètre surmonté d’un dôme posé au sol. Sa voiture s’étant arrêtée inexplicablement, il observe un être minuscule et noirâtre de 1 m de haut. Il bondit sur le rebord du disque, puis saute à nouveau pour se « fondre » littéralement dans le dôme. Après une ascension pendulaire, l’engin s’immobilise quelques secondes et s’éloigne d’un « trait lumineux ». Le témoin aura une amnésie partielle. Une autre personne - simple d’esprit - ne pourra malheureusement témoigner. On trouva des traces au sol mais aussi une vache morte… (transmis par R. Robé, source L.D.L.N. n°158 p.15-16, enquête D. Beziat)
Second cas dans le Sud-Ouest de la France. Un autre témoin observe, de nuit, un groupe de 3 ou 4 petits êtres vêtus de combinaisons très sombres près d’une boule lumineuse d’un diamètre de 3 à 4 m environ. Il les compare à des « petits vieillards » car ils ont le crâne haut et dégarni ainsi qu’une « barbe » abondante. Il se sent « transpercé » par les regards. Ayant réussi à se munir d’un fusil, il sera incapable (paralysé ?) d’appuyer sur la gâchette. Il assiste impuissant au décollage. (transmis par R. Robé, source Zurcher).
13 décembre 1973
Un chroniqueur sportif du nom de Claude Vorilhon prétend avoir rencontré un extraterrestre au cœur du cratère du Puy de Lassolas (près de Clermont-Ferrand). La créature mesure environ 1 m 20 et a la peau blanche, tirant sur le vert. L’extraterrestre, un Elohim, donne à Vorilhon son nouveau nom : Raël. La suite, tout le monde la connaît…
Les travaux de Thierry Pinvidic
T. Pinvidic signale dans un article paru Communication n°52 (p.311-335 – 1990) d’autres cas présentant des similitudes avec celui de Cussac :
1914, Georgia Bay (Canada). Je complète cette information par un extrait du site internet de Madame Godelieve Van Overmeire : « …Trois autres petits personnages apparurent à la partie supérieure du globe. Ils étaient vêtus cette fois en kaki et portaient, comme les deux premiers, une sorte de masque carré jusqu'aux épaules. Pendant ce temps les deux autres avaient récupéré leur tuyau, le poussant par une sorte d'écoutille. Alors que l'un de ces êtres n'avait pas encore eu le temps de rentrer à l'intérieur de l'objet, celui-ci s'éleva brusquement de la surface du lac, obligeant le malheureux à s'agripper énergiquement à une rampe chromée et il disparut rapidement à la vue des témoins» (sources : Tout sur les soucoupes volantes de Jean Ferguson - Leméac, Ottawa, 1972 - p.187 ; La chronique des OVNI de Michel Bougard - Delarge 1977 – p.224)
1954 (Août), département de l’Yonne, dans une région de plateaux argileux (montagne des Alouettes). Ce sont encore une fois de plus des enfants (avec cependant un moniteur) qui sont témoins des faits. L’objet observé à quelques mètres n’est pas une sphère mais une « classique » soucoupe volante. La suite est par contre plus intéressante. Les humanoïdes observés mesurent entre 1,20 et 1,40m, ils sont revêtus d’une espèce de combinaison, que le témoin compare, avec le recul, à une tenue d’homme-grenouille noire. On ne voit pas leurs yeux ni aucun trait, mais ils ont un genre de groin comme certains singes ; cela peut aussi ressembler à des masques que l’on utilise dans la cimenterie pour se protéger de la poussière. Les jambes se terminent par des pieds plutôt longs et palmés. Lors de leur disparition, les deux êtres, qui étaient au sol, plaquent leurs bras le long du corps, puis ils s’élèvent à la verticale. Ensuite, après avoir décrit une courbe, ils réintègrent l’objet tête la première. Après avoir décollé, l’objet disparaît à une vitesse prodigieuse en 4 à 5 secondes environ. Le seul problème de ce témoignage est qu’il a été connu 26 ans plus tard.
(Enquête de J. P. et E. Hocquet - L.D.L.N. n°200, décembre 1980, p.29-32).
=> T. Pinvidic avait interrogé l’ufologue Denys Breysse qui l’avait trouvé à l’époque dans sa base de données « Bécassine »
12 autres cas de vol d’entités similaires* à celui de Cussac. Le plus ancien remonterait à 1868. Ce motif de vol est surtout répandu au Brésil.
(* En général les cas de lévitation d’humanoïdes au moyen d’un faisceau sont beaucoup plus fréquents)
Je signale aussi des observations assez intéressantes faites cette fois-ci en Afrique du Sud, aux U.S.A., en Pologne et au Brésil :
Afrique du Sud
« Nuit du 3 au 4 janvier 1979 – Johannesburg (Afrique du Sud)
A l’Ouest de Johannesburg, à Krugersdorp, Mme Quezet et son fils ont vu un engin sur la route à une vingtaine de mètres d’eux, devant lequel se trouvaient 5 à 6 êtres. L’un de ces êtres, barbu, paraissait être le chef, il a essayé de parler avec Mme Quezet (qui ne comprenait guère leur langage). Alors que cette dernière demandait à son fils d’aller chercher le père, elle vit les êtres faire un bond d’1 m 50 environ en l’air et disparaître derrière une porte coulissante de l’engin. Le vaisseau disparut en quelques secondes . Les êtres avaient la peau sombre et portaient des vêtements blancs ou roses, l’un d’eux avait un casque blanc, semblable à ceux des cosmonautes. Il y avait également 2 lumières roses allumées de chaque côté de la porte de l’engin. »
(Sources : La Montagne du 7 janvier 1979 et Le Journal de la Réunion du 13 janvier 1979, infos transmises par Raoul Robé)
Amérique du Nord
« Le 19 janvier 1967, 9h05, Tad Jones emprunte la route 64 pour se rendre à son magasin situé à Cross Lanes (U.S.A.). Soudain, il se trouve face à un gros engin qui lui bloque le passage. Il pense d’abord à un gros engin de chantier utilisé pour la construction d’autoroutes mais très vite il se rencontre que l’objet plane en l’air, à environ un mètre vingt du sol. Il déclare : « C’était une grande sphère métallique. Comme il faisait complètement jour, j’ai très bien pu l’observer. Elle faisait environ 6 m de diamètre, d’une couleur d’aluminium mat… Il y avait quatre pattes fixées au-dessous, avec comme des (petites) roues de tracteurs au bout de chaque patte. Et il y avait une petite fenêtre d’une vingtaine de centimètres sur le côté de la sphère qui me faisait face. Mais je n’arrivais pas à voir à l’intérieur. Sur le dessous, il y avait quelque chose qui ressemblait à une hélice (ou propulseur ?). Elle était immobile quand je suis arrivé, puis elle a commencé à tourner sur elle-même de plus en plus vite et l’objet s’est mis à s’élever. Il a disparu dans le ciel… ». Cette sphère (croquis ci-dessous à gauche) compte des détails supplémentaires (petite fenêtre, forme en dessous…) mais rappelons-nous qu’à Cussac, les témoins étaient partiellement éblouis… (Sources : Flying Saucer review, vol.13 - n°3, mai-juin 1967 ; La Prophétie des Ombres de John A. Keel, pages 136 et 356…)
 U.S.A.
U.S.A.
 Cocoyoc
(Mexique) 3/11/73
Cocoyoc
(Mexique) 3/11/73
Europe de l’est
Le 18 octobre 1967, à la suite de nombreuses observations de N.L.O. (OVNI selon les initiales russes), notamment dans la région du Caucase, la « commission permanente cosmonautique de l’U.R.S.S. » est créée (Sources : New York Times - Novembre 1967, Historia n°395, etc…). L’année suivante, l’Académie des Sciences décrète que les OVNI n’existent pas. Dix ans plus tard, le 10 mai 1978, Jan Wolski, un paysan de la région de Lublin (sud de Varsovie) rencontre «4 humanoïdes ». Deux d’entre eux sautent dans la carriole du paysan « sans prendre d'élan ». Il croit - lui aussi – dans un premier temps avoir affaire à des nains. L’apparence générale (tenue, taille, forme des pieds) fait sensiblement penser aux inconnus de Cussac. On note néanmoins quelques différences :
=> la « machine » n’est pas de forme sphérique
=> la peau en partie visible est verte (31)
=> ils ont comme une bosse sur le cou
Se
pourrait-il que les enfants de Cussac aient confondu cette
« bosse» avec une barbe (qui, comme son nom
l’indique, peut se situer au niveau du cou) ? Etant donné
la distance, l’ombre des arbres, et le fait que les
inconnus étaient peut être observés la plus
grande partie du temps de dos, les enfants n’ont peut-être
pas vu la couleur de leur peau. J’ajoute que les humanoïdes
décrits par Jan Wolski sont d’allure « chinoise »
comme à Arc-sous-Cicon et le tissu semble « flottant »
au niveau des fesses, ces mêmes « fesses »
dont on parle à Arc-sous-Cicon. Suivant l’angle sous
lequel la créature a été observée à
Arc-sous-Cicon et pour peu qu’elle se soit « ramassée »
sur elle-même dans sa course, l’observation a pu être
faussée : le ventre proéminent observé
par la petite fille peut correspondre en fait au pli formé
par le vêtement de l’humanoïde dans le
témoignage de Jan Wolski. Une combinaison qui peut être
pressurisée ? (Sources : BDVD Thorgal
entre les faux dieux
– c’est le futur dessinateur Rosinski qui fut mandaté
à l’époque par la première chaîne
de télévision polonaise pour se joindre au
tournage, auquel participaient un sociologue et un psychologue ;
J.-L. B. - Nostra
- 23.7.1980)
Le 10 Août 1979, un habitant de Czluchow observe des inconnus mesurant un mètre cinquante, hermétiquement vêtus de quelque chose qui ressemble à des combinaisons de plongée, avec une sorte de vitre au niveau des yeux. Leurs hanches sont anormalement inconsistantes. Chacun d’eux a une sorte de « bosse au cou » entre le bas de la tête et les épaules. Là encore, pas de sphère mais un objet ressemblant à une surface rectangulaire et lisse, aux coins arrondis.( L.D.L.N n°271-272, p23-24, janvier-février 1987)
Afin de trouver des cas similaires, j’ai contacté les ufologues G. Lebat et Chaloupek qui m’ont tous deux conseillé de joindre le professeur Jiri Kult en Tchécoslovaquie. Ce dernier a transmis ma demande en Pologne à son ami M. Robert K. Lesniakiewicz vice-président du Centre de Recherche sur les Phénomènes Anormaux à Cracovie qui l’a lui-même transmis à un autre chercheur, Bronislaw Rzepecki, habitant près de Cracovie. J’en ai profité pour passer une annonce sur le site internet des Repas Ufologiques Parisiens. G. Munch du C.N.E.G.U. a fait de même pour moi sur la liste EuroUfo, ce qui m’a permis de contacter des ufologues polonais.



10 Mai 1978 (Pologne), dessins de Rosinski 10 Août 1979
« noirs…combinaison moulante… »
« la barbe…elle se trouve située de chaque côté de la tête… » « pieds palmés… »
(Enquête G.E.P.A. – 1968)
Le
5 avril 2007, Malgorzata Zoltowska de la Fondation Nautilus
(Pologne) confirme les informations que je possédais sur
le cas du 10 mai 1978. Elle écrit : « Comme
promis, je vous envoie les informations que j'ai pu recueillir,
concernant des créatures pourvues d'excroissances au
niveau du cou. A Emilcin, Jan Wolski (témoin oculaire de
l'événement), pendant l'entretien avec le
sociologue Zbigniew Blania-Bolnar et le Dr Ryszard Kietlinski,
psychologue, a décrit une espèce de bosse dorsale
chez ces créatures. De toute évidence, ce n'étaient
pas des sacs à dos ou d'autres objets de la sorte. D'après
Wolski, leurs corps étaient ainsi constitués. Les
bosses dépassaient, des deux côtés et de la
longueur d'une main, la largeur du dos. L'entretien a eu lieu le
10.06.1978, c'est-à-dire un mois après l'événement.
Le 27.09.1978 à Golina, localité près de la
ville de Konin, on a rencontré des créatures ayant
les mêmes caractéristiques.
Source
de l'information: "l'Evénement d'Emilcin" de
Zbigniew Blania-Bolnar…»
Elle ajoute le croquis ci-dessous :


La « difformité » au niveau du cou semble moins ample que sur les dessins de Rosinski mais l’allure générale reste la même. Si l’on ajoute un « casque », le croquis ressemble étrangement au dessin réalisé par les enquêteurs en 1968 (voir page suivante).
Brésil
a) J-C. Bourret dans son livre La nouvelle vague des soucoupes volantes (1975) signale un autre cas qui aurait eu lieu près d’Itapetuna, une petite ville de l’Etat de Rio. Le témoin, Manuel Silva e Souza, est un militaire brésilien. Il observe le 20 décembre 1971, à 21h30, une lumière bleue intense. S’approchant à vingt mètres, il distinguera une forme ovale. Une créature d’environ 90 cm marche près de la forme éblouissante. Le témoin indique que la créature a élevé les bras à l’horizontale puis elle s’est soulevée de terre, sans bruit. Elle est ensuite entrée par le haut, la tête la première. Il y avait deux autres créatures portant des uniformes de couleur kaki à l’intérieur. Le tissu semblait très souple, mais ne lui rappelait rien de connu. Ils portaient aussi une ceinture plus claire, vert avocat (par dessus l’uniforme) et des petites bottes montantes et collantes un peu comme celles des boxeurs. Il y avait aussi une grosse boucle apparemment très jolie. Leurs visages (pas des masques) ressemblaient à ceux des humains mais le cou était plus court. Le président du Centre d’Enquêtes sur les Objets Volants Non Identifiés au Brésil, M. Hulvio Aleixo, possédait, semble-t-il, à l’époque un rapport semblable qu’il jugeait authentique.
b) On trouve des similitudes très étranges entre le cas de Cussac et « la rencontre » vécue par le fermier brésilien Antonio Villas Boas(32) le 15 octobre 1957. Relisons une partie de son témoignage : « Tous les cinq étaient vêtus de combinaisons très ajustées … Cet habit montait jusqu’au cou, où il rejoignait une sorte de casque…Ces casques cachaient tout, ne laissant de visibles que les yeux de ces gens… Au-dessus des yeux, le haut de leurs casques devait correspondre au double de la taille d’une tête normale… ». Les dessins ci-dessous ne prennent pas en compte ce dernier détail (oubli ?) qui correspond pourtant assez bien à la description des enfants de Cussac. Concernant la jeune « femme » qui eut des « rapports » avec Antonio Villas Boas, ce dernier déclare que « le visage se rétrécissait très abruptement, s’achevant par un menton pointu… ».
René Fouéré déclarait en 1966 : « Il nous est dit que la mâchoire inférieure des petits êtres vus par Maurice Masse était très saillante, presque pointue, comme celle de la femme décrite par Antonio Villas Boas » (A Valensole, M. Masse avait déjà vu et discuté avec des pilotes d’Alouette avant son observation de juin 1965). On retrouve cette caractéristique dans le témoignage des enfants de Cussac. On remarque aussi (voir dessin de C. Pavy en 1968) le haut de la tête qui est pointu. On peut raisonnablement se demander si ces personnages - comme ceux d’Antonio Villas Boas - ne portent pas un casque. Les enfants de Cussac ne distinguent rien du visage en dehors de ce qu’ils pensent être une barbe. Là encore, le rapprochement avec les humanoïdes d’Antonio Villas Boas est frappant puisqu’il ne pouvait voir - de très près - que les yeux. Néanmoins, dans le cas de Cussac, pas de tube argenté émergeant du centre de la tête pour s’élancer en arrière. Quant à la « barbe » (ou bosse ?), je n’exclus pas que ce puisse être un équipement artificiel. Lors de la conquête spatiale, américains et soviétiques usèrent de tenues et de machines d’aspect parfois très différent (notamment les modules d’exploration lunaire). Peut-être avons-nous, dans le cas présent, un autre exemple des différences, que ce soit même en couleur de peau, à l’intérieur d’une même espèce.





Croquis réalisé sous hypnose par H. Shirmer (1967) / Stations d’exploration soviétique et américaine sur la Lune
pour la commission Condon.
De nouveau, un humanoïde avec combinaison très ajustée. Simple coïncidence ?
Une hypothèse extrêmement exotique :
On trouve dans la courte histoire de l’ufologie des phénomènes qui pris séparément semblent incompréhensibles. L’un des plus connus est le « missing time » mais Charles Bowen dans En quête des humanoïdes nous signale un phénomène plus rare : des OVNI qui rapetissent avant de disparaître. Citons aussi une histoire ahurissante survenue à Villares del Saz, en Espagne. Dans cette observation datant de juillet 1953, un vacher remarque, vers 10h, un gros ballon et des petits hommes qui sortent de son sommet. Au moment de repartir, ils s’accrochent à quelque chose qui était sur le ballon, et ils sautent pour y rentrer. La machine s’élève, brille très fort puis disparaît comme une fusée. Le fermier court à la maison avec les vaches. Cette observation fait penser à celle de Cussac. J’ai néanmoins omis, à dessein, de préciser que le ballon ne mesurait pas plus de 1m30 et les personnages environ 65cm. Le 15 novembre 1969, une dame observe 3 petites soucoupes volantes (environ 60 cm) au-dessus des toits de Nancy. Plus récemment, l’ufologue G. Lebat me signala une observation qui avait eu lieu sur l’île de la Réunion le 29 octobre 2007: « Pendant toute l'observation ils (les témoins) ont aperçu 5 ou 6 "petites poupées de couleur blanche"qui marchaient très lentement à côté des objets et semblaient rentrer ou sortir de l'objet en forme de "demi-lune". Ils estiment la taille de ces entités à "5 ou 6 cm" pas plus. Les entités avaient un aspect humanoïde "comme des petites poupées" et avançaient très lentement »
Quel pourrait être le point commun entre le facteur temps, des variations de taille chez les personnages et un changement de « dimension » ? Admettons que nos visiteurs viennent d’un autre univers, d’une autre dimension. On pourrait imaginer que lors du « passage » de leur univers vers le nôtre un effet physique, en vertu de lois qui nous échappent pour l’instant, agisse sur le véhicule et ses occupants. Ces voyageurs arriveraient avec des dimensions différentes de celles qu’ils possédaient au départ, ce qui expliquerait ces visions de géants, de nains et de vaisseaux qui rapetissent. Il est bon de rappeler que selon certains physiciens, au niveau subatomique, des trous de vers apparaîtraient et disparaîtraient en permanence.
Kip Thorne, de l’Institut Californien de Technologie s’est particulièrement intéressé à ce sujet. Il aida le regretté Carl Sagan dans l’écriture de son livre Contact (voir aussi l’adaptation cinématographique avec l’actrice Jodie Foster). C’est aussi un ami du grand Stephen Hawking. Le travail de Thorne est situé entre la science et la spéculation. Il s’est fait la spécialité d’étudier les conséquences inattendues de la théorie de la gravité d’Einstein: trous noirs, trous de vers et autres objets bizarres qui font fléchir l’esprit tout autant que l’espace et le temps. Après tout, la machine temporelle (possible) et les vagues gravitiques (certaines) sont les conséquences directes de la théorie de la gravité d’Einstein. Il pense que dans certaines conditions des trous de vers pourraient être créés et maintenus ouverts assez longtemps pour pouvoir être empruntés à l’échelle macroscopique. La machine à remonter le temps existe donc bien dans le monde infiniment petit. Il faut maintenant espérer qu’un jour les scientifiques fassent la liaison entre deux phénomènes semblant toucher à l’espace-temps : les trous de vers et les OVNI…
XIV. Les humanoïdes volants
En 1979, le groupe ufologique G.A.B.R.I.E.L. publia Les soucoupes volantes : le grand refus ? A la page 82, les auteurs présentèrent brièvement les cas d’humanoïdes dont la particularité était de voler (l’observation de Cussac y tenant une bonne place). Ils notèrent certaines différences avec les autres humanoïdes:
leurs têtes sont de proportions tout à fait normales par rapport à leur taille (environ 1 m)
ils possèdent souvent un gros ventre et de grosses fesses
ils ont souvent la tête recouverte d’une « cagoule » qui dissimule leurs traits
Ils concluaient que ce sont eux qui se rapprochent le plus de l’être humain.
Comme je l’ai déjà dit précédemment, le « gros ventre » et les « grosses fesses » pourraient provenir d’une mauvaise interprétation des témoins. Je pense qu’il y a bien, néanmoins, quelque chose au niveau des fesses dans certains cas. Plutôt un tissu flottant, d’après moi.
Quelques années plus tard, la revue L.D.L.N. n°334 revint sans le vouloir sur le sujet. J. Mesnard s’intéressait depuis cinq ans au « mimétisme des OVNI » et un article de Paolo Fiorino dans le n°13 de UFO, la revue italienne du C.I.S.U., l’intriguait fortement. Il y était question d’une série d’observations d’humanoïdes volants faites dans le centre de l’Italie pendant l’été 1993. Il fit aussitôt le rapprochement avec une autre observation datant d’octobre 1990 qui, elle, avait eu lieu près de Thurso, à environ 25 km au nord-est d’Ottawa. J. Mesnard considéra qu’il avait classé trop rapidement cette observation dans les méprises. Il conclut que le phénomène avait imité grossièrement des ballons d’enfants (voir plus récemment dans Les Mystères de l’est n°11, cas de Toul le 23/10/2005). Je ne tiens pas à rentrer dans le sujet controversé du « mimétisme des OVNI », mais je pense que ces observations italiennes sont dignes d’intérêt. La revue UFO reviendra d’ailleurs sur le sujet dans le numéro 18 à la suite de nouvelles observations.



L.D.L.N.
Il y a de cela une dizaine d’années, j’eus moi aussi à enquêter sur l’observation d’un humanoïde volant. Un homme – qui se disait ufologue amateur - était persuadé d’avoir vu en 1992, avec un ami, un « homme » flottant en plein centre-ville de Nantes, vers 12h30 (?). Il prétendait qu’il y avait eu d’autres témoins, qu’il les avait abordés mais que personne ne voulait en parler. Le croquis qu’il me transmit montrait un humanoïde tel qu’on les représentait dans la série X-Files. En faisant quelques recherches, je pus trouver d’autres observations d’humanoïdes vêtus de combinaisons argentées en 1992. Etait-ce un hasard ? Le seul phénomène curieux recensé à Nantes à la même époque était une mystérieuse hécatombe de pigeons dans un parc. Ces morts étaient dues à un désordre physiologique, mais très difficile à interpréter (?) Quand on pense aux pigeons, on pense magnétisme et… là encore, probablement à une coïncidence. Je ne pus, de toute façon, jamais rencontrer l’autre témoin. L’ « ufologue amateur » avait fait aussi une autre observation plus « classique » en 1996. Finalement il rompit le contact. Je reste encore aujourd’hui déconcerté par son témoignage. S’il avait voulu inventer une telle histoire, pourquoi ne pas avoir dit que l’observation avait eu lieu la nuit ou sans témoin ?

![]()
Croquis du témoin de l’observation de 1992 Mexique 2000
En l’an 2000, des « humanoïdes volants » furent observés au Mexique(33). Ce pays est surtout connu par les ufologues pour sa grande quantité d’enregistrements vidéo d’OVNI (voir notamment celle commercialisée par Marshall Cavendish : « La grande vague d’OVNI »). Il est probable qu’à force de voir les étrangers filmer leurs très nombreux sites touristiques, les habitants - malgré une certaine pauvreté – aient voulu s’équiper de caméscopes et filmer « tous azimuts ». Au mois de mars, Salvador Guerrero, « grand enregistreur de vidéos ufologiques», filma depuis le toit de sa maison quelque chose d’inédit. En zoomant, il observa une sorte d’humanoïde flottant dans l’air à haute altitude. Ce dernier resta immobile plusieurs minutes, puis disparut derrière un bâtiment. Deux de ses amis filmèrent des phénomènes analogues : le premier, dès le mois de février, mais il n’avait pas diffusé le film à cause de son étrangeté. Là encore, on observait un « petit homme » volant horizontalement, debout, jambes écartées, sans aile ni parachute. Le second ami de Guerrero, en juillet, filma un petit corps sombre humanoïde descendant doucement dans une vallée, avant de disparaître derrière une colline. Comme les différents témoins se connaissent, on peut se poser des questions sur la fiabilité des documents. On pense inévitablement à un ballon à forme humaine et à un coup monté pour se faire un peu d’argent.


Pourtant, le 1er octobre, La Prensa, journal de Mexico, publiait le témoignage d’un pilote de ligne qui avait vu, avec son copilote, un « petit homme volant » lors de la descente sur l’aéroport de la capitale. Cet « humanoïde », qui flottait à la même altitude que l’avion, avait une sorte de sac à dos. On distinguait des bras et des jambes. En décembre, S. Guerrero enregistra de nouveau en présence d’un témoin un autre « hombrecito volador ». L’histoire aurait pu s’arrêter là mais, en janvier 2004, le journal El Norte de Monterrey relata la mésaventure survenue à un policier municipal alors qu’il patrouillait en voiture. Ce dernier raconta avoir vu ce qui ressemble « à une femme dans un vêtement noir» descendre à grande vitesse jusqu’aux arbres (hauts de 6 m), puis à la fin plus lentement, en tournant sur elle-même. Elle avait les yeux entièrement noirs, sans paupières. Le policier voulut faire demi-tour avec sa voiture pour demander du secours. La « sorcière » se dirigeait vers lui : il s’évanouit. Un examen médical ne révéla ni abus de drogue ni problème psychologique. L’humanoïde fut aussi filmé par une autre personne au-dessus de la ville. Lorsqu’il témoigna, le policier ajouta que la créature semblait porter un casque, incurvé vers le bas. Cette description ressemble à celle du « monstre de Flatwoods » signalé aux Etats-Unis, au début des années 50.



El Norte © Vidéo Still
Le 14 février de la même année, Mme Ana Luisa Cid et 2 autres personnes enregistrèrent à Mexico un énorme objet sombre, comme un grand « corps noir » surmonté d’une sorte de structure vibrante. A ce moment-là, elle pensa à un hélicoptère ou un autre engin aérien inconnu. Quelques minutes plus tard, un plus petit objet sombre apparut dessous et fut absorbé par le plus gros. Puis, l’objet complet se sépara. En-dessous, une sorte de créature sombre avec une « cape », au-dessus, une créature « ailée » se balançant comme un pendule. Au bout de quelques minutes, le plus petit corps sombre s’échappa de la créature « capée » et s’envola derrière une montagne. Les 2 corps restants se joignirent puis disparurent à l’horizon. Cet incident, resté inexpliqué, est connu comme « la réunion d’entités dans le ciel ». En 2005, de nouveaux cas furent signalés, notamment le 17 juin où deux personnes aperçurent un grand humanoïde sombre volant en les regardant d’une façon menaçante. L’humanoïde portait à la taille un appareil émettant une lumière rouge.



 <=
observations US 1999-2004
<=
observations US 1999-2004
© Ed Sherwood
J’ai tenu à montrer par ces quelques lignes que la description que l’on faisait des « humanoïdes volants » en 1979 n’est plus tout à fait la même qu’aujourd’hui. Mais avons-nous affaire au même phénomène ? L’évolution des technologies humaines depuis 30 ans fait qu’il serait hasardeux de relier tous ces phénomènes. L’armée tenta très tôt de faire voler ses fantassins mais elle y renonça, probablement à cause du coût. En 2007, Yves Rossi, ancien pilote de l’armée suisse, fut le premier homme au monde à voler sous une aile de 3 mètres d’envergure, munie de réacteurs capables de le propulser durant 5mn à des vitesses allant jusqu’à 300 Km/h. L’armée sembla très intéressée… J’aurais aussi pu parler de Mothman (l’Homme-Phalène) et des événements de Point Pleasant (USA) en 1967 mais peut-être avons-nous tort de mettre tous les mystères de la planète au « broyeur soucoupique ». L’avenir dira si j’avais tort. Il est paradoxal de voir qu’alors que nous avons aujourd’hui de très nombreux témoignages vidéo, l’observation de Cussac, sans preuve de cette nature, reste une référence dans le domaine. Pour combien de temps ?



Le « Ludion » de Sud-Aviation (1967 - France)



Aerocycle – Fin des années 50…) Bell « Pogo » (Juin 1967 - US Army) Yves Rossi
(Le Fana de l’Aviation – Février 2001) (Jane’s all the world’s Aircraft 1967-68) (Direct Soir n°129 - 22/3/2007)
XV. Portrait robot


Gardons à l’esprit que, quoi qu’ait vu le témoin, l’apparence réelle de l’entité peut être très différente si celle-ci désire réellement se dissimuler.
Je vous donne un exemple.
Des entités du type représenté ci-dessous (à gauche) ont été observées par des enfants dans la banlieue de Belo Horizonte au Brésil, le 28 août 1963. Rappelons que l’observation de Cussac a eu lieu le 29 août 1967. Ces entités, au nombre de 4, étaient arrivées dans une sphère lumineuse de 3m à 3m50 de diamètre. Elles étaient vêtues de « tenues de plongée » légèrement gonflées et mesuraient environ 2m de haut (je signale au passage que la taille maximale d’un humanoïde est d’environ 3m et ne dépend quasiment pas de la gravité de la planète où il vit (34)).
Comment créer une créature ayant un œil au milieu du front ?
Le personnage ci-dessous (à droite) est issu du Monde de Narnia qui eut un grand succès au cinéma. Il a été réalisé en équipant d’un masque mécanisé un acteur de très grande taille. L’œil, les paupières et la bouche étaient animés à distance par radiocommande. Quant à l’acteur, il était complètement aveugle sous le masque. Voilà déjà ce que nous arrivons à réaliser au XXIème siècle. Pas mal !... Alors, que pensez-vous que nos hypothétiques visiteurs puissent faire avec une technologie bien supérieure ?



28 août 1963 Narnia/ S.F.X. Février-Mars 2006
 Dessin
de R.Robé
Dessin
de R.Robé

Exemples de casques avec « barbes» créés dix ans plus tard par le réalisateur Georges Lucas pour la saga StarWars.
Madame Godelieve Van Overmeire qui a créé un mini catalogue chronologique des observations OVNI déclare sur internet : « De 1940 à 2000, il y a eu 1 713 cas de rencontres par au moins 2 356 témoins de 5 196 humanoïdes ou apparentés représentant au moins 200 ethnies différentes »
Cela semble impossible, sauf si tout n’est qu’apparence…
XVI. Archéologie
Il était possible qu’un hélicoptère se soit posé à Cussac après avoir repéré des traces de vestiges archéologiques. En faisant quelques recherches, j’appris que la commune possédait un monument historique, l’église paroissiale inscrite par arrêté du 30 décembre 1988 ainsi que le dolmen d’Alleuzet, situé sur la commune des Ternes. M. Lionel Mottin (35) , architecte des bâtiments de France, précise à ce sujet « qu’il existe de nombreux témoignages attestant une présence humaine ancienne aussi bien dans le mode de sépulture que dans la gestion de l’espace et la dénomination des lieux. Les découvertes du sous-sol liées à la réalisation de l’autoroute A71 ont montré combien la région Auvergne était couverte de zones archéologiques riches. ». Il n’y avait par contre pas d’informations sur le « tumulus » indiqué sur le plan paru dans Les Mystères de l’est n°2 (page 16/24). Ce tumulus n’était pas situé très loin du pré de l’observation. Il est regrettable qu’Eric Maillot n’ait pas pensé à se rendre à la mairie ou à interroger à l’agriculteur qu’il avait rencontré en 2004. Je décidai d’appeler le maire en prétextant des recherches archéologiques sur le secteur. Ce dernier me confirma la présence d’un artefact mais entre Cussac et Lascols et d’un autre entre Cussac et Mallesaignes, rien à l’ouest.
Thierry Rocher, membre du CNEGU, me précisa : « Le tumulus est bien visible (près du carrefour de la D57 et de la D56) ) sur la carte IGN au 1/25000e n°2536 Ouest série bleue. La carte a été réalisée en 1971 et révisée en 1991. Troisième édition / 11-1993...». Eric Maillot ajouta : «Sur site, en 2004, nous avons vu ce tumulus, de loin, là où la carte IGN 1/25000 l'indique. Nous n'avons pas eu le temps d'aller l'examiner (pour vérifier si archéo ou "moderne") ni de rechercher un passé archéo ou pas du site. Ceci relève de toute manière du boulot d'investigation scientifique, financé sur fond publics, du GEPAN/SEPRA/GEIPAN... Et ce sont des amateurs comme (toi et moi) qui font les recherches et vérifs à leur place…»
De son coté, Alain Delmon me conseilla un site internet : « Selon ce catalogue d'artefacts mégalithiques:http://www.t4t35.fr/Megalithes/AfficheResultat.aspx?Projet=France&Departement=Cantal.




Cussac Artefacts
Il s'agit du Tumulus de Reverjats Coordonnées : N44.98173 E2.917 LAT LON DEG (Vu carte 25:000) Zoomer sur la carte Google. A priori donc "archéo", et non moderne »
Il n’y avait donc pas d’erreur. Le site mentionnait aussi le Menhir de Bargueyrac à l’est et le fameux dolmen d’Alleuzet au Nord-Ouest. Rien d’autre. Le maire avait dû oublier le tumulus ou peut- être était-il moins connu. Alain Delmon avait aussi contacté M. Jacques Dassié, un expert et pionnier de cette discipline (où l’on photographiait parfois d’une main, tout en pilotant de l’autre) qui a accepté de répondre à quelques questions :
Question : « Bonjour M. Dassié. Je vous contacte pour un point mineur, ayant trait aux débuts de cette discipline (1967) : sauriez-vous me dire si des hélicoptères ont pu être utilisés autrefois (1967) au lieu d'avions ? »
Réponse : « Je
ne le pense pas. A ma connaissance, une seule personne en
effectuait vers
1970, le colonel Louis Monguilan, qui
dirigeait les hélicoptères militaires de l'ALAT, je
crois. Et au cours de ses missions en Provence, il s'intéressait
à ce qu'il voyait et a commencé à faire des
découvertes. Dans le civil, l'hélicoptère,
du fait de son coût dix fois supérieur à
celui
de l'avion, n'est pas utilisé pour la prospection
archéologique. »
(Remarque perso : l’avion était aussi moins sujet aux vibrations, nuisibles aux prises de vue)
Question : « De
quand datent les premières prospections aériennes
en Auvergne, plus
précisément dans le Cantal ? Y
en avait-il en 1967 ? »
Réponse : « Je l'ignore totalement, mais il n'y en avait probablement pas. Je pense qu'en 1967 il y avait Roger Agache, dans le Nord, et moi en Charentes (mes premières découvertes datent de 1962), avec D. Jalmain, en région parisienne. »
Question : « De quand date la tutelle du Ministère de l'Agriculture ? »
Réponse : « A
ma connaissance il n'y a aucune tutelle du Ministère de
l'Agriculture
jusqu'à ce jour ! »
Question : « S'agissait-il encore à l'époque de "fous volants" opérant seuls ? »
Réponse : « Je n'ai jamais eu l'impression d'être un "fou volant", mais plutôt un chercheur scientifique, un défricheur, qui avançait en "terra incognita". J'ai eu volontairement, dès 1962, des contacts avec la Direction Régionale des Antiquités préhistoriques de la région. J'ai été accueilli avec sympathie, intérêt et un peu de curiosité, comme si un martien avait débarqué. Ils ont enregistré les dossiers de sites que je leur communiquais. Il n'y avait pas de réglementation particulière et ils appliquaient les textes généraux qui précisaient que toute découverte à caractère archéologique doit être signalée aux autorités compétentes. Les choses se sont organisées vers les années 75-80 quand ces Directions Régionales sont devenues les Services Régionaux de l'Archéologie (coordonnées sur mon site). »
Question : « La
prospection aérienne se fait-elle généralement
seul, à deux (pilote +
photographe ?), à 3 ou
plus ? »
Réponse : « Si
le prospecteur est également pilote, c'est la solution de
rêve, garantissant liberté et indépendance.
J'apprécie beaucoup cette position ! Plus généralement,
les prospecteurs (toujours privés et bénévoles)
louent un avion avec son pilote à l'aéroclub du
coin. Il n'y a qu'une exception, celle du Department of Survey de
la Cambridge University (Angleterre). Il ont un avion bimoteur
push-pull (Cessna 337), deux équipages avec pilote,
navigateur, photographe et archéologue, chef de
mission
! Je vous laisse supposer le budget annuel d'une telle
entreprise, pour des résultats excellents, certes, mais
pas supérieurs aux nôtres, puisque, à
Londres, en 2000, mes photos ont fait sensation au cours du
Colloque mondial du néolithique et que le British Museum
m'a acheté des photos pour la couverture des Actes de ce
colloque ! (PJ) »
Question : «…J'ai cru comprendre sur votre site et celui du Ministère que la recherche se faisait en hiver, voire au printemps, mais pas en été, pour des questions de meilleure visibilité des signes au sol. Est-ce exact ? »
Réponse : « Je ne saurais répondre pour le Ministère. Pour moi, si vous aviez bien visité mon site, vous auriez pu voir, dans le Menu principal, un lien intitulé "Visibilité indices et climatologie". Vous y auriez trouvé un tableau donnant les "Périodes de meilleure visibilité des indices photographiques en Charentes", avec toutes les courbes scientifiques que vous pouvez souhaiter. Les carences des découvertes estivales s'expliquent fort logiquement : la majorité des découvertes s'effectuant dans les champs de céréales, après les moissons, toutes les traces ont disparu. Il n'y a plus rien à voir »
Question : « Ou bien à cette époque (1967), cherchait-on en fait tout au long de l'année ? Drôle de question me direz vous. J'enquête à titre privé (mon hobby) sur un vieux cas d'OVNI, datant d'août 1967,et pour lequel je cherche à vérifier s'il n'y a pas eu méprise avec un hélicoptère de prospection archéologique avec son équipage de 4 personnes. »
Réponse : « Il est certain que, mettant au point une méthodologie de la prospection archéologique aérienne, il m'importait d'expérimenter tout au long de l'année, pendant plusieurs années. Dans le Nord, pour Agache, il observait principalement des remontées de matériaux par les nouveaux labours profonds, donc l'hiver. La végétation lui cachait plutôt ces indices… J’en conclus seulement que vous ne connaissez pas mon bouquin. Dans la bibliographie de mon site : le "Manuel d'Archéologie Aérienne" Ou chez l'éditeur : http://editionstechnip.com/ Ou chez Alapage.com en recherchant Dassié. Il n'existe pas et il n'existait pas de tels moyens. Merci de votre intérêt. Cordialement, Jacques DASSIÉ»
J’ai néanmoins trouvé une exception dans les archives de l’escadron d’hélicoptère 2/68 « Maurienne ». Le 7 août 1967, un hélicoptère (modèle inconnu, équipage militaire : 2) et chargé de prendre des photos au-dessus de Voglans Gresy s/Aix (Savoie) et dans la région d’Artemare (Ain) au profit d’un groupe archéologique à la recherche de vestiges de la civilisation gallo-romaine. Rien à signaler le 29 août 1967 dans le Cantal. De toute façon, comme nous l’avons vu précédemment, il n’y avait rien de particulier dans le pré qui nous intéresse qui puisse expliquer que l’on s’y pose.
A lire : L’Archéologue n°95 Avril-Mai 2008 sur les Arvernes, peuple celtique d’Auvergne
XVII. Influences
A/ Le cinéma et la télévision
L’année de l'observation sortait dans les salles un film qui mettait en scène « un hélicoptère et des hommes en noir » : Fantômas contre Scotland Yard ! Ce n'était pas la première fois que l'on pouvait voir cette association au cinéma: déjà en 1964, on retrouvait le célèbre commissaire Juve et le journaliste Fandor aux prises avec l'insaisissable malfaiteur et ses « hommes en noir ». L'hélicoptère (nettement visible sur les affiches) était une ALOUETTE II (n°1394, type SE 3130 immatriculée F-BLOH). Fantomas reviendra un an plus tard dans Fantômas se déchaîne (où l’on aperçoit ses hommes habillés en « hommes grenouilles »). On peut se demander si les enfants n’avaient pas eu l'occasion de voir au moins les deux premiers films ? Ils auraient aussi pu avoir déjà vu Le grand restaurant (1966) avec une Alouette III (n°1100, type SE3160 immatriculée F-BLOO). Il y aura une autre Alouette dans « le Tatoué » (1968) qui a été tourné en Dordogne. Jean Marais, Bernard Blier et surtout Louis de Funès jouaient pour le grand public et la presse de l’époque a dû s’en faire l’écho ! On pouvait aussi voir des hélicoptères sur les affiches de cinéma (ci-dessous, en 1960, Le Monde Perdu). Le maire de Cussac, propriétaire terrien, avait indiscutablement les moyens de payer le cinéma à ses enfants. Il n’y avait pas de salle dans le village mais la section cinéma de l’amicale laïque était très active dans ce secteur. Les projections avaient lieu dans une salle de café ou à l’école. La ville la plus proche - St Flour - a connu quant à elle sa première séance dès 1906 grâce à un cinématographe ambulant. Par la suite, les cinémas s’y succédèrent (voir en annexe 16). En 1966, on pouvait voir un film au Rex, au Coucou, au Cinévox, au Cine-Club, à l’amicale laïque, ou alors au cinéma de l’abbé Chabaud. La même année, à l’occasion du tournage du film Un homme de trop par Costa Gavras, le Cinevox reçut techniciens et acteurs pour visionner les rushes de la journée. Aujourd’hui, le Musée de la Haute Auvergne distribue une brochure dont l’impression a été gracieusement prise en charge par la Dépêche d’Auvergne. Elle s’intitule « 90 ans de cinéma à Saint-Flour ». Une bien belle histoire. On peut imaginer ce qu’aurait pu dire l’un des enfants en reconnaissant une Alouette: « Oh ! Les hommes de Fantômas, comme au cinéma ! »



On peut difficilement ne pas parler de la série mythique Le Prisonnier, qui mêle Alouette et « boule » mystérieuse (le rôdeur). L'Alouette II (F-BNKZ) est arrivée à Portmeirion (le vrai nom du Village au Pays de Galles) le 14 Septembre 1966 et elle servit pour la plupart des scènes aériennes de la série. Elle appartenait à la société Héli-Union et dans de nombreuses scènes on peut voir la flamme Héli-Union à côté du logo de la série "The Penny Farthing". Le 16 Janvier 1967, elle fut rachetée par RBA Helicopters et changea d'immatriculation en devenant G-AVEE. Pour l'épisode "Schizoid Man", la G-AVEE était indisponible et ce fut la F-BOEH également propriété d'Héli-Union qui fut utilisée pour ce tournage. Les épisodes furent diffusés à l’origine en ordre dispersé sur les chaînes locales britanniques. La transmission du premier épisode (Arrival) eut lieu entre le 29 septembre 1967 (ATV Midlands, Grampian) et le 27 octobre 1967 (Granada). Le dimanche 18 février 1968, 1ère diffusion de « L'Arrivée » en France, à 18 heures 50 sur la 2ème chaîne. C’est trop tard pour Cussac, mais, pour les fans, voici deux photos (merci à Pierre Gillard)


L’acteur Patrick Mc Goohan à droite près de l’appareil Le n°6 (Le Prisonnier) face à l’Alouette et au « rôdeur »
Sphère
On ne trouve quasiment aucune représentation au cinéma de « machine » comme celle décrite par les témoins si ce n’est dans le film intitulé Sphère de Barry Levinson. L’envol de la sphère, même s’il est différent de celui décrit par les témoins, reste très impressionnant. On peut imaginer ce que peut vivre une personne qui verrait ce genre de scène. Le film est sorti en salle le 25 mars 1998. On y trouve aussi des plongeurs et même un hélicoptère qui croise la sphère. Le film traite de façon très subtile de la vie extraterrestre (même si on ne voit jamais d’humanoïde) et du voyage dans le temps…

Hommes en noir et sphère
J’ai pu voir le 8 février 2007, sur la chaîne France 4, un épisode de la série anglaise Doctor Who (Science Fiction) où des envahisseurs venant d’une autre dimension apparaissent dans un premier temps sous forme d’ombres (noires). Ils ont traversé les dimensions en suivant « une sphère » (totalement lisse) qui plane au-dessus du sol. On voit dans l’épisode qui suit (en 2 parties) d’autres voyageurs inter-dimensionnels à l’apparence humaine et habillés de sortes de tenue de plongeurs noires. Cette série a dû être tournée en 2006.
B/ La Bande dessinée
Lors de mon passage à la Bibliothèque Nationale de France, j’ai eu l’occasion de voir près de l’article sur Cussac de Paris Jour (du 2-3/9/1967) des «strips », des bandes dessinées composées de 3 ou 4 images, à suivre. Dans ce numéro, on pouvait voir sur la même page « Superman », « Tarzan », « Paul Temple » et « Guy l’Eclair » (adaptation française des aventures de Flash Gordon). Je m’attarderai surtout sur le personnage de Superman (créateurs Siegel et Shuster, 1938), synthèse du genre policier et du fantastique. On le retrouve aussi dans le Progrès de Lyon de septembre 1967. Superman est un extraterrestre, il porte des bottes et il vole parfois avec les bras le long du corps, mais la comparaison avec les inconnus de Cussac s’arrête là. Sa tenue n’est pas sombre et il possède une cape. Les témoins n’ont jamais comparé le déplacement des inconnus au vol du super héros Superman, ils n’utilisent pas à l’époque le terme « voler ». Ces journaux ne semblaient d’ailleurs pas être lus chez M. DH qui préférait probablement un journal plus religieux (et local) comme la Voix du Cantal (appelé La Croix du Cantal de 1892 à 1944). Dans chaque numéro, en couverture (côté gauche), une représentation du Christ sur la croix et le texte : « Par ce signe tu vaincras ». Ce journal, que j’ai eu l’occasion de feuilleter, s’était interrompu pendant l’été (le samedi 12 août) pour reprendre début septembre 1967 sans aucune allusion au cas de Cussac. On n’y voit aucune bande dessinée et les seules allusions au mystère sont éloignées du sujet OVNI (« les mystères des couvents » le 16/9 et « la bête du Gévaudan » le 21/10/67). La même année débute dans le journal Tintin les aventures de Luc Orient. On y rencontre, à l’inverse de l’observation de Cussac, des humanoïdes « albinos » utilisant de classique soucoupes volantes. Le Journal de Mickey fait la publicité du petit scaphandrier « blanc » du Cosmoschtroumpf dans le n°782 du 21 mai 1967 et un hélicoptère est visible aux pages 24 à 26 du n° 754 du 6 novembre 1966 ainsi qu’à la page 15 du n° 784 du 4 juin 1967.
On trouve dans Les 7 boules de cristal (Hergé – 1948) la célèbre scène du professeur Tournesol qui s’élève - alors qu’il est assis sur sa chaise – suite au déplacement en « spirale » de la foudre en « boule ». La comparaison s’arrête là, pas de machine ou d’inconnus dans cette histoire qui a le mérite de montrer un mouvement de spirale avec une forme qui fait penser à une sphère, sans évoquer nécessairement un hélicoptère.


sphère volante mais en 1979
Il existe dans les fascicules Météor, l’une des bandes dessinées les plus collectionnées des éditions Artima, une série d’aventures intitulée « la boule volante ». Elle va du n°151 (février 1967) au n°155 (Juin 1967). La plupart des exemplaires étant devenus introuvables, c’est grâce à un passionné de bande dessinée (36) et à l’ufologue Jean-Louis Peyraut que j’ai pu retrouver une illustration de cette fameuse « boule volante ». La boule volante est un engin spatial qui ressemble plus à un avion. L’histoire se déroule dans la jungle. Les héros explorent une île où il y a des hommes préhistoriques et des extra-terrestres. Apparemment, même si on a bien affaire à une sphère, celle-ci possède deux sortes d’ailerons, des antennes et une fenêtre visible à l’avant. Cela ne correspond pas à l’observation de Cussac. Il n’y avait de toute façon pas de boutique spécialisée (ou non) en BD de Science Fiction dans ce coin perdu du Cantal, mais je me devais néanmoins de vérifier cette possibilité.
En cherchant bien, on finira toujours par découvrir une histoire d’extraterrestres mettant en scène une (quasi) sphère ou un vaisseau spatial dans un pré, un super héros volant, mais personnellement, je n’ai rien trouvé qui rassemble tous les éléments du récit des témoins et qui soit antérieur à leur observation.


A gauche : La Boule Volante : « De Sérieux Alliés » - Météor n°156, page 33 (1967)
A droite : Monde Futur n°14 (Aredit 1974) => les extraordinaires aventures de la famille Rollinson, les « Robinson » de l’espace (Source Jean Louis Peyraut)
L’hélicoptère dans la B.D. en 1952-1954, avec, inclus, des images d’hélicoptère (Source Raoul Robé)


Une autre curiosité découverte dans Guerre à la Terre de Liquois et Marijac paru en 1945 dans Coq Hardy (réédité en 1975 chez Glénat). Raoul Robé me précise : « Il s'agit d'invasion martienne mais la sphère n'est pas volante-mais roulante (sorte de chars), une adaptation de la guerre des mondes: des météores tombent sur la terre et les martiens s'allient aux "mauvais" japonais (juste après 2e guerre mondiale) pour envahir la planète . Pas de SV, mais des sortes de yétis esclaves-soldats des forces martiennes... »



Mandrake dans Les Héros du Mystère n°6 (Août 1967) et n°17 (Juillet 1968) => Bell 47 J


Une aventure de Sandy le tigre de Tasmanie Benoît Brisefer
(Extraits du magazine Spirou n°1215 - Juillet 1961
J ouets
pour
les enfants en 2007
ouets
pour
les enfants en 2007


XVIII. Curiosités
les triangles mystérieux de l’Auvergne
a) « Le triangle de la Burle »
A 95 km de Cussac, à proximité du Puy-en-Velay, se trouve un endroit redouté des aviateurs, qu’on appelle le Pot-au-Noir. Le Pot-au-Noir forme un triangle qui va du Mont Mezenc (1 754m) vers le Tanargue (« la montagne du tonnerre ») et les gorges de l’Eyrieux. Les vieux grimoires y recensent des objets tombés du ciel. Plus près de nous, depuis la conquête des airs au début du siècle dernier, les catastrophes aériennes se succèdent. En janvier 1971, un appareil s’y écrase : parmi les 21 victimes, de nombreux militaires, dont le sous-chef d’Etat-Major des armées, et surtout sept des plus grands cerveaux du Commissariat à l’Energie Atomique. On parle de triangle, mais ses contours sont flous et englobent les contorsions de la Cévenne antique jusqu’au mont Pilat. C’est justement dans ce secteur que s’engagent, en mai 1987, un lieutenant colonel et deux officiers chevronnés de la 30e escadre de chasse de Reims. Ils n’en ressortent pas vivants. Les 3 Mirages s’écrasent à moins de 50 m d’un sommet. Attraction tellurique ou loi des séries ? L’endroit prédispose au mystère. Tables celtiques, dolmens et menhirs semblent posés là comme des signaux indiquant les limites à ne pas franchir. Pour ce qui nous concerne, de nombreux phénomènes lumineux y ont été observés à travers le temps. On peut d’ailleurs lire dans l’un des ouvrages de Jean Peyrard (37) que « l’éminent savant, Monsieur F. Lagarde, s’intéressa à cette affaire. Messieurs Chasseigne, François, Monnier et Ollier, informateurs de Lumières dans la Nuit, enquêtèrent. Il fut question de la déviation espace-temps, conduisant à une autre dimension… ». Si le titre de « savant » pour F. Lagarde prête à sourire, certaines histoires d’aéronefs, soi-disant en perdition dans le ciel du Velay, peuvent laisser perplexe. Peut-être y a-t-il un phénomène du même type que celui observé dans la vallée d’Hessdalen en Norvège (voir le documentaire sur CANAL + intitulé OVNI L’armée enquête), mais avec un trafic aérien très différent.
b) « Le triangle noir du Cantal »
En septembre 2002, le journal Cantal hebdo publie un article intitulé : « le satellite Spot mis en échec en Auvergne ». Depuis près de 20 ans, plusieurs satellites ont pris le même cliché : une tache sombre vaguement triangulaire. Elle masque quelques kilomètres carrés de terrain, à cheval sur les communes de Laroquevieille-sur-Alèze et Jussac. En avril 2003, la revue Science & Vie Junior (information transmise par JL. Peyraut) publie un article intitulé « le triangle noir du Cantal ». La revue se fait l’écho de la découverte faite par Rémy Larverne, du CNRS, qui a enquêté sur place. La zone baigne dans un champ plusieurs millions de fois supérieur au champ magnétique terrestre. L’intensité est estimée à 20 000 tesla. Les effets les plus marquants :
les appareils non protégés contre les champs magnétiques tombent en panne (portables, etc…)
le système digestif des vaches est perturbé…
les capteurs des caméras équipant les satellites sont saturés par ce champ magnétique bien supérieur à celui de la lumière. Ils affichent du noir.
Une remonté de magma pourrait être à l’origine du champ magnétique intense
J’ai contacté Thomas Lepoutre, journaliste de Science & Vie Junior qui n’a malheureusement pas pu m'en dire plus sur l’évolution de cette enquête. Le magazine n’a plus les coordonnées de M. Larverne. Son nom n'apparaît pas non plus dans l'annuaire de direction du CNRS. Il n'a donc probablement pas un poste très élevé. Si on consulte les images satellites (IGN) des pages jaunes, on ne voit rien de particulier. Le CNRS a-t-il réussi à trouver une parade ? (38)

Un mystérieux objet métallique
J’ai découvert par hasard dans la Dépêche d’Auvergne du 22 août 1967 un article signalant qu’une masse métallique de 3,6 Kg avait été découverte à Chanceaux en Côte-d’or. Les protubérances pourraient avoir été causées par une fusion à très haute température des métaux (du fer notamment). Débris de satellite ou météorite ?
XIX. Représentation étrange « d’homme barbu » dans l’histoire
1. Homme barbu, civilisation de Nagada I (Amratien) Ve – VIe millénaire avant J-C. (calcaire noir), Egypte
2. Statue « d’homme barbu », Période prédynastique, Nagada I (Amratien), 4000 – 3500 avant J-C, Egypte. Cette statuette avait un rôle funéraire, sans que l’on sache bien lequel. Représentation d’homme ou de divinité ?
Après un an d’enquête, j’ai acquis la conviction que les enfants ont bien cru vivre un événement inexplicable. Nous avons vu que contrairement à certaines idées reçues, les premiers ufologues qui se sont déplacés n’ont pas influencé les enfants. Je n’ai d’ailleurs rien trouvé qui aurait pu les influencer à l’époque. Le père des enfants n’a quant à lui pas recherché la publicité. Il n’a fait que suivre les consignes qu’il avait en sa possession en tant que maire. De même, c’est un ufologue, Claude de St Etienne, qui l’informa du cas d’Arc-sous-Cicon, et cela bien après l’observation de Cussac. Nous avons aussi vu que la presse a cherché, comme souvent, le sensationnel. Le fait qu’un seul journal (La Montagne) donne à l’OVNI une dimension différente peut sous-entendre qu’il avait la volonté de coller avec une certaine vision du phénomène. En effet, une « soucoupe » volante se doit être plus large que haut (sois par exemple 4m de large sur 2 de haut). Un article non dépourvu d’erreur qui ne fut guère apprécié par la famille du témoin. Personne ne s’en étonne. Si néanmoins ce document était à verser au dossier, il ne faudrait pas écarter le fait que ce même article indique que personne aux alentours n’a rien entendu, et qu’un hélicoptère est loin d’être silencieux (et invisible) en 1967. Concernant la vue des témoins, il est bon de préciser qu’il existe des personnes avec des yeux bleus qui n’ont jamais eu aucun problème. Les personnes aux yeux clairs ont souvent les tissus moins pigmentés (pareil pour la rétine) mais pas plus fragiles (fait confirmé par un ophtalmologiste). C’est là que réside peut être une partie de l’explication sur l’éblouissement. Les enfants DH ont-ils les yeux clairs ou foncés ? Je pense qu’ils ont néanmoins pu mémoriser de nombreux petits détails bien avant que la luminosité - probablement pour des raisons naturelles - ne devienne insupportable. Pour ce qui est de l’enquête du G.E.P.A.N. , je n’exclus pas totalement qu’au moins un des témoin ait eu encore à l’esprit les dessins de la revue du G.E.P.A. lorsqu’il répondit aux enquêteurs en 1978. Cela a pu fausser partiellement la reconstitution des faits. Cette reconstitution trop tardive amena aussi C. Poher à tirer des conclusions exagérées sur la « machine ». Néanmoins, cela ne doit pas remettre en cause le travail déjà effectué par ceux qui l’ont précédé. Le témoignage transmis par courrier au G.E.P.A avant le déplacement des enquêteurs nous donne suffisamment d’informations pour que l’observation garde un caractère étrange. En 40 ans, les lieux ont malheureusement bien changé et ne peuvent plus nous apprendre grand-chose. Je n’ai rien trouvé dans la région qui puisse vraiment être mis en parallèle avec cette observation mais il y a eu d’autres cas dans le monde qui nous amènent à nous poser des questions. Si nous nous penchons néanmoins sur l’hypothèse hélicoptère, on peut écarter l’Alouette III et le Bell 47J notamment à cause de la poutre de queue beaucoup trop visible. Le seul Bell 47J (J3) qui avait les caractéristiques techniques nécessaires pour décoller de Cussac se trouvait à Bordeaux. De même, il semble que le pilote d’une Alouette II n’aurait pas eu le temps nécessaire pour démarrer sa machine et décoller dans le laps de temps donné par les témoins. Un appareil qui aurait apparemment manœuvré dans un pré occupé par du bétail, ce qui est déjà inhabituel, alors qu’il disposait d’une autre surface (vide) dans le même pré ? On peut penser à un besoin de se dissimuler. Il n’y avait pourtant rien à espionner dans le Cantal. Le fait que les enfants ne mentionnent pas le ronflement, le vrombissement caractéristique d’un hélicoptère, l’absence d’effets visibles sur l’environnement lors du décollage, est aussi anormal. Le rapport de taille Machine/Inconnu ne peut correspondre à celui d’une Alouette (ou un Bell 47J) avec un être humain. Par ailleurs, je n’ai trouvé aucun document dans les archives militaires signalant un quelconque incident ayant obligé un hélicoptère à se poser à Cussac. D’autre part, j’ai eu confirmation que cette région était située trop loin des zones retenues pour les forces de manœuvre. La psychologie actuelle de F. DH n’est quant à elle pas liée aux problèmes médicaux qui perturbèrent sa jeunesse. Les responsables sont à chercher parmi les personnes (dont des ufologues) qui lui demandèrent de revivre épisodiquement les événements. Il s’est effectivement rendu à des réunions d’ufologues par le passé pour témoigner de son observation mais cela s’arrête là. Aujourd’hui, il fuit autant que possible ce milieu. Ces conclusions n’engagent que moi. Je laisse à d’autres enquêteurs le loisir de poursuivre les recherches s’ils le désirent.
=> L’hypothèse exotique émise en 2007 :
Finalement, comment définissons-nous le plus souvent les « ufonautes »?
Ils sont en général « humanoïdes »
Ils ont déjà été observés avec des humains et en ont parfois pris l’aspect (« grand blond »,etc.)
Ils n’apparaissent que brièvement, refusent le « grand » contact
Ils peuvent être violents (enlèvements inclus…) et auraient eu parfois des rapports sexuels avec des humains dans le but avoué de créer la vie (hybridation ?)
Ils utilisent des moyens de transport de forme différente (dont mimétisme ?)
Ils ont des moyens de transport qui semblent parfois devancer de peu nos propres découvertes
Ils délivrent des messages qui ne veulent rien dire, de fausses prédictions, ils nous mentent
Certains pensent qu’on les retrouve dans notre histoire, d’autres pensent que les auteurs de Science Fiction les ont imaginés avant qu’ils n’apparaissent « réellement »
On parle d’ « hommes » en noir, de manipulation, de spectacle…
Des « célèbres contactés » ont-ils eux aussi été manipulés, puis ont-ils fini par en profiter ?
Jacques Vallée donna en 1989 cinq arguments (40) contre l’origine extraterrestre des O.V.N.I.
Joël Mesnard ne semble plus croire à cette hypothèse. Le Physicien Enrico Fermi, auteur du paradoxe du même nom, ne croyait pas que les OVNI soient des vaisseaux extraterrestres. L’astronome Carl Sagan avant de mourir envisageait une autre solution… Et si nous avions à faire à des humains ? J’ajouterai à son hypothèse : un peu différents d’aspect (parfois barbus ?), plus intelligents, toujours aussi manipulateurs et menteurs! Ils se servent de notre culture, de son histoire… L’homme de demain ! Les pieds palmés, les « bibendums », peau verte, (etc.), un simple « artifice » pour une mise en scène… à la façon des jeux de télé-réalité ? (41). Cette hypothèse ne plaît généralement pas aux ufologues car ils se doutent qu’il n’y aura jamais de contact et que « l’adversaire » aura le plus souvent, à moins d’un accident, une longueur d’avance. C’est pourtant l’une des très rares hypothèses qui prennent en compte l’ensemble des manifestations du phénomène. Cette hypothèse ne séduit pas plus les sceptiques car ils aiment travailler sur du concret et non anticiper d’éventuelles découvertes qu’ils ne verront d’ailleurs pas de leur vivant. Il est néanmoins rassurant de constater qu’il leur arrive de faire aussi des observations qu’ils n’expliquent pas (42). Le temps est un concept plus difficile à appréhender qu’il n’y paraît. J’ai conscience que tout ceci peut paraître utopique mais cela ne l’est pas plus que ne l’était l’existence des trous noirs à une certaine époque. Déjà à la fin du XVIIIe siècle, le révérend John Michell et le mathématicien Pierre Simon de Laplace, pressentent l’aptitude des astres les plus massifs de l’Univers à ne pas laisser échapper la lumière. Mise au rancart au XIXe siècle, l’idée revient en 1915 lorsque Albert Einstein publie sa théorie de la relativité générale. En 1939, Robert Oppenheimer et ses étudiants publient les premiers calculs montrant comment l’effondrement d’un cœur stellaire peut conduire à la formation d’un trou noir. Mais faute d’avoir isolé le moindre site cosmique susceptible d’en attester l’existence, bien des physiciens sont tentés de croire que de tels objets ne seraient en définitive que pure création de l’esprit. Il faudra attendre les observations pour que le nom de trou noir soit donné par le physicien John Wheeler… en 1967. Pour en revenir au sujet qui nous intéresse, je vous encourage à lire Comment construire une machine à explorer le temps ? de Paul Davies (éditions EDP) ou à suivre les expériences du Large Hadron Collider (Ciel & espace n°455). Les premiers « voyageurs » seront peut être asiatiques. On peut le penser au regard des premiers humanoïdes souvent comparés pour leurs yeux, à des « chinois ». Cela n’a rien d’étonnant lorsque l’on regarde l’emprise toujours croissante des pays émergents (43). Quant aux besoins financiers liés à ce type de recherche, cela ne devrait pas poser de problèmes. On trouve déjà de doux dingues prêts à investir tout azimut. Prenons par exemple l’homme d’affaires Bigelow, propriétaire d’une chaîne d’hôtels à Las Vegas, qui s’est lancé dans le tourisme 3ème type. Ce passionné de soucoupes volantes et de phénomènes paranormaux a fondé sa propre agence spatiale, Bigelow Aerospace, spécialisée dans l’hôtellerie sur orbite (44). C’est un milliardaire dont les gardes du corps ont un alien floqué sur leur veston. Il a racheté les droits d’exploitation d’un système de structures gonflables conçues par la N.A.S.A. dans son programme Transhab au début des années 90 et veut construire des hôtels qui n’ont rien de bidon. Que s’est-il finalement passé à Cussac ? Imaginons que les hommes de l’avenir avaient déjà connaissance de l’événement. Un événement que « nous » avions rapporté. Etaient-ils là en exploration ou pour assurer un « spectacle » ? Il est possible que le témoin ait été amené à prendre une décision lors de sa carrière (d’avocat et de maire) qu’il n’aurait pas prise s’il n’avait pas vécu l’événement de Cussac. Cette décision a peut être eu des répercussions que nous ne pouvons pas percevoir à court terme. Les possibilités ne manquent pas…
=> Autre époque, autre hypothèse ...
Quatre ans plus tard, une autre observation est portée à ma connaissance et m’amène à revoir mes conclusions. Pour des raisons de confidentialité, il ne m’est malheureusement pas possible de raconter cette histoire. Sachez néanmoins qu’il s’agit de trois observations différentes effectuées par plusieurs témoins dans un laps de temps relativement court. Le hasard fait qu’au moment où l’on me communique cette affaire, je viens de terminer la lecture d’une histoire de science-fiction. L’auteur imagine une planète peuplée de diverses races d’extraterrestres y ayant échoué suite à un phénomène spatial inconnu. N’ayant plus de vaisseau pour la quitter, ils essaient de survivre dans ce monde hostile. Dans notre réalité, les entités ne restent pas sur Terre. Leur apparition est-elle due à un effet secondaire de leur mode de propulsion ? Un bref arrêt avant de « rebondir » vers une destination lointaine ? Un peu comme dans un « flipper galactique » ? Nous avons le même objectif lorsque nous cherchons à donner une impulsion supplémentaire à nos sondes d’exploration du système solaire : aller plus loin en consommant le moins d’énergie possible. Imaginons que la Terre ne soit pas la destination finale. Que ce soit juste un accident de parcours ou un arrêt sur le bord de « l’autoroute » de l’infini. Un « passage » qui s’effectue peut-être par une brèche passagère - une anomalie spatiale ou temporelle - entre les dimensions ou d’autres réalités. Un passage qui s’ouvre parfois pendant un laps de temps trop court pour qu’un véritable contact puisse s’effectuer entre nous. Parfois, le voyage est interrompu. Pour chaque équipage, c’est alors la première exploration du bord de l’autoroute ...
Je vous laisse réfléchir à ces deux hypothèses.
Rédaction Jean-Marc Gillot le 22 juin 2008
Mise à jour le 1er novembre 2012 (version allégée pour raison de confidentialité)
Correction Diane DENIE
=> Place N 83 puis N 6 (pour le papier) :
. La Croix du Cantal => La Voix du cantal (ISSN 1148 – 4764) publication : Aurillac Cote : JO – 13045 Détail : 1967-69
. Mouvement de libération nationale - Le Franc tireur => «Paris jour » Cote : GR FOL-LC2-6704 Détail 16/8 au 30/9/1967
. Hebdo Edition de Toulouse Cote : FOL-JO-14974 Détail : 18 Mai à Juin 1968 (impossibilité d’obtenir plus de numéros ?)
. La Dépêche d’Auvergne Cote : GR FOL-JO-4410 Détail : 1966-1968 (parution le mardi & vendredi)
. Le Montagnard Cote : GR FOL-JO-5500. Le journal ne paraît que le vendredi et est en vacances entre le n°27 du 14 juillet et le n°28 du 8 septembre.
. La Montagne (Ed. de Clermont Ferrand) Cote JO-92912. Le journal était non communicable le 8 juin 2007 car en cours de dépoussiérage (pour une durée indéterminée..). Il a été mis en partie sur microfilm 35 mm => MICR D-342 mais de 1979 à 1980. En 2008, il était "hors d’usage" (?).
=> Place O95 (Microfilm) :
. Le Progrès publication : Lyon Cote : MICR D-232 Détail : 1er au 30 septembre 1967
. Cotes des archives communiquées par le Service Historique de la Défense
N° de lecteur : 13908
A/ Département de la Gendarmerie Nationale (DGN) le 16 avril et le 24 octobre 2007, le 18 janvier 2008
Cote n°105, registre du journal des services aériens (R.J.S.A.) de la section aérienne (S.A.) Lyon-Bron (1957-1970)
Cote n°175, les rapports des officiers (R/4 PO) de la S.A. de Hyères (1966-1981)
Cotes n°183 et 184, R.J.S.A. de la S.A.de Hyères (1965-1967)
Cote n°195, les rapports (R/2) de la section aérienne de la Haute-Vienne Limoges (1966-1967)
Cote n°203, R.J.S.A. de la Haute-Vienne Limoges (1964-1970)
Cote n°245, les rapports (R/2) de la division aérienne (D.A.) de Montpellier (1964-1967)
Cote n°260, R.J.S.A. de la D.A.de Montpellier (1966-1974)
Cote inconnue, journal des marches et opérations (J.M.O) de la D.A.de Montpellier pour 1967
Cote n°364, J.M.O. de Toulouse (1957-1967)
Cote n°367, les rapports (R/2) de Toulouse (1966-1967)
Cote n°376, les rapports (R/4) de Toulouse (1963-1967)
Cotes n°571 et 572, les rapports (R/2) de G.S.T.(Technique) de le Blanc (1966-1967)
Cote n°605, les rapports (R/4) de G.S.T. de le Blanc (1958-1977)
Cote n°608, les rapports des officiers (R/4 PO) de G.S.T. de le Blanc (1960-1983)
Cote n°609, les incidents aériens de G.S.T. de le Blanc (1965-1975)
Cote n°612, les incidents aériens de G.S.T. de le Blanc (1967-1969)
Cote n°617, R.J.S.A. de G.S.T. de le Blanc (1966-1969)
Cote inconnue, carnets de bord de 22 hélicoptères Alouette (pour le 29/8/1967)
Cote n° 53153, les rapports (R/2 et R/4) ainsi que les procès verbaux (dont PV accident) de la Brigade Territoriale (B.T.) de Neuveglise pour l’année 1967.
Cote n° 53158, les rapports (R/2 et R/4) ainsi que les procès verbaux de la Brigade Territoriale de St Flour pour l’année 1967.
Cote n° 53159, lettres et procès verbaux accident de la Brigade Territorial de St Flour pour 1967.
Cotes n°55386 à 55388, R/2 du groupement (G.R.P.T.) de Limoges pour 1967 (normalement, ne concerne pas le secteur aérien mais je le demandais à tout hasard).
Demande non agréée pour les dossiers cotés 175, 376, 605, 608-609, 612 et les carnets de bord
B/ Département de l’Armée de l’Air (DAA) le 7 et 14 juin, 5 et 24 juillet, 7 et 14 novembre 2007
Livres : Archives de la présidence de la République – Georges Pompidou (U 016 Série AD)
Jane’s all the World’s Aircraft 1966-1967 (U 410)
Avions et Hélicoptères militaires d’Aujourd’hui de Pierre Gaillard - Edit. Larivière (U 420-6)
Hélicoptères militaires de Patrick Facon (U 420 - 29)
L’Armée de l’Air - des avions et des hommes (U 530)
Les insignes des bases aériennes – SHAA – de Bernard Thevenet (U 530 – 9)
Guide : Dossiers accidents aériens 1958-1989, volume 3 (100 E), Hélicoptères (volume 25 série G)
BA = Base aérienne / E.H. = Escadron d’hélicoptère/ C.I.E.H. = Centre Instruction Equipages Hélico
COTA = Cahier d’ordre et de travail aérien /
CRMSA = Compte-rendu mensuel de situation et d’activité aérienne
=> BA 107 Villacoublay
. Cote F.9512, Registre journal du CLA du 8/4/67 au 24/10/67
. E.H. 03.067 « Parisis »
Cote G.5430, Journal des marches et opérations du 1/10/64 au 31/12/77
=> BA 114 Aix les Milles
. Cote F 8975, registre journal du CLA du 21/5/65 au 24/11/67
. Cote F 8977, Journal des marches et opérations du 1/1/66 au 31/12/68
=> BA 115 Orange-Caritat
. Cote F.11724, registre journal du CLA du 12/3/66 au 15/5/68
=> BA 119 Pau - E.H. 1/68 « Pyrénées »
Cote G.5426, Journal des marches et opérations du 1/9/64 au 31/12/69
Cote G 040, 5 COTA (un seul consulté => du 1/7/67 au 29/12/67)
Cote G 0473, COTA (DPH Cazaux) du 25/4/67 au 7/8/68
Cote GO.11386, COTA (détachement Cazaux) du 8/3/67 au 12/4/75
Cote G 11033, CRMSA du 1/1/67 au 30/9/70
=> BA 128 Metz « Valmy »
Cote G.5431, Journal des marches et opérations du 1/1/64 au 31/12/80
Cote GO.2448, COTA (DPH 2/67 - détachement Colmar) du 24/08/67 au 16/05/68
Cote GO.2452, COTA (détachement Nancy) du 6/09/65 au 25/11/70
=> BA 274 Limoges-Romanet (Haute Vienne) E.A.A.603
Cote F. 9191, Journal des marches et opérations du 1/01/64 au 31/12/71
=> BA 725 - E.H. 2/68 « Maurienne»
Cote G.5428, Journal des marches et opérations du 1/7/64 au 31/12/67
Cote G 0437, COTA Manœuvres du 17/6/64 au 6/3/70
Cote G.0543, 4 COTA
. 1ère escadrille 21/2/67 au 20/2/68
. C.I.E.H. 24/2/67 au 29/2/68
. E.I.H. 6/6/67 au 22/8/68
. 1ère 2e escadrille 14/10/67 au 17/5/68
Cote G.0395, 4 COTA (2 consultés)
. Détachement feu St Raphaël 1/7/67 au 28/9/67
. Section vol contrôle 6/4/66 au 30/10/67
Cote G.O.5224, COTA (DPH. 05/68 Istres) du 22/8/67 au 12/4/68
Cote G.11035, CRMSA (C.I.E.H. 00.341- ex : 02.68 Maurienne) du 1/1/67 au 31/12/68
=> BA 745 Aulnat (G.E. 313 OPS)
Cote F.O. 4852, COTA (manœuvres) du 11/8/66 au 27/3/68
Cote F.O. 4878, COTA (E.I.V. ex.E.P.D.) du 01/6/67 au 3/11/67
Cote F.O. 4965, COTA (E.F.M. ex. D.M.P.) du 18/4/67 au 12/9/67
Cote F 8990, registre journal du C.L.A.
Cote F8987, Journal des marches et opérations du 1/1/63 au 31/12/67
C/ Département Interarmées Ministériel et Interministériel les 3 août , 4 et 26 septembre, 24 octobre, 7 14 et 22 novembre 2007
Série T - Etat-major de l’Armée de Terre et des services rattachés
Cote 9T 64, Revalorisation du parc Alouette III, mise en place des Alouette III (1967-1971)
Cote 11T 213, Manœuvres aéroportées et exercices de cadres par 11e division aéroportée (1963-67)
Cote 13T 144, caserne Guéret dans la Creuse (1949-1972) => non consulté
Cote 13T 167, casernes Limoges, Bellac et Magnac-Laval (Haute Vienne) => non consulté
Cote 13T 170-4, Ardèche => Privas : caserne (1949-1967)
Cantal => Aurillac : domaine militaire (1947-1969)
Cote 13T 179, Casernes de Clermont-Ferrand, Billom et Issoire (1958-1971)
Cote 13T 220-21, 7ème région militaire-Hautes Alpes ; Casernes de Gap, Briançon, Embrun, Montdauphin (1948-1972)
Cote 13T 252-1, Caserne le luc (Ecole d’application de l’Aviation légère de l’Armée de Terre)
Cote 13T 259 et 275 du camp de Courtine
Cote 13T 306, Dossier par localité des aérodromes et bases ALAT – 5ème région militaire
Drôme : Valence – Chabeuil
Isère : Grenoble – Montbonnot
Satolas, le Versoud
Rhône : St-Symphorien – Chaponnay (1957-1972)
Cote 15T 639, Descript, campagnes d’essais et Modifications apportées sur les Alouette (1962-1971)
Cote 15T 642, Equipement SA 340 ; Gazelle (1967-1968) => non consulté
Cote 27T 116 Camp d’instruction de la 4e région militaire : Caylus (Tarn et Garonne, de la Courtine (Creuse), Larzac (Aveyron) – (1932-1973) => En réalité, il n’y avait rien portant sur la Courtine. On y trouvait plutôt des « tirs de sécurité des propulseurs à poudre » (missile MSBS, etc.), réclamations de paysans de Millau (Aveyron) craignant les tirs d’artillerie (1954…)
Sous série 28T (archives de l’Aviation légère de l’Armée de Terre ALAT)
Cote 28T 1, Mobilisation et organisation générale ALAT (1963-1972)
Cote 28T 5, instruction provisoire sur la conduite à tenir en cas d’accident ou incident survenant aux aéronefs de l’Armée de Terre (1967)
Cote 28T 8-9, rapports d’études groupe ALAT (1963-1971)
Cote 28T 11-12, Accidents et incidents aériens – décisions de clôture d’enquête (1964-1968)
Archives sans cotes de l’année 1967 mais accessibles en faisant une demande de dérogation:
J.M.O. de la 35ème Cie de camps de Courtine
J.M.O. des 8ème et 9ème G.A.L.A.T. (secteurs de Lyon, Valence, Aix-les-Milles)
J.M.O. de l’Ecole d’application de l’A.L.A.T. du Cannet des Maures
J.M.O. de l’Ecole d’application de l’A.B.C. (Arme Blindée Cavalerie) de Saumur
J.M.O. de l’Etablissement de réserve générale du matériel de Montauban
J.M.O. de la 27ème brigade alpine
J.M.O. de l’école d’application du trains de Tours
D/ Département de la Marine le 25 mars 2008
Livres : La base aéronautique navale d’Hyères de Leduc Jonan => cote : VI-TH 627 - doc. n°46360
Pilote d’hélicoptères de Jubelin André (Ed. France Empire 1956) => cote : VI – 12° 5085
Revues : La revue maritime n°161 (spécial Noël 1959) p 1409 à 1426 « mœurs et coutumes des hélicoptères » par le lieutenant de vaisseau Jacques Bally
La revue maritime n°183 (noël 1961) p 1578, « mécaniciens d’aéronautique »
La revue maritime n°189 (juin 1962) p 759, « les premiers essais d’engins spéciaux dans l’aéronautique (au Luc, à 35 km de St-Raphaël). Air-sol comme la FX1400 et la HS 293 utilisés par les Allemands, la L50, le projet X8, etc…
. Divers
Les archives de la presse 51, rue des archives 75003 Paris (http :www.journeaux-collection.com)
Hélico revue Editions Jean Ducret SA Av. de la Concorde 29 - CP 14 CH-1022 Chavannes/Renens
I.N.A. (Institut National de l’Audiovisuel)
Le DVD et le livre Entre ciel et terre célébrant les 50 ans de services et travaux héliportés (R.T.E.)
Les envahisseurs (Télévision en séries) de Didier Liardet (2001)
Les cas solides : Cussac, 1967, RR3 de Alain Delmon (2003, etc…) sur http://adelmon.free.fr
Ovniland de G. Gutierez (2004-2005…) sur http://www.ovniland.com/
« Retour sur le cas de Cussac » de C. Poher (juin 2004) => pour accès voir l’auteur
Métier : pilote d’hélico (2007) de Anne-Chantal Pauwels (pas acquis à cause du prix de 50 €)
Le site (sur les douanes) http://www.cocardes.org/history/articles.php?lng=fr&pg=99) http://users.skynet.be/sky84985/chrono.html de Mme G. Van Overmeire ; http://www.heli-union.net
Wikipedia ; http://caea.free.fr/fr/coll/alouette2.html ; http://gaoa.free.fr ; http://aerostories.free.fr
http://perso.orange.fr/airtraditions/unit/escadron/CIEH341.htm; http://www.alat.fr (non officiel)
http://gaubs.free.fr; http://www.airliners.net ; http://qfu.free.fr (site d’échange pour l’aviation légère)
www.phyteauvergne.ecologie.gouv.fr; http://ludoskz.free.fr/genese.html; http://helimat.free.fr
http://www.cielinsolite.fr; http://ufo-logic.xooit.com; http://rte.phototheque.biz (médiathèque R.T.E.)
Flying Saucer Review vol.14, n°5 septembre-octobre 1968
The A.P.R.O. Bulletin (Tucson, Arizona) Juillet-Août 1968
Le Charivari n°14 (octobre novembre décembre 1971) page 46 à 48, Cussac et Arc-sous-Cicon.
Guide de la France Mystérieuse, tome 2, de Bagnoles-de-l’Orne à Cussac par R. Alleau (1975)
Catalogue d’observations atterrissages en Auvergne (Spécial info OVNI) de L.D.L.N. Riom-Clermont
Le Mystère des O.V.N.I. (1978) => l’auteur reprend l’article du G.E.P.A. quasiment mot pour mot
Ovni: le premier dossier complet des rencontres rapprochées en France de M.Figuet & J.-L. Ruchon (1979)
Les soucoupes volantes: le grand refus, page 61 et 82, G.A.B.R.I.E.L. (1979)
Témoignages ovni de J.-C. Bourret et P. Claeys - Atelier 786 – page 46 à 49 (1981) et Télépoche
Limousin Magazine n°368 (mai 1994)
Ovnis, la science avance, page 112 à 123, de J.-C. Bourret et J.-J. Vélasco (1995)
Science & Vie Junior n°77, page 84 de P. Lagrange (janvier 1996)
Ovnis : 1999 le contact ?, page 53 à 57, de J.-C. Bourret (1997)
Ufolog n°1, pages 25 et 26, septembre 1997 (le n° 19 mentionne l’observation de B. Mazzocchi en 1967)
La nuit extraterrestre (petit livret Canal +) page 41, Ufomania mars 2004 hors série n°1
Les Mystères de l’est du C.N.E.G.U. n°2 (1996), n°10 (2005)… et courriers des lecteurs
Phénomèna n°25 (revue SOS OVNI), article de R. Marhic
Troubles dans le ciel, pages 86 à 88, de J.-J. Vélasco avec Nicolas Montigiani (2007)
Phénomènes Aérospatiaux non identifiés, un défi à la science, pages 60 à 62 (2007)
Les ovni du CNES de Eric Déguillaume, Eric Maillot et David Rossoni (2007)
L’Express du 21/3/2007 , Le Nouveau détective n°1282 du 11/4/07
Téléstar n°1606 du 14-20/7/2007, Tarn libre du 3/8/2007
Science et Inexpliqué n°1 janvier-février 2008, pages 28 et 29
Pour la Science n°354, février 2008
Je remercie les ufologues indépendants, associations et divers organismes pour leur aide…
Christian Caudy, Claude Pavy, Alain Delmon et Jean Louis Peyraut
Eric Maillot et David Rossoni, Didier Gomez de UFOmania magazine
Raoul Robé (dessins & infos), Gérard Lebat des Repas Ufologiques Parisiens, Auguste Meessen
G.E.P.A. (Groupement d’Etude de Phénomènes Aériens) 69, rue de la Tombe - Issoire 75014 Paris
C.N.E.G.U. (Comité Nord-Est des Groupes Ufologiques) 20, rue de la Maladière 52000 Chaumont
Joël Mesnard , Luc Bourdin, Jean-Claude Venturini, et Jean-Marie Bigorne de L.D.L.N. ( Lumières Dans La Nuit) => B.P. 3 86800 Saint-Julien l’Ars
Les membres du S.C.E.A.U. (Sauvegarde, Conservation des Etudes d’Archives Ufologiques)
Les associations Italienne et Polonaise, ainsi que le professeur Jiri Kult en Tchécoslovaquie
Les pilotes d’hélicoptères André Morel , Jean Boulet, Pierre Gillard, Gérard Henry, Christian Sornette, Pierre Vincent (et tous les autres…) ainsi que M. Nicolas Boudard de HELI-AIR-SERVICE
Valéry Cornillon du C.C.I. de la Lozère et Jean-Louis Julien de l’aérodrome Mende-Brenoux
Pierre-Christian Guiollard, auteur-éditeur de l’histoire des techniques minières et chargé de mission auprès du Chef d'Etablissement de Bessines AREVA NC - BU Mines
Olivier de Marolles et Charles Schmitt d’Héli-Union ; E. Tresamini d’Eurocopter
Henri Guyot (du site traditions-air)
Jean-Marie Subra (du site una-alat), ancien pilote A.L.A.T. et contrôleur technique du Matériel
L’archéologue Jacques Dassié, Michèle Jasnin du Musée de la Publicité, Claude Liberman de la B.N.F
Le Centre de Documentation du Musée de l'Air et de l'Espace
Les archives de la Mairie de St Flour et l’office du Tourisme du Lioran
Pierre-Yves Milcent (responsable de fouilles de tumulus dans le cantal)
Christophe Bras de Fredon Auvergne (Cellule Environnement) ; J.-B. Marescot du Thilleul (E.C.I.B.)
Jérémie Bouquet, responsable Contrôles DRAF - SRPV Auvergne ; J.-B. Chene (C.S.T.B.)
La Sécurité Civile Clermont Ferrand ; Le SAMU du Cantal
Dominique Roosens (pompier et passionné d’aéronautique) et Christian Malcros
Rotor International
Le site Ardhan
A.I.A. : Josef Vebr et Charles Hadjadje
A.L.A.T.: Les membres de l’Association des amis du musée de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre et de l’Hélicoptère
B.R.G.M. (STI/ID)
C.N.E.S. (La division ballon) ; Claude Poher (ancien du G.E.P.A.N.)
D.G.A.C. :
Le Département Systèmes d'information - Navigation
aérienne
Responsable du groupe Documentation, diffusion des
connaissances du Service technique de l'aviation civile (
http://www.stac.aviation-civile.gouv.fr)
Le bureau Immatriculation des aéronefs
E.D.F./ R.T.E.
S.H.D.
…et mon épouse Diane sans laquelle rien n’aurait pu se faire…
NOTES ET REFERENCES
(1) Cette information a été communiquée par E. Maillot, auteur de nombreux articles sur le cas (voir Cercle Zététique en 1996 et C.N.E.G.U.…). Le Secteur de Lioran était déjà fréquenté à l’époque par les skieurs. Les investissements sur la station du Lioran sont réalisés par le Conseil Général du Cantal. Ils sont d’ailleurs très faibles car ce département n’est pas un des plus riches de France. Georges Pompidou était député de la circonscription de Saint-Flour (à quelques kilomètres de Cussac) avant d’accéder à la présidence de la République. Le correspondant actuel de la Montagne à Saint-Flour m’a précisé ne pas avoir d’informations concernant l’affaire d’août 1967 car il n’y a pas d’archives à son agence. Le siège régional de Clermont-Ferrand me répondit : « Il ne nous est pas possible d'accéder à votre demande. Nous avons été contraints de fermer l'accès à nos archives papier au public depuis quelques années, certaines personnes ayant dégradé les journaux consultés en déchirant tout simplement l'article qui les intéressait. Quant aux archives numériques, toutes les années ne sont pas encore traitées et l'usage de ces archives reste interne (à ce jour) ». Il fallait éventuellement me rapprocher de la B.N.F. (Paris). La responsable des archives de la Mairie de Saint Flour m’a néanmoins signalé qu’il existait deux autres journaux à cette période : Le Montagnard et La Dépêche d’Auvergne (ce dernier existait depuis 1946, parution 2 fois par semaine). Je lui ai envoyé par internet (archives.stflour@yahoo.fr ) l’article de la Montagne afin qu’elle voie ce que je recherchais. Elle ne trouva rien (mais n’aurait pu de toute façon pas faire de photocopie, vu la fragilité du papier). Elle m’envoya néanmoins une photo de François DH (ci-dessous à gauche), à l’époque où il était maire de St Flour (de 25/3/1989 à 24/4/1993). Je salue le parcours exemplaire d’un enfant qui dû concilier un état de santé fragile et les brimades de camarades de lycée qui le traitaient de « Martien » (suite à son observation). Il n’aimait pas le travail aux champs. Une raison supplémentaire - comme le signale A. Delmon – pour qu’il paraisse « différent » aux yeux des gens du village. La tradition voulait que le fils reprenne le métier de son père. T. Pinvidic signalait à ce sujet que lorsque François était enfant, il rattrapa en « classe d’accueil » le programme de 4 années scolaires en seulement 2 ans. Reçu au BEPC, il redoublera cependant sa classe de troisième du fait de ses absences. Son orientation vers une carrière juridique (avocat au barreau d’Aurillac) fut la conséquence probable de sa rigueur morale. Il est aussi écrivain.
(2) Le premier numéro de Lumières dans la nuit est paru en février 1958 (mensuel jusqu’à fin 1964). En 1967, Fernand Lagarde était en retraite depuis peu. Il était auparavant inspecteur de la SNCF. Michel Monnerie signale dans son livre Les arcanes ufologiques que Lagarde, radiesthésiste, avait cru pouvoir fournir les preuves statistiques que la plupart des atterrissages OVNI se produisaient sur des failles géologiques. D’après lui, il prit à partir d’un certain moment le contrôle - de manière déguisée - de la revue L.D.L.N. .
(3) La date de l’enquête de B. Pulvin et J.-C. Ameil du cercle L.D.L.N. de Clermont-Ferrand n’est par contre pas connue (probablement début des années 70). Sa publication ne semble pas avoir été réalisée. Georges Metz de L.D.L.N. m’a indiqué que d’après J. Mesnard , B. Pulvin est décédé ; quant à J.-C. Ameil, il l’a perdu de vue. J’ai suivi sa trace à Riom. Une dame très sympathique qui recevait souvent des appels téléphoniques - par erreur - qui lui étaient destinés, m’a indiqué qu’il devait avoir déménagé sur Paris. Lorsqu’il habitait Riom, il était sur liste rouge. Il avait dû enseigner (sport ?) au Lycée Claude et Pierre Virlogeux. S’il est toujours vivant, il devrait avoir dans les 70 ans. Une personne semblait correspondre dans le bottin téléphonique mais elle était apparemment décédée. La vieille dame qui décrocha me dit gentiment que je devais me tromper (ou alors il ne tient pas à être dérangé…). A noter que Francine Fouéré du G.E.P.A. m’a précisé avoir rencontré les deux enfants de Cussac lors d’une émission de Pierre Bellemare sur « Europe 1 ». J. Mesnard les aurait emmenés par la suite au salon du Bourget. Il semblerait qu’après l’émission Bellemare, les DH aient été embêté par des curieux. J. Mesnard a confirmé ce déplacement au salon du Bourget. Il a eu du mal à reconnaître François qui avait déjà beaucoup changé. J. Mesnard pense se rappeler que François se trouvait avec les Fouéré. C’est la raison pour laquelle il l’a revu. Les Fouéré tenaient un petit stand au Bourget ( ?). J. Mesnard a conduit François en fin de journée à Enghien-les-bains. Cela se passait entre 1971 et 1975. C'est la dernière fois que Joël a rencontré François. Il ne se souvient pas par contre de l’émission de P. Bellemare. J’ai pu avoir ces dernières précisions par l’entremise de l’ufologue Jean Claude Venturini (de L.D.L.N.). Pour terminer, signalons qu’un chercheur italien s’est rendu sur place peu de temps avant l’équipe d’Eric Maillot et que d’après lui les témoins refusent désormais de s’exprimer sur le cas.
(4) L’article paru dans le livre Mystérieuses soucoupes volantes de F. Lagarde (1974), de la page 127 à 132, sera repris intégralement lors de la parution de L.D.L.N. N°233-234 (Novembre-Décembre 1983 - pages 5 à 8) dans un article intitulé « Télépathie et phénomène OVNI ». F. Lagarde y ajoutera une partie « discussion ». A noter que dans les deux publications, F. Lagarde mentionne comme date d’observation le 22 et non le 29 août. F. Lagarde est décédé il y a une dizaine d’années (Source G.Durand / S.C.E.A.U.).
(5) Parution dans Ovni, vers une anthropologie d’un mythe contemporain (1993) pages 198 à 211. Thierry Pinvidic donna une conférence sur Cussac aux Repas Ufologique de Lyon le lundi 18 juin 2007.
(6) On pourrait même y voir une allusion aux «MIB » avec ses « petits hommes noirs » mais c’est juste une coïncidence
(7) Dans leur ouvrage Ovni : le premier dossier complet des rencontres rapprochées en France (1979) , Michel Figuet et Louis Ruchon semblent croire que l’enquêteur est de St Etienne car ils notent « M. Claude de L.D.L.N. » (page 287). Notons que dans le même ouvrage (page 733), il est noté que les « sphères » constituent 21% des formes d’OVNI (en France du moins…), soit la part la plus importante dans les rencontres rapprochées. M. Figuet observa d’ailleurs une « boule » lumineuse en 1965 à Fort-de-France. Des sphères (ou boules) plus petites qu’à Cussac ont déjà été observées. J.-C. Venturini m’a notamment parlé d’une observation qui a eu lieu dans l’Aveyron (voir L.D.L.N. 384 page 40). Il me déclara à ce sujet : « Voici l'explication qui est donnée à notre témoin par les ET à propos de ces boules … les boules étaient de matière inorganique organisée. C'était comme du plasma. Un état gazeux fortement ionisé ! C'est de la matière sans en être ! Ca sert à prendre des images et du son, des mesures de température, gravitation. Mesurer le degré d'hostilité ou de bienveillance. Elles peuvent se dissoudre par nécessité ». Des informations toujours intéressantes mais à prendre sous réserves étant donné les fausses informations déjà communiquées par d’autres « entités » par le passé…
(8) « L’Eglise a constamment voulu faire taire ceux qui croyaient à l’existence d’êtres extraterrestres, cette hypothèse ne s’accordant pas avec une vision de création divine unique. Elle n’y est pas parvenue car les images des planètes réalisées par les astronomes, ainsi que la magie associée aux autres mondes habités, ont très vite popularisé l’idée de leur existence » (Jean Demerliac – Cosmic… à la recherche de mondes habités- édition Albin Michel et Arte – 2007)
(9) Thierry Pinvidic y ajoutera plus tard à la liste « Robinson Crusoë » et « Le grand Meaulnes »
(10) L’ufologue Thierry Rocher (du C.N.E.G.U.) put obtenir de la Mairie de Cussac les références des 3 parcelles. Après avoir réglé 6 € de frais au centre des impôts d’Aurillac (service du cadastre), il put recevoir 2 extraits de plan (échelle 1/2500) au format A3. Les numéros n’avaient pas changé depuis la révision du plan en 1934. En téléphonant , je réussis à obtenir le nom du propriétaire actuel de la parcelle sur laquelle la « machine » s’était posée. Elle appartenait à M. Barriol Raymond et son épouse. Je fis la même démarche auprès du conservateur des hypothèque afin de savoir s’il était déjà propriétaire du terrain en 1967. Au niveau géologique, c’est une zone de basaltes supracantaliens.
(11) A la page 136 à 138 (France Empire 1974). Dans le cas de Turin qui impressionna beaucoup J.-C. Bourret, on a aussi affaire à un « objet sphérique lumineux qui s’enfuit à grande vitesse ».
(12) Pour en savoir plus sur les Pédauques - reine et runes - voir notamment le site http ://www.fomoire.org D’après Thierry Pinvidic, ce sont des créatures cavernicoles à pattes palmées associées aux peurs dans les récits traditionnels de cette région.
(13) En janvier 1968, avec le numéro 92 (soit 2 numéros après celui ayant traité du cas de Cussac), la revue est imprimée (et non plus ronéotypée), L.D.L.N. devient véritablement une revue d’ufologie. Les autres sujets n’étaient plus traités que dans des pages supplémentaires et allaient disparaître quelques années plus tard.
(14) Rapport de « Présentation au Conseil Scientifique du G.E.P.A.N. des études menées pendant le premier semestre 1978. Tome 4, juin 1978, C.NE.S. »
(15) Il est paru dans la collection Marabout puis a été réédité en 2006 dans la collection « Livre de poche » (n°7282)
(16) Jean Jacques Vélasco défendra d’ailleurs l’hypothèse extraterrestre dans son livre Ovnis, l’évidence (2004) en se démarquant du C.N.E.S., C. Poher suivra plus ou moins le même chemin dans Gravitation, les universons, énergie du futur (Edition du Rocher - 2003)
(17) Grâce à J.-C. Venturini, je pus rentrer en contact avec une personne qui connaissait François DH depuis une vingtaine d’années. Cet homme, plus jeune que le témoin, avait dû le connaître lors d’une soirée. Ils se croisaient encore deux ou trois fois par an. D’après lui, l’histoire vécue par François DH continuait à le poursuivre comme s’il était un vilain petit canard. Lorsqu’il avait été maire, son équipe l’avait lâché au fur et à mesure (mais je ne pus connaître avec certitudes les raisons). Il me décrivit François DH comme un personnage le plus souvent mal habillé, mais extrêmement attachant, charismatique et l’un des esprits les plus brillants du Cantal. Il était très préoccupé par le temps. Il avait peu de proches et avait fait le « vide » autour de lui. Il venait parfois sur Paris en coup de vent. Il était toujours passionné de littérature. Il avait d’ailleurs écrit sur sa région. Ses textes n’étaient ni cyniques ni méchants, mais plutôt doux, non dénués d’une certaine forme d’humour…
(18) Les bacheliers peuvent en effet devenir pilotes mais à condition de franchir de multiples sélections (Parisien du 22 janvier 2007, page 6). Pour l’anecdote, le 13 août 2007, lors de vacances dans la très belle ville de Douai, mon épouse me montra une plaque située face à l’hôtel de Ville. Il y était inscrit : « Le 21 août 1907, s’éleva à Douai pour la première fois au monde, avec son pilote Volumard, un hélicoptère Le Gyroplane . Conçu et réalisé par Louis Breguet avec le concours de son frère Jacques et du professeur Charles Richet ». La découverte de cette plaque était le fruit du hasard. Il faut préciser que Le Gyroplane dut être maintenu en équilibre par des techniciens au sol. L’invention de l’hélicoptère (sans personne au sol pour le maintenir) est attribué à Paul Cornu, simple mécanicien. Le décollage eut lieu le 13 novembre 1907, à Coquainvilliers, petit village près de Lisieux.
(19) redaction@helico-revue.ch
(20) andre.bour@helicopassion.com HELICO PASSION : www.helicopassion.com
(21) www.alouettelama.com - pierre@alouettelama.com
(22) 923 appareils SE3130/SA313B motorisés Artouste IIC/IIC5 et 382 SE 3180/SA 318C dans la version motorisée avec une turbine Astazou II A/II A2. L’Alouette II tire son origine du Sud-est (d’ou « SE »). L’ hélicoptère triplace était destiné surtout à un usage agricole. Elle était fabriquée à l’usine SUDAVIATION (ex-SNCASE et ancêtre d’Eurocopter) de la Courneuve et les essais en vol se faisaient sur l’aérodrome du Bourget, où l’on a également réalisé le Centre d’essais des pales et des ensembles mécaniques, appelé CEHB. Les premiers exemplaires étaient destinés à l’Armée française. La chaîne de production a été transférée à l’usine de Marignane en 1961. L’usine de La Courneuve allait dès lors se consacrer exclusivement à la fabrication des pales, mais elle continuait à abriter la direction commerciale. Des SA 315B (Lama) furent construits sous licence en Inde dès 1972. La firme HAL de Bangalore les rebaptisa « Cheetah » (ou « Chetak » ?). Pour l’Alouette III, 230 hélicoptères furent construits à Brasov, en Roumanie par ICA sous la dénomination « IAR 316B ». La Suisse construisit entre 1970 et 1974 chez F + W 60 « Alouette III S » sous licence.
Sources http://celag.free.fr/museum/se3130/se313_0.htm , http://pdennez.free et http://eads.net
Les Alouette II avaient uniquement des patins simples (les modèles à roue, ou mixtes roues-patins étaient bien plus rares et réservés à la Marine. L’hélicoptère EDF dont j’ai parlé dans ce document (photo à la page suivante) est équipé de 2 pneus de secours pour roulage au sol et non de roues 'train d'atterrissage' (au nombre de 4). Les 2 pneus ne sont pas situés au bout des béquilles. Cela ne correspond donc pas aux béquilles en forme de boules.

(23) http://www.aviation-civile.gouv.fr/html/prospace/immat.htm
Les coordonnées du service des archives de la D.G.A.C. figurent sur la page suivante :http://www.aviation-civile.gouv.fr/html/actu_gd/memoire/archives/recherche/infos.htm
(24) http://helimat.free.fr/edf8.htm http://helimat.free.fr/edf8.htm
(25) http://www.senat.fr et Journal Entre voisins (Janvier-février-mars 2007)
(26) Pour mémoire, une diminution de 3 décibels correspond à une puissance acoustique divisée par 2
(27) Clinique vétérinaire de la Châtaigneraie Zone artisanale – les Camps 15130 Lafeuillade en Vezie
(28) D’après l’Office des publications officielles des Communautés Européennes. A noter l’apparition fin décembre 2006 d’une revue traitant du patrimoine agricole : Tractorama. Malheureusement, rien à signaler dans cette revue concernant le bruit de ces engins.
(29) Le progrès de Lyon du 1er septembre ne contient aucun article sur Cussac. Il avait dû être mis par erreur dans la liste qui se référait plutôt à une édition de décembre 1995 où était indiquée la présence de J.-J.Vélasco et Eric Maillot à un débat animé qui avait eu lieu au Planétarium de Vaulx-en-Velin (voir Mystères de l’est n°2, page 23). A noter que Roland Barthes écrivait dans son livre Mythologies (1957) : « Les Martiens, a dit le Progrès de Lyon, ont eu nécessairement un Christ ; partant ils ont aussi un pape (et voilà d’ailleurs le schisme ouvert) : faute de quoi ils n’auraient pu se civiliser au point d’inventer la soucoupe interplanétaire. Car, pour ce journal , la religion et le progrès technique étant au même titre des biens précieux de la civilisation, l’une ne peut aller sans l’autre : il est inconcevable, y écrit-on, que des êtres ayant atteint un tel degré de civilisation qu’ils puissent arriver jusqu’à nous par leurs propres moyens, soient païens. Ils doivent être déistes, reconnaissant l’existence d’un dieu et ayant leur propre religion… »
(30) http://commandohubert.free.fr/ETR_armeeterre.html
http://www.defense.gouv.fr/terre/actualites_et_dossiers/plongeurs_de_larmee_de_terre
(31) D’après le sociologue Pierre Lagrange les LGM (little green men ) ont une double origine, dans la SF où on trouve l'expression avant les années cinquante, et en ufologie, où apparemment elle se popularise en 1955, notamment à la suite de l'affaire de Kelly-Hopkinsville. Tout commence en 1912, avec le célèbre roman de Edgar Rice Burroughs A Princess of Mars, qui décrit, parmi les différentes espèces habitant la planète rouge, des Martiens à la peau verte. Pour les adolescents qui raffolent des romans martiens de Burroughs, le vert devient naturellement l’une des couleurs privilégiées des extraterrestres. En 1946, une nouvelle de Harold Sherman parue dans Amazing Stories, qui s’intitule The Green Man, décrit l’arrivée sur terre d’un émissaire extraterrestre. L’année suivante, Damon Knight publie une nouvelle intitulée The Third Little Green Man dans Planet Stories. Le passage entre la SF et l'ufologie semble se faire au tournant de 1954 et 1955. En 1953, un coiffeur américain fit passer un singe rasé, tué et qu’il aurait « peint en vert » pour un extraterrestre débarqué d’une soucoupe. Mais l’examen des dossiers militaires montre qu’il n’était pas question, lors des faits, de couleur verte, et que ce détail a été ajouté après coup. Un an plus tard paraît Martien Go Home de Fredrick Brown qui utilise l'expression LGM. En fait, les « little green men » font irruption en ufologie au cours de l’été 1955, à la faveur d’une histoire de soucoupes volantes survenue en août dans le Kentucky : l’affaire de Kelly-Hopkinsville. Je signale une autre histoire qui remonterait à août 1887. Elle raconte que deux enfants sortirent d’une grotte, près de Banjos, en Espagne. Ils avaient la peau verte, les yeux bridés, des vêtements faits d’une matière insolite. Ils ne parlaient pas l’espagnol. Au début, ils refusèrent de manger, et le garçon mourut. La petite fille apprit assez d’espagnol pour expliquer qu’ils venaient d’un pays sans soleil, où, un jour, une trombe les avait emportés et déposés dans la grotte. Cela ne contribua guère à dissiper le mystère qui l’entourait. Elle mourut en 1892, sans qu’on puisse élucider ses origines. Cette histoire ressemble de près à celle des enfants verts qui sortirent cette fois-ci de la grotte de Woolpit, en Angleterre, au XIe siècle ; la petite fille dit qu’ils venaient d’un pays sans soleil. Y-a-t-il une histoire authentique à la base ? Des « trombes » ou ce qui semble y ressembler ont déjà été observées dans un contexte ufologique. Un « passage » vers un univers inconnu ? (Sources : Colin Wilson, Mystères. Le surnaturel face à la science, etc.). Pierre Lagrange ajoute à ce sujet : « De mémoire, l'histoire est visiblement une reprise de celle des enfants verts du 11e siècle. Elle est rapportée par William de Newburgh dans Rerum Anglicarum (ca 1135-ca 1198) et reprise par Robert Burton dans Anatomy of Melancholy (1621).Je ne crois pas que l'histoire ait beaucoup à voir avec la légende des LGM. Mais il faut noter que Burton suggère que les deux enfants sont peut-être des extraterrestres tombés sur Terre, ce qui est très audacieux et inhabituel à son époque (peu de personnes supposent que des ET puissent venir sur Terre alors). » La liste EuroUfo : EuroUfoNet@yahoogroups.com
Ufologues polonais : http://www.ufoinfo.com/organizations/org_poland.shtml
Malgorzata Zoltowska (Fundacja Nautilus)
(32) J’eus d’ailleurs une conversation très intéressante sur le cas d’Antonio Villas Boas avec Marc Hallet. Je note par ailleurs une coïncidence : François DH est devenu avocat comme Antonio Villas Boas. Pour les références sur ce cas brésilien, voir En quête des humanoïdes de Charles Bowen (pages 241 à 286, J’ai lu A 315 - 1974), revue Phénomènes Spatiaux n°4 et 10.
(33) Traduction d’après un article de Santiago Yturria http://www.rense.com. Le 22 octobre 2007, une observation assez inhabituelle - qui pourrait être mise en rapport avec celle du Mexique - eut lieu cette fois-ci au dessus de Paris. L’hypothèse d’un ballon n’a pour l’instant pas été entièrement écartée.
(34) Lire notamment à ce sujet SF : la science mène l’enquête de Roland Lehoucq (2007). Pour ce qui est du cas brésilien, je conseille la lecture de Le Mystère des O.V.N.I. de R.-.J. Perrin, En quête des humanoïdes de C. Bowen ou encore Les apparitions O.V.N.I de J.Lob & R.Gigi.
(35)Service départemental de l’architecture et du patrimoine Cantal (90, avenue de la République BP 539 15005 Aurillac Cedex (sdap.cantal@culture.gouv.fr). A noter encore que l’église romane a été remaniée au 15ème siècle. Elle a fait un don au monastère de St Flour au 11ème. Elle a été mise à sac au cours des guerres de religion. Elle possède aussi une croix du 14ème (Source QUID). Rappel : un tumulus est un amas de terre, ou construction de pierres couvrant un dolmen ou une sépulture et formant une butte artificielle.
(36)Joseph Thonnard ! voir aussi les site http://meteor.proftnj.com/meteor.htm et http://www.danslagueuleduloup.com e-mail: loup@dlgdl.com .A noter que j’exclus bien naturellement le travail de P. Claeys (Témoignages OVNI- Atelier 786)
(37) Journaliste et écrivain, il a écrit Le triangle de la Burle dans « le Tibet français » qui a été édité par les éditions Créer en 1987 et L’histoire secrète de l’Auvergne chez Albin Michel en 1981. A lire aussi l’article de J.-P. Ronecker dans Ufolog n°5 en 1998 intitulé « Le mystère du pot-au-noir ». Je signale une petite erreur (page 25) sur le nombre de savants atomistes (7 et non 22). Pour terminer, à noter un autre « Cussac » (Cussac sur Loire – 43370) à une vingtaine de kilomètres du Mont Mezenc, coïncidence… Pour Hessdalen voir Phénomèna n°14 ou Ovni Présence n°28 en 1993.
(38) Champs électromagnétiques intenses et opacité lumineuse par Rémy Larverne (C.N.R.S. Editions Janvier 2003) et Revue du sol et du sous-sol (février 2003) par Jean Gergovie, géologue.
(39) Les bases azotées (aussi appelées bases nucléiques ou nucléobases) sont des molécules qui font partie des nucléotides, qui sont eux-mêmes des éléments de l’ARN et de l’ADN. C'est par les liens hydrogène entre paire de bases azotées que sont liés deux brins de l'hélice d'ADN ou d'ARN. Il existe cinq bases azotées : adénine, cytosine, guanine, thymine et uracile. L'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine sont présentes sur les nucléotides de l'ADN, l'uracile remplace la thymine sur les nucléotides de l'ARN. Leurs abréviations respectives sont A, C, G, T et U. Généralement on identifie le nom de la nucléobase au nom du nucléotide correspondant. Lors d’un mini forum de discussion sur internet, Eric Maillot me précisa à ce sujet : « Croiser un être vivant terrestre avec un venu d'ailleurs qui n'aurait pas ce patrimoine de base serait pour le coup impossible (ou infiniment improbable). Si ce point commun existe, nul ne peut exclure qu' une intelligence supérieure présumée ne sache pas bricoler (clonage, manip génome, fécondation in vitro, greffe d'embryon,...) des croisements entre des espèces différentes. Une espèce supérieure qui saurait lire/écrire, décoder et coder, parfaitement tout génome pourrait créer de nouvelles espèces vivantes comme on crée un programme/logiciel évolué (3D, son, intelligence artif, robot,...) sur la base d'un code informatique ». En avril 2008, l’équipe du Dr Lyle Armstrong (Université de Newcastle) a annoncé avoir créé, pour la première fois en Europe, des embryons humains-animaux (vaches). Ces embryons ont vécu trois jours. Le premier embryon hybride a été créé en 2003 à Shangaï avec des cellules d’hommes et de lapin. Difficile de ne pas penser aux « hommes scorpions » (échappés du futur ?) que J. Vallée signale avoir vu sur des amulettes phéniciennes. On peut aussi signaler un médecin de l’hôpital des enfants de Boston qui propose à ses jeunes patients (qui peuvent être âgés de 9 ans) de changer de sexe (Source Bio Edge 29/05/08) ou la société californienne 23andMe qui encourage ses clients à rendre public leur code génétique qui peut intéresser les recruteurs (Le Monde 7/06/08), etc…
(40) Voir Journal of Scientific Exploration (Pergamon Press), Vol.4, n°1, pp.105 à 117 & L.D.L.N. n°305
(41) Un concept que j’ai développé dans la revue Ufolog (n°5 et 14) et qui est très bien illustré par le roman de Christophe LAMBERT : La Brèche (2005). R. Robé m’a signalé une variante plutôt extraterrestre qu’il aurait lue dans un court roman de Franck Herbert (auteur de DUNE) intitulé Les fabricants d'Eden (1968) : « Scénario assez étonnant vis à vis de la casuistique ufologique moderne (enlèvement, viol, OVNI invisible sauf pour des témoins isolés, E.T. petits courts sur jambes arquées, peau grise métallisée, etc.) et surtout pour raisons incompréhensibles pour nous de leur action sur l'humanité = étant immortels, ils filment nos sentiments, nos réactions violentes (émotions qu'ils ont perdues) en les suscitant parfois (guerre, meurtre...) pour les diffuser à l'ensemble de la communauté en super-cinémascope-relief-odorama. Une thèse que j'ai entendu déjà développer par J.-L Rivéra (lors d'un voyage vers une session CNEGU des Ardennes des années 90) en parlant de son ami B. Hopkins... A lire donc. ». En attendant, les « Usines à rêves » (ou cauchemar ?) n’ont jamais aussi bien marché. L’homme raffole de toujours plus de sensations, de toujours plus d’images. Le Figaro Economie du 18 mai 2007 indiquait d’ailleurs que les financiers ont misé sur le cinéma américain près de 10 milliards de dollars en 3 ans. Côté TV, la dernière série à la mode c’est Dext. L’histoire d’un expert médico-légal avenant le jour et tueur en série méticuleux la nuit. Côté télé-réalité, la troisième chaîne publique néerlandaise (BNN) diffuse un programme où des bébés ou des adolescents sont « prêtés » à des couples. Un couple de lesbiennes y a été remplacé pour avoir évoqué l’idée de placer le nourrisson dans un réfrigérateur (Le Monde du 25/1/2008). Et demain ? On n’est plus très loin du Prix du danger (Yves Boisset – 1983). Jusqu’où ira la folie humaine ?
(42) Le professeur Broch a reconnu dans l’émission Pièces à convictions : OVNI, mystères sur la planète (F3 - Juin 2007) avoir observé dans sa jeunesse un phénomène qu’il n’a jamais pu expliqué.
(43) Le Figaro du 20 décembre 2007 signalait que le fond souverain chinois (China Investment Corp.) injectait 5 milliards de dollars dans le deuxième géant de Wall Street, la banque d’affaire Morgan Stanley, fortement ébranlée par une crise que certains n’hésitait pas à comparer à celle de 1929.
(44) Source Ciel & espace - Juin 2007
|
LA REPRODUCTION ET LA VENTE DE CET OUVRAGE SONT INTERDITES SANS L’ACCORD DE L’AUTEUR
|